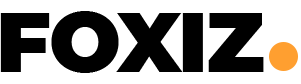La mort aime bien les pauvres», écrivait Le Monde diplomatique en février 2005, après le tsunami qui venait de toucher l’Indonésie, les côtes du Sri Lanka, le sud de l’Inde et de la Thaïlande . Il est trop tôt pour établir un bilan du tremblement de terre de niveau 7 sur l’échelle de Richter qui a ravagé le pays le plus pauvre d’Amérique latine, Haïti, le 12 janvier. Mais le pire est à craindre. Pour l’heure, dans l’urgence, il s’agit de chercher et de sauver les victimes, apporter une assistance sanitaire aux survivants, créer des refuges, fournir aliments et eau, tenter d’enrayer les épidémies. Solidarité internationale et aide humanitaire, chacun, de l’Organisation des Nations unies (ONU) aux Etats-Unis en passant par l’Union européenne — et en particulier la France, qui ne peut se soustraire à sa dette historique envers l’île — ou l’Amérique latine, se mobilise selon (ou non) ses moyens.
Une fois de plus, le séisme frappe une région du globe peu épargnée par les phénomènes naturels. En 2008, Haïti avait déjà subi l’enfer de quatre ouragans tropicaux — Ike, Anna, Gustav et Fay. On ne peut leur comparer ce tremblement de terre, manifestement aussi imprévisible qu’imprévu, difficile à anticiper. Néanmoins, une première question se pose : pourquoi, lors de ces cyclones, qui les ravagèrent de la même manière (avec des conséquences économiques désastreuses), déplora-t-on sept cent quatre-vingt-treize morts en Haïti et «seulement» quatre à Cuba? Comme un effet de loupe, les catastrophes révèlent l’état «réel» des sociétés.
Une fois passés le choc initial et l’émotion, les gouvernements, organisations non gouvernementales (ONG), institutions internationales et médias broderont à l’envi sur le thème de la «reconstruction». Si tant est qu’on puisse employer le terme «reconstruire» dans un pays dépourvu de tout.
Mais de quelle reconstruction parlera-t-on? Après le cyclone Mitch, qui, en octobre et novembre 1998, fit près de dix mille morts et des centaines de milliers de sinistrés en Amérique centrale, les mouvements sociaux y avancèrent l’idée de la lier à un nouveau type de développement destiné à réduire la vulnérabilité sociale. Le temps a prouvé depuis que, dans ce sens, rien ne fut fait. La seule tentative menée, bien plus tard, par le président hondurien Manuel Zelaya, se terminant par le coup d’Etat du 28 juin 2009…
A une classe politique haïtienne que menace le spectre de l’autodestruction, et qui n’est pas exempte de responsabilité dans l’état calamiteux du pays, qui donnera des leçons? Les institutions financières internationales, qui ont retardé le processus d’annulation de la dette, en dépit des problèmes auxquels faisait déjà face la population? Washington, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque interaméricaine de développement, etc., les pays dits «amis», qui ont cyniquement poussé à la descente aux enfers de la société haïtienne?
Dès 1984, le FMI a obligé Port-au-Prince à libéraliser son marché. Les rares et derniers services publics furent privatisés, en privant d’accès les plus démunis. En 1970, Haïti produisait 90% de sa consommation alimentaire; elle en importe aujourd’hui 55%. Le riz américain subventionné a tué la production locale. En août et septembre 2008, la flambée des prix alimentaires mondiaux fit augmenter son prix de 50%, provoquant des émeutes de la faim.
Un cataclysme naturel peut être imputé à la fatalité. La paupérisation honteuse et insupportable des populations urbaines et rurales d’Haïti, non.
Maurice Lemoine