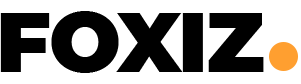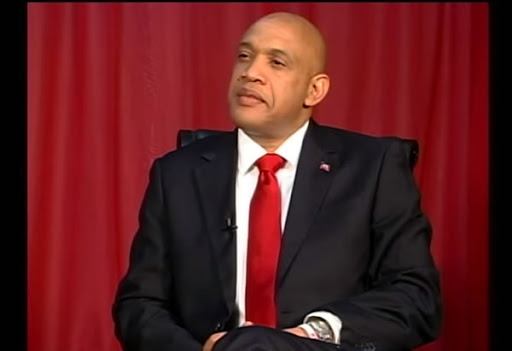Depuis samedi, les autorités haïtiennes ont dénombré plus de 1900 morts, 10 000 blessés et 60 000 maisons détruites. Face à l’ampleur de la catastrophe, le nouveau premier ministre haïtien, Ariel Henry, a décrété une période de deuil national (le pays vient de vivre un récent deuil national en raison de la mort du président), en plus de décréter l’état d’urgence.
La route nationale reliant Port-au-Prince aux villes touchées par le séisme est occupée par des bandits, en l’absence de grands ports et aéroports dans les zones sinistrées. Cela nécessite un immense défi de logistique et d’organisation.
La reconstruction, quant à elle, semble être un mirage pour les Haïtiens, qui n’ont toujours pas de Palais national 11 ans après le tremblement de terre qui a coûté la vie à plus de 150 000 personnes.
En 2016, les villes qui sont aujourd’hui détruites par le séisme ont connu une première période de destruction en raison du cyclone Matthew. Les villes côtières des Cayes et de Jérémie, réputées pour leurs paysages verdoyants et leurs plages au sable blanc, ne sont pas près de revoir les touristes de sitôt. Idem pour les stations balnéaires de l’Île-à-Vache (île au large d’Haïti) et ses eaux turquoise qui laissent aujourd’hui place aux décombres et à la poussière. Je joins ma voix à l’appel de solidarité lancée par les Haïtiens, en plus d’ajouter que mes pensées accompagnent ce peuple résilient.
Comme le disent les Haïtiens en créole, «Men anpil chay pa lou»; en français, cela signifie «Tous ensemble, on est forts» et, comme le dit la devise haïtienne, l’union fait la force.
Sacha-Wilky Merazil, étudiant, Montréal