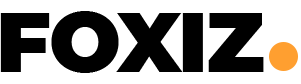Un passé agité
La démocratie haïtienne demeure très récente. Ce n’est qu’après la dictature des Duvalier – Papa Doc (1957-1971) et Bébé Doc (1971-1986) – puis d’une succession de présidents issus des forces armées que le pays a eu, en 1990, son premier président démocratiquement élu, Jean-Bertrand Aristide. Son parcours institutionnel a malgré tout été caractérisé par beaucoup d’instabilité. Un an après son arrivée au pouvoir, le président Aristide est renversé par un nouveau coup d’État militaire. Haïti vit alors trois ans de terreur et de répression jusqu’en 1994, alors que M. Aristide est rétabli au pouvoir afin de terminer son mandat. En 1996, Jean-Bertrand Aristide devient le premier président élu à passer le pouvoir à un autre président élu, René Préval, qui devient à son tour le premier président à compléter un mandat. En 2000,
Jean-Bertrand Aristide est réélu lors d’élections dont le taux d’abstention est estimé à 90% par l’ONU. Cette faible légitimité du président a rapidement donné lieu à un conflit social qui a atteint son paroxysme en 2004, lorsque Jean-Bertrand Aristide fut contraint de quitter le pays sous l’escorte des forces spéciales états-uniennes. Depuis, la santé démocratique du pays continue de se détériorer, en dépit de la réélection de René Préval, en 2006, et de l’élection de Michel Martelly en 2011.
Deux phénomènes semblent aujourd’hui marquer la vie institutionnelle du pays : la fragmentation politique et le déclin du respect des droits humains. Par comble de malchance, on doit ajouter à cela les graves conséquences du séisme du 12 janvier 2010.
Fragmentation politique
En Haïti, il y a actuellement dix-huit partis représentés à la Chambre des députés et sept au Sénat, mais la plupart d’entre eux ne comptent qu’un élu. Aussi, il existe plus d’une centaine de partis remplissant les conditions pour s’impliquer légalement dans la vie politique. Ce manque de grands partis politiques structurant la vie institutionnelle du pays conditionne donc son fonctionnement à la construction d’alliances entre plusieurs petits partis. De plus, ces coalitions se bâtissent souvent autour du charisme de certains leaders, ce qui favorise la personnalisation de la politique. Ceci a notamment été le cas de Michel Martelly, ancien chanteur populaire, qui au moment de prendre le pouvoir, n’avait que trois députés issus de son parti, Repons peyizan. Bien évidemment, les frontières de ces coalitions changent au rythme des intérêts de leurs leaders.
Les conséquences d’une telle fragmentation ne sont pas négligeables. D’une part, les citoyens sont privés de la possibilité de choisir entre des plateformes politiques clairement définies, ce qui mène à une forme de divorce entre les attentes de la population et les élus. D’autre part, ces coalitions aux frontières diffuses entravent le bon fonctionnement de l’État. Non seulement elles ne sont pas en mesure d’élaborer des politiques publiques de base, mais elles prennent les institutions de l’État en otage. En effet, ces coalitions de petits partis, souvent créées pour être au service d’intérêts purement personnels, permettent de confier l’administration de diverses institutions à certains individus en échange de leur appui politique.
![]() Vide institutionnel et élections reportées
Vide institutionnel et élections reportées
L’élection de Michel Martelly un peu plus d’un an après le séisme de 2010 a suscité un grand espoir au sein de la population, tant en ce qui a trait à la reconstruction du pays qu’en raison de son discours de dénonciation des élites traditionnelles comme étant les principales responsables du mauvais fonctionnement du pays. Or, les conditions sociales peinent à s’améliorer. Plus de 70% de la population vit toujours avec moins de deux dollars par jour et l’insécurité fait encore partie de la réalité de nombreux Haïtiens. Aussi, le pays n’a toujours pas de maires ou de représentants territoriaux élus.
Le gouvernement n’est toutefois pas le seul pouvoir affecté par cette situation. À titre d’exemple, le président des deux institutions supérieures du pouvoir judiciaire – le Conseil Supérieur et la Cour de Cassation – Me Anel Alexis Joseph, a quitté son poste au début du mois de janvier. Sa démission était demandée depuis 2012 en raison d’allégations d’irrégularités relativement à sa nomination. Côté législatif, le panorama est tout aussi marqué par l’instabilité. Le refus par l’opposition d’entériner la désignation par décret des membres du Conseil Électoral Permanent, entité censée organiser les élections, a retardé la tenue d’élections législatives. Prévues initialement pour 2012 puis pour 2013 avant d’être remises à octobre 2014, elles ont finalement été reportées à un moment indéterminé. De plus, le Parlement étant devenu caduc depuis le 12 janvier dernier, seulement dix parlementaires ont des mandats encore en vigueur, un nombre insuffisant pour assurer le bon fonctionnement des institutions selon la Constitution.
Nouveau gouvernement et responsabilité internationale
Le 19 janvier, un nouveau gouvernement dit « de consensus » a été formé afin de débloquer la situation. Son manque de légitimité est néanmoins flagrant. En termes légaux, la nomination du nouveau premier ministre ne peut pas être ratifiée par le Parlement, car celui-ci ne peut obtenir le quorum. En termes politiques, il est difficile d’en arriver à un réel « consensus » sans inclure le principal parti d’opposition, Unité, qui disposait de 35 des 99 députés haïtiens.
Au cours des derniers mois, ces graves violations aux principes démocratiques n’ont été dénoncées que de façon plutôt chétive par la communauté internationale. L’Organisation des États américains (OÉA), par exemple, n’a jusqu’à présent eu que
des réponses timides. La Charte démocratique interaméricaine considère la tenue régulière d’élections, l’implication citoyenne dans la vie politique, la division des pouvoirs ainsi que le respect de l’ordre constitutionnel comme règles de base de la démocratie. Malgré le fait qu’aucune de ces règles ne soit respectée en Haïti, l’OÉA considère qu’il n’y a ni rupture ni altération de l’ordre démocratique dans le pays. Par conséquent, aucune sanction n’a été imposée. Les seules réactions de l’organisation ont été des déclarations d’appui à la démocratie et plus récemment, certaines tentatives de dialogues menées par son secrétaire général entre les divers partis impliqués ont eu lieu.
En toute évidence, les pays de l’hémisphère n’osent pas contester la position des États-Unis de continuer à travailler avec les autorités en place, sous le prétexte de vouloir sauvegarder les progrès réalisés depuis le séisme, et ce, malgré le besoin pressant et constitutionnel d’organiser des élections. Paradoxalement, Washington, qui a par le passé souvent remis en question la qualité démocratique d’autres pays de la région pour bien moins, semble cette fois-ci ne pas s’inquiéter outre mesure du vide institutionnel créé par la non-tenue d’élections. Tout semble indiquer que la démocratie est parfois une condition malléable, selon les intérêts des puissances concernées.
Nicolás Pedro Falomir Lockhart – Candidat au doctorat en études internationales à l’Université Laval et auxiliaire de recherche au Centre d’études interaméricaines (CEI)