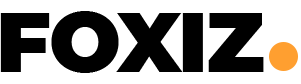En Haiti, nous avons importé le concept de démocratie sans le mode d’emploi. De la base au sommet, nous ne souffrons pas d’être contredits. Or, la mise en œuvre de la démocratie suppose une culture de la contradiction.
Les espoirs des citoyens, après la chute de M. Jean-Claude Duvalier en février 1986, ont été, une fois encore, cruellement déçus. Au cours de ces vingt et un mois, le CNG a systématiquement fait preuve de mauvaise volonté et retardé la mise en place du nouveau cadre institutionnel. En revanche, il a manifesté une grande mansuétude à l’égard des duvaliéristes et a fermé les yeux devant les nouvelles exactions des « macoutes ».. Une telle attitude politique conjuguée à la plus radicale incompétence en matière économique ont plongé Haïti — après trente ans d’effroyable dictature — dans le chaos et l’anarchie.
Le pays se retrouve ENCORE ruiné, écologiquement sinistré, survivant grâce à l’aide internationale. L’industrie est inexistante, l’agriculture suffit à peine à nourrir la population ; le taux d’analphabétisme demeure l’un des plus élevés du monde ; les maladies parasitaires continuent de faire des ravages dans une population exténuée, à bout. Et qui espère tout de la démocratie : le fin des injustices et le début du développement.
L’instauration d’un régime représentatif à toujours été perçue comme une garantie de moralisation politique, comme un gage de pacification, d’élimination des extrémismes et de la violence. Ce sont, fondamentalement, ces vertus d’apaisement qui, dans toute l’Amérique du Sud, confèrent aujourd’hui à la démocratisation son caractère de nouvelle utopie, de mythe messianique.
Mais la démocratie, dans l’environnement économique mondial d’aujourd’hui, dispose-t-elle des moyens de mettre fin à la pauvreté massive et aux injustices fondamentales du sous-développement ?
Que peut-elle dans des pays paralysés par leur dette extérieure, impuissants à fixer les prix de leurs produits d’exportation, dépendants des fluctuations du dollar et des investissements étrangers ?
Peut-elle exister sans la croissance ?
Et la croissance, dans un pays du Sud, ne dépend-elle pas, dans une grande mesure, des politiques économiques du Nord ?
Quelle aide économique massive les grands Etats du Nord sont-ils prêts à apporter aux pays du Sud afin de consolider les trop fragiles démocraties ?
Grande est la responsabilité des pays riches. Ne pas le reconnaître et pleurer sur les malheurs et les infortunes des démocraties du tiers-monde relève de l’hypocrisie politique.
La prochaine récession dans les pays du Nord va entraîner, dans le tiers-monde, des contre-coups économiques, sociaux et politiques. La crise de 1929 avait été suivie, en Amérique latine, par de très fortes secousses politiques. Les coups d’Etat militaires (à Cuba, au Chili, en Argentine, au Brésil…) et les grands soulèvements populaires (celui, en 1932, du Salvador, fit trente mille morts) se multiplièrent pendant toute une décennie.
Aujourd’hui, l’avenir de la démocratie à Haïti, aux Philippines, en Corée du Sud — mais aussi en Argentine, au Pérou ou au Brésil — dépend pour beaucoup de l’attitude des pays occidentaux, en premier lieu des Etats-Unis. Sinon, sous le choc de l’actuelle crise, les privilégiés locaux (bourgeoisies liées aux secteurs de l’exportation, oligarchies latifundiaires, etc.) auront tendance à profiter de l’effondrement des classes moyennes pour confisquer à leur profit — avec l’aide des forces armées — les nouvelles démocraties. Ils pourront alors fixer des normes politiques d’apparence démocratique leur permettant d’exercer, en toute circonstance, le pouvoir, et de continuer à tirer bénéfice des quelques rares secteurs économiques encore rentables. Ils condamneront, fort démocratiquement, toute revendication — même massive — des citoyens.
Ce genre de « démocratie » a été, jusqu’aux années 60, très en vogue en Amérique latine (c’est contre un régime de ce type — présidé par Batista — que Fidel Castro prit les armes en 1956), et c’est ce modèle qu’ont récusé les guérillas latino-américaines dans les années 60 ou encore aujourd’hui, par exemple au Guatemala ou au Salvador.
Pour s’assurer leur maintien aux commandes, les élites n’hésitent pas ainsi à recourir aux manipulations « mystiques ». Les élections étant le seul moment où elles se rendent compte des maux qui rongent le peuple, elles vont puiser dans le sacré les réponses politiques qu’elles n’ont pas. L’arbitraire ? La loi de la jungle ? Les inégalités ? Naturels. L’oppression ? Volonté du sort. « Le pouvoir se mange en entier », dit-on. Qui détient le pouvoir a donc tous les droits. Les autres n’ont qu’à se soumettre, obéir et se montrer dociles.
Mais qui connaît la véritable histoire de la « décennie noire » sait que le rapport de la police politique (DRS, ex-Sécurité militaire) avec les groupes terroristes de l’époque (Groupe islamiste armé, puis Groupe salafiste de prédication et de combat, qui donnera naissance en 2007 à Al-Qaida au Maghreb islamique) fut plus qu’ambigu et poreux… Ironie de l’histoire, c’est une recette éculée qui nous est donc servie aujourd’hui pour que les gouvernements étrangers ferment les yeux sur les violations des libertés syndicales et des droits humains dans le pays.
LA DÉMOCRATIE ENSEIGNE QU’AUCUN POUVOIR N’EST ABSOLU NI SACRÉ. IL EST CONSTRUCTION HUMAINE, DONC MUABLE PAR ESSENCE
Henry Beaucejour
@hbeaucejour