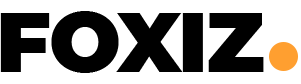Le blocage de la justice s’est transformé en un système dont la pièce maîtresse est l’existence d’une impunité réciproque garantie aux délinquants, ceux qui violent les droits des personnes, leur vie et leur corps, et ceux qui détournent l’argent de l’État.
(Jean-Claude Bajeux, « Post-scriptum : Le déblocage de la justice, un système d’impunité », 2011, p. 373)
Le problème de l’impunité en Haïti n’est ni accidentel ni secondaire, il renvoie à des dispositifs institutionnels et inconscients qui donnent à voir les difficultés de la société haïtienne à fonctionner comme une communauté de citoyens égaux dans leur rapport aux lois. De la sorte, l’impunité apparaît un phénomène courant, presque normal, il n’est pas facile de débusquer ses sources et ses mécanismes. Le cinéaste Arnold Antonin a déjà produit, sur la base de nombreux témoignages, deux films documentaires sur « le règne de l’impunité » en Haïti face aux crimes de masse de la dictature des Duvalier contre les gens de toutes catégories sociales. Nous aimerions montrer ici qu’à aborder le problème sur la longue durée des deux siècles d’indépendance, on peut découvrir que la résistance à la pratique de l’impunité est en même temps l’expression d’une plus grande capacité de s’indigner devant l’injustice, c’est-à-dire d’une plus grande conscience d’être sujet de droits. Elle est ainsi un processus (mais il y en a d’autres) par lequel se produit l’accès à une citoyenneté véritable. Nous commencerons par rappeler le contexte actuel du déficit de mémoire de la dictature, qui appelle une réflexion approfondie sur l’impunité. Puis nous reviendrons sur la pratique de l’impunité à travers le rappel des faits et de leur répétition, pour soumettre à discussion une proposition d’explication à partir de la nature du pouvoir politique en Haïti. Enfin, nous examinerons les pistes de sortie du cercle vicieux de l’impunité en examinant les rapports étroits qui existent entre justice et citoyenneté.
1. La dictature et le déficit de mémoire
On a beaucoup parlé de la dictature des Duvalier, mais l’on reconnaît qu’il y a une faible transmission de la mémoire des faits qui caractérisent cette dictature. Beaucoup de jeunes déclarent qu’ils ne comprennent pas pourquoi le pays parvient avec peine à entrer dans une ère de démocratie et de développement. De là, on finit par porter le soupçon sur l’insistance de certains groupes à dénoncer l’impunité des crimes de la dictature. Or il n’est pas inutile de rappeler sommairement les aspects fondamentaux de cette dictature. Tout d’abord, après les massacres de la journée du 26 avril 1963, pas moins de 500 personnes sont exécutées dans la même journée1.
Duvalier démontre qu’il a le contrôle absolu du pays ; il s’assure que toutes les institutions se mettent à son service. Ainsi l’Ordre des Jésuites au Grand séminaire et à l’institution de la Villa Manrese sera expulsé du pays plus tard en 1964, pour éviter toute critique morale et idéologique. De là, il se croit prêt à entamer les démarches pour la présidence à vie. Peu à peu, grâce au corps des Tontons macoutes, la terreur s’établit dans toutes les familles à travers villes et campagnes rurales.
En 1967, Duvalier se rend lui-même une nuit à la prison de Fort Dimanche et, assisté du chef des macoutes, Mme Max Adolphe, il passe par les armes 19 officiers de l’Armée sans aucune forme de procès au sens strict. On s’aperçoit bien que l’une des caractéristiques principales de la dictature c’est bien l’excès de violence2, c’est-à-dire un surplus de violence apparemment pour rien, mais dont elle a besoin pour détruire comme par avance toute potentialité de résistance, et c’est en dernière instance l’imaginaire même qu’il prétend mettre sous contrôle dans la société. De plus, à partir du moment où une famille ne peut même pas déclarer le décès d’un membre en prison, ou exécuté en pleine rue par un partisan du régime (militaire et macoute), et qu’on assiste à plusieurs morts sans sépulture, c’est toute une tâche d’imposition de l’oubli des crimes de la dictature qui est entreprise. Les victimes meurent donc deux fois.
Si le régime de Duvalier représente un sommet dans l’organisation de la terreur (divers massacres3 à Jérémie, Thiotte et Mapou, Cazale, Ouanaminthe, des disparitions, des tortures régulières dans les prisons et la dégradation de la condition d’êtres humains spécialement à Fort Dimanche), la liste des victimes du pouvoir politique est immense depuis les deux derniers siècles de l’indépendance, pendant que l’impunité des crimes revêt un caractère systématique. Qu’on remonte en effet au régime de Faustin Soulouque ou à celui de Salomon, ou plus tard à la fin du XIXe siècle avec l’affaire Coicou en 1908 (l’exécution des trois frères Coicou et sept de leurs compagnons), ou à l’exécution des prisonniers sous le gouvernement de Vilbrun Guillaume Sam en 1915, on a constamment affaire à une violence politique récurrente, répétitive, toujours déjà renvoyée à l’oubli. Il y a eu pourtant quelques tentatives de sortir du cercle de l’impunité quand des procès ont été intentés. Ainsi dans le cas du procès dit de la Consolidation (1903-1904), quatre personnalités importantes sont reconnues coupables, elles sont jugées, condamnées, mais vite graciées, et le comble c’est que trois d’entre elles sont devenues présidents de la république. Comme si plus on est proche du pouvoir, plus on est loin des sanctions pour ses crimes. Dans l’Affaire Coicou, dont Pierre Richard Narcisse (2010) nous a égrené le chapelet des péripéties du procès qui a eu lieu quatre ans après l’assassinat des frères, celui qui était coupable de les avoir dénoncés, a été effectivement jugé et condamné à mort. Mais sa peine a été commuée en emprisonnement à vie, c’était pour qu’il soit bien vite gracié. On observe la même tendance avec le procès des assassins des prisonniers exécutés en 1915 ; ils sont jugés et condamnés, puis amnistiés par le gouvernement de Sudre Dartiguenave en 1917. L’impunité est donc bien un phénomène récurrent.
À observer la vie politique en Haïti depuis les trente dernières années, l’impunité des crimes de la dictature rend possible une insécurité quasi-permanente. De nombreuses personnalités sont exécutées en pleine rue, ou chez elles, ou à leur bureau. Nous pouvons penser au cas emblématique de l’assassinat du célèbre journaliste du mouvement démocratique, Jean Dominique, dont le procès est toujours en suspens depuis 17 ans ; aux massacres (une centaine de personnes faisant la queue pour aller voter au bureau de la ruelle Vaillant en novembre 1987, 300 paysans à Jean Rabel, puis régulièrement lors de règlements de compte dans les bidonvilles de Martissant, de Raboteau, de Cité Soleil…) ; aux kidnappings en série ; aux prisons qui s’ouvrent et laissent régulièrement s’échapper des centaines de détenus, et j’en passe.
2. De la nature du pouvoir politique en Haïti
La raison ne peut pas cependant abdiquer devant une telle situation marquée par l’oubli et l’impunité des crimes procédant du pouvoir politique. Je vais essayer de proposer quelques éléments d’explication sociologique comme en prolongement des travaux du regretté Gérard Barthélemy et du sociologue Jean Casimir (2001). Ces travaux ont tenté de montrer comment les paysans, majoritaires pendant deux siècles dans la population haïtienne, se sont constitué un monde à part, c’est-à-dire un « pays en dehors » de l’État, et qui s’évertue à fuir l’État dans une sorte de continuité du marronnage pratiqué régulièrement par les esclaves. De la sorte, deux sociétés semblent coexister en Haïti. C’est également en ces termes qu’auparavant Jacquelin Dépeignes décrivait le double système juridique à l’œuvre dans le pays. Il existe un système urbain-officiel juridique et culturel (avec ses lois écrites, son droit formel, sa langue française) face au monde paysan (qui dispose d’un droit informel, de l’oralité et de la langue créole)4. La propriété indivise (ou propriété appartenant aux ancêtres, qui ne peut être séparée entre divers héritiers), le placage et la preuve de filiation par le groupe en l’absence d’état civil sont considérés par exemple comme relevant du droit informel. Mais on aurait tort de parler d’un pluralisme juridique. Il est question plutôt d’une hiérarchisation des deux systèmes formel et informel au profit du formel. Mais tel n’a pas été exactement le point de vue de Barthélemy (1989), celui-ci est plutôt porté à penser qu’on est en présence d’une stratégie délibérée de la paysannerie haïtienne pour tourner le dos à l’État, et produire finalement un type de société contre l’État, au sens de Pierre Clastres (1974). Cette perspective, Barthélemy la théorise autour de l’opposition conceptuelle créole/bossale, le bossale étant encore une rémanence des esclaves récemment arrivés dans l’île, pendant que les créoles sont considérés comme les traditionnels dirigeants de l’État. Cette opposition créole/ bossale s’éclaire bien si elle est rapportée de manière explicite à la problématique de la citoyenneté. Dès les premières années qui suivent l’insurrection générale des esclaves, en 1791, apparaît une opposition fondamentale entre citoyens-soldats et Africains cultivateurs, bien mise en lumière par les travaux de Carolyn Fick (2014), et de Vertus Saint Louis (2004). On se demandait comment designer les anciens esclaves émancipés. Le terme de citoyen paraissait impropre, puisqu’il s’appliquait avant tout au Français, on allait donc faire des esclaves émancipés des « cultivateurs » en opposition aux « soldats-citoyens », car c’est alors par l’Armée que pouvait se produire une mobilité sociale. Carolyn Fick (2006, p. 161) peut même déduire qu’« à certains égards il est possible de percevoir dans l’attribution des termes citoyen et Africain une reconduction parmi les nouveaux libres de l’ancienne hiérarchie sociale d’avant l’abolition, les cultivateurs étant placés au bas de l’échelle sociale. »
Dans tous les cas, le droit informel dont dispose ce que Barthélemy (1989) appelle « le pays en dehors » conduit le paysan à se construire un monde propre, à s’en remettre en règle générale, lors des conflits, au système de croyances dans les divinités du vodou, donc à un ordre extranaturel. Là où des injustices sont reconnues, les mesures de rétorsion sont mises en œuvre à travers des pratiques magiques et sorcellaires. Ces mesures ont une automaticité qui provient d’un rééquilibre qu’on croit rechercher dans la nature. Mais certains actes répréhensibles ou interdits sont, dit-on par exemple, liés à des transgressions provoquées par des mauvais « esprits » logés dans l’individu. Ce qui suppose que nous ne serions pas en présence d’un processus de subjectivation, ni d’une intériorisation individuelle de la culpabilité, donc de la responsabilité individuelle. Certains leaders du vodou ont tendance à parler d’une « justice nocturne » qui serait une forme de justice propre aux campagnes rurales, et dont la zombification comme phénomène relevant à la fois de l’imaginaire et du réel, serait un des éléments emblématiques. On a plutôt l’impression qu’ils ne se doutent pas assez que le concept de « justice nocturne » est un oxymore, et qu’il est donc un déni de justice, car on conçoit difficilement une forme de justice qui s’exerce dans le secret et hors de toute possibilité de défense de l’accusé. La méfiance vis-à-vis du système urbain-officiel s’explique cependant par une difficulté particulière à affronter sa justice, qui s’enracine dans la politique linguistique en Haïti en vigueur depuis l’indépendance.
Certes depuis 1987, il y a eu un changement notoire avec la reconnaissance dans la Constitution de deux langues officielles : le français et le créole, le créole étant considéré comme langue nationale puisqu’il existe une majorité d’Haïtiens qui sont des locuteurs unilingues en créole. On peut aisément imaginer l’obstacle que représente la langue dans le système de justice en Haïti. Comment s’adresser à un système qui ne parle pas la langue du justiciable ? Comment se présenter devant des juges qui exhibent des textes de loi en français ? Certes, le paysan n’a jamais cessé de s’exprimer et de demander justice quand ses droits sont lésés : vol de ses terres, réclamations pour les prix des produits agricoles d’exportation (café, coton, etc.). Il reste que les obstacles sont incommensurables. Dans un tel contexte, la quête de justice dans les campagnes rurales s’effectue par le biais de pratiques vindicatives qui contournent le recours à l’État ; mais quand n’apparaît plus aucun recours, on se contente d’attendre de la nature qu’elle rétablisse la justice. C’est le même sentiment d’impuissance qui conduit aux lynchages en pleine rue de présumés assassins, de voleurs, de violeurs ou de présumés sorciers.
En quoi donc maintenant cette situation que nous décrivons concerne-t-elle la problématique de l’impunité ? Pour répondre à cette interrogation, il est nécessaire de prendre distance par rapport à la réalité empirique, et ne pas s’enfermer dans cette réalité telle qu’elle nous apparaît. Autrement dit, il nous faut nous méfier des évidences et chercher à reconstruire sur une base critique les faits et leurs représentations. C’est en effet « apparemment » que le pays dit « en dehors » forme une société à part, que donc Haïti connaîtrait la coexistence de deux systèmes. Si le pouvoir politique est justement un dispositif séparateur des deux systèmes, il parvient paradoxalement à les articuler l’un à l’autre sur une base hiérarchique. Autrement dit, le pouvoir politique fonde, légitime et reconduit la vieille division du pays en deux systèmes hiérarchisés, avec la domination accordée au système urbain-officiel disposant des lois écrites auxquelles ne peut accéder l’analphabète unilingue parlant créole. Ainsi accéder à la justice c’est comme grimper un mât de cocagne. Réclamer le jugement et la sanction des crimes commis par les gouvernants, ou des massacres, dont par exemple des paysans de Jean Rabel ont été victimes, c’est lancer des cris dans le désert. Ce n’est donc pas une attitude d’indifférence par rapport aux institutions de la justice, ce n’est pas non plus que « le pays en dehors » soit enfermé dans un imaginaire vodou à toutes occasions, ce que nous signalons ici c’est avant tout l’obstacle structurel que rencontrent les couches sociales du « pays en dehors » pour obtenir justice et même pour accéder à ces institutions. Non seulement elles ne participent pas à la production des lois, mais aussi elles n’ont pas les moyens d’en être valablement informé, puisqu’au départ les droits linguistiques n’ont pas été reconnus. Certes depuis 1987, des changements se sont opérés depuis le cri du « tout moun se moun » qui a entre autres comme effet celui de la reconnaissance du créole comme langue officielle à côté du français et comme langue nationale. Mais tout reste à faire au niveau de l’aménagement linguistique pour que de nouvelles pratiques s’instaurent en fonction d’une promotion réelle de l’égalité devant la loi. C’est depuis une telle situation que je propose de penser l’impunité, dans la mesure où nous ne sommes pas en présence d’un problème ponctuel, survenu de manière récente, mais d’une longue pratique qui caractérise la vie politique du pays, comme je l’ai souligné plus haut. Celle-ci connaît son acmé avec la période de la dictature duvaliériste et les difficultés de sortie de cette période. Poser ainsi le problème de l’impunité, c’est sortir d’une vision uniquement morale de l’impunité et tenter de l’appréhender dans les mécanismes internes de fonctionnement de la société haïtienne.
On entend souvent se plaindre des accrocs à l’État de droit en Haïti, alors que les éléments essentiels de l’État de droit viennent tout simplement à manquer : pas de force de généralité de la loi, pas d’égalité devant la loi, pas de participation réelle à la production des lois. Tout semble fait en Haïti pour que la généralité de la loi ne soit pas reconnue comme telle : ministres, députés, sénateurs, hauts fonctionnaires, directeurs généraux… tentent de se soustraire à la justice et préfèrent ou déclarent être justiciables seulement devant le législatif, c’est-à-dire devant la cour supérieure de justice (qu’on n’a jamais vu fonctionner)5, comme si le judiciaire ne pouvait concerner que le tout-venant sans nom, c’est-à-dire le subalterne. Mais il faudrait se demander à quel niveau le judiciaire le concerne vraiment, car s’il porte le nom de citoyen, il s’agit bien d’une « citoyenneté nue » (au sens de Giorgio Agamben), qui ne saurait accéder à la condition de sujet politique. Certes, nulle part n’existe un système démocratique totalement effectif, dans la mesure où la citoyenneté est à tout instant une conquête. Dans le cas d’Haïti, cependant, tout se passe comme si des couches sociales entières semblent être placées sous un État d’exception. En revanche, on est autorisé à lire toute l’histoire d’Haïti comme des résistances à la domination de gouvernements despotiques, ou comme des poussées violentes contre les inégalités sociales6. On pressent bien ainsi à quoi sert en dernière instance l’impunité : tout se passe comme si elle était la meilleure couverture pour la reproduction des rapports sociaux dans lesquels une infime minorité se taille la part du lion, la part la plus importante du PIB (c’est-à-dire que 5 % de la population dispose en Haïti de 50 % des revenus). Le système inégalitaire d’Haïti se nourrit obligatoirement des pratiques d’impunité. Une étude approfondie de la population carcérale en Haïti (dans la capitale et les provinces) fera sans doute découvrir que les représentants des couches populaires sont majoritaires dans les prisons, celles-ci paraissant aussi comme des lieux d’expression des inégalités sociales. Et il faut de temps à autre des morts pour que l’information sous forme de fuite arrive jusqu’à nous et que, l’espace de quelques jours on fasse semblant de s’en scandaliser.
Du côté du pouvoir politique, la conscience que la loi n’a pas de force de généralité conduit à voir paradoxalement dans les institutions de justice des lieux de protection, des boucliers qui servent à éviter d’être soumis à des procès et à des sanctions. Chaque nouveau gouvernement s’arrange pour favoriser l’impunité des crimes (politiques ou économiques) perpétrés par son prédécesseur, en espérant ainsi un effet de circularité de cette impunité. L’immunité est le maître mot de cette pratique. C’est sans doute l’une des raisons de l’avalanche de candidats aux récentes élections législatives et présidentielles en 2015, ou à des postes qui consacrent une position de « chef ». Si l’impunité prend à ce point des allures de normalité, le système de justice est facilement perçu comme un système qui n’aura de valeur qu’idéologique7, au sens où le pouvoir politique peut s’en emparer et l’instrumentaliser en fonction de ses besoins. À la limite, la justice devient de part en part parodique. Puisqu’elle ignore de fait le principe de l’égalité de tous sans exception devant la loi…
3. Justice et citoyenneté
Il ne s’agit pas ici de faire de la justice la réponse à la violence du crime, comme si on pouvait aboutir ainsi à une société sans violence, sans contradiction et sans division ; il ne s’agit pas non plus de viser à une réparation de l’équilibre de la société ébranlé par le crime. On serait alors subrepticement en train de glisser vers une pratique de vengeance qui chercherait à faire souffrir à son tour le criminel pour apaiser les souffrances des victimes et les inquiétudes sociales. Il y a, dans la justice, un processus qui consiste « à dire le droit »8, comme le soutient Paul Ricœur. C’est, explique-t-il, une éducation de l’opinion publique qui est ainsi faite à travers la reconnaissance publique de l’offense. Le procès public donne lieu à l’expression publique d’une indignation devant le crime, et donc à une empathie avec les victimes. Dans la condamnation officielle du crime, que prononce la justice lors du procès, on assiste à « une réaffirmation de l’égalité de principe entre les personnes ». En somme, si la citoyenneté n’est pas un état assimilable à la nationalité, à l’appartenance à un État, la revendication des droits à la participation à la vie politique (en quoi consiste la citoyenneté) est un mouvement qu’il faut sans cesse initier, c’est dire qu’elle est une conquête permanente9. Bien plus, la citoyenneté ne semble vraiment exister que dans l’acte de cette revendication de droits, qui correspond à une coopération, à la formation continue d’une communauté d’égaux. « Le cœur de la citoyenneté, écrit justement Habermas, est constitué par les droits politiques de participation et d’expression » (1998, p. 74). La publicité qui est supposée faite sur l’offense subie par les victimes d’actes criminels rend compte de la propension à la création de comités Vérité et réconciliation dans certains pays (et ils sont nombreux). On sait que ces comités peuvent être parfois instrumentalisés par la communauté internationale ou par des gouvernements de transition pour sauvegarder la continuité de l’État et donc laisser, chemin faisant, les crimes impunis. Mais déjà on peut déceler avec ces comités la possibilité de « dire la violence », ce qui représente un pas considérable dans l’effort pour rétablir une mémoire qui reconnaisse les droits des victimes.
Dans le cas d’Haïti, en transition démocratique depuis trois décennies, les luttes pour la Vérité sur les crimes de la dictature sont encore à l’ordre du jour. Une commission de Vérité et réconciliation a été établie sur les crimes perpétrés lors du coup d’État militaire de 1991 à 1994, mais les résultats n’ont pas été publiés ; la tentative de reprendre la tristement célèbre prison dite Fort dimanche où ont péri sans procès et sous la torture plusieurs milliers d’Haïtiens, s’est soldée le 26 avril 1986 (anniversaire du massacre de 500 personnes par le dictateur François Duvalier) par une fusillade qui a causé la mort de 9 manifestants. Des associations pour le devoir de mémoire sont à pied d’œuvre pour faire connaître la vérité sur les crimes de la dictature dans la capitale, les provinces et les campagnes rurales. On doit signaler que plusieurs associations de droits humains, des mouvements de femmes, et divers acteurs de la société civile ne cessent de s’exprimer contre l’impunité. Cependant, il s’avère encore nécessaire que ces luttes ne restent pas dans des cercles trop fermés et qu’elles parviennent à toucher toute la population dans la capitale comme dans les provinces et les communes rurales.
Mais on dénote un immense écart entre le niveau des luttes contre l’impunité en Haïti et celui qu’on peut observer par exemple en Argentine ou au Chili. C’est que justement les résistances à entreprendre le travail de la mémoire sont importantes en Haïti, compte tenu du fonctionnement traditionnel du système de justice, tel que nous avons tenté plus haut de saisir les mécanismes. Il y a, il est vrai, l’expatriation (à travers une fuite) d’une partie importante de la classe moyenne (avocats, ingénieurs, techniciens, médecins, professeurs, fonctionnaires, commerçants, etc.) qui ne peut donc pas faire transmission à la jeunesse de son expérience de la dictature. De la sorte, certains étudiants (18-25 ans) par exemple ne cessent de s’interroger sur les événements des années 1957-1986. Le déficit de mémoire des crimes de la dictature s’explique aussi par l’absence de repères matériels, de centres de documentation ou de recherches, de musées, et de débats autour des crimes de la dictature.
Est-ce que cependant l’oubli n’a pas quelque vertu d’apaisement des pulsions de vengeance, d’incitation à la réconciliation nationale ou même d’ouverture à l’avenir ? C’est ainsi une opinion très répandue qui présuppose que les pratiques de justice exacerbent les conflits et maintiennent l’individu comme la collectivité entièrement tournés vers le passé. Il se trouve pourtant que les familles vivent un trauma permanent, car cet oubli est extrêmement difficile pour celles qui ont des membres disparus en prison ou exécutés sur ordre du dictateur. Dans la mesure où la victime fait partie de soi, c’est vivre comme déjà mort, car alors l’on ne parvient pas à faire le deuil et donc à symboliser la perte du membre de sa famille. On ne voit pas en effet de quelle manière vivre comme si la victime, partie de soi, n’avait jamais existé. Il y a un problème beaucoup plus grave qu’il convient de soulever à propos de la volonté d’oubli des crimes, c’est celui de la dépolitisation des conflits qui semble à la base de certaines commissions dites de vérité ou de réconciliation nationale. Au fond, ce que l’évitement de la justice pénale produit comme effet, c’est ce qu’on peut appeler avec Sandrine Lefranc (2014) le déni des « causes structurelles de la violence politique ».
Au niveau plus superficiel, c’est-à-dire plus immédiatement observable, on peut voir que l’insécurité connaît en conséquence une montée exponentielle dans la mesure où la justice paraît être un système sans arrêtes, ou sans colonne vertébrale (plus je me rapproche du pouvoir, plus je suis assuré de l’immunité, parce que j’ai toutes les chances de ne pas avoir à subir les rigueurs de la justice pénale). Certes, avec le triomphe actuel du néo-libéralisme10, les États nationaux perdant toute consistance, les institutions internationales se substituant à leur pouvoir, le plus important c’est le business, les affaires qui vont reléguer la problématique de justice à l’arrière-plan comme ringarde et occasion de perte de temps. De plus, l’État n’ayant plus le monopole de la violence légitime, l’insécurité est devenue diffuse et rendue plus difficile à cerner. Un appui de la communauté internationale pour mettre en avant la justice est souvent recherché, mais c’est toujours grâce au mouvement de sensibilisation acharnée de l’opinion publique qu’on parvient à certains résultats satisfaisants. Justement, la lutte contre l’impunité soutient l’exigence de reconnaître – même après la mort des bourreaux – les droits des victimes, c’est ainsi une manière de restaurer ces dernières dans leur dignité, de leur offrir une sépulture digne et de les réintégrer dans notre lignée. En faisant des victimes des morts sans sépulture, la dictature visait à les soustraire à la condition d’être humain et de citoyen. Les témoignages sur l’impunité, tels ceux du cinéaste Arnold Antonin, en particulier dans son film sur Jacques Stephen Alexis, démontrent comment les incessantes réclamations venues des masses restent sans réponse de la part de l’État. Mais le film lui-même, intitulé Morts sans sépulture, est déjà un appel au devoir de mémoire et une restauration de la victime dans ses droits et dans sa dignité de citoyen.
Cette lutte devrait s’élargir à l’échelle de l’humanité tout entière, car plus on s’enferme dans l’étroite problématique nationale, moins on a la possibilité de garder même la mémoire des victimes. Le combat pour une justice pénale internationale doit être sous ce rapport vivement renforcé, pourvu que cette dernière ne soit pas focalisée uniquement sur les pays de la périphérie des grandes puissances. C’est pour cela que le partenariat avec les groupes de pression pour les victimes des pouvoirs dictatoriaux, par exemple en Argentine, au Brésil, au Chili ou en République Dominicaine, peut soutenir l’action d’éducation, d’information et de pression publique que suppose – dans le contexte de la mondialisation – la lutte contre l’impunité ; en focalisant l’attention sur sa portée universelle, c’est cette action elle-même qui favorise la construction permanente de la citoyenneté. La critique de la torture, des camps de dégradation de la condition humaine (comme Fort Dimanche), des exécutions sommaires, des arrestations sans jugement, des bâillonnements de la presse, est maintenue vivace, et conduit à une interrogation sur les causes structurelles de la violence politique, mais aussi sur les viols, les pratiques justifiant la domination masculine, et la maltraitance sur les enfants. Dans un remarquable travail sur Violences et ordre social en Haïti, Roberson Edouard (2013) propose justement la nécessité d’accompagner la lutte contre l’impunité par des mesures concrètes, par exemple la poursuite de hauts fonctionnaires en conflit avec la loi, le contrôle et la réduction des compagnies privées de sécurité, ainsi que toute une série de mesures qui portent sur la violence dans la vie quotidienne.
En somme, on peut sans exagérer dire que la lutte contre l’impunité un effet émancipateur. Cette lutte suppose en effet qu’on entre dans un processus de subjectivation en prenant conscience de ses droits et en reconnaissant en même temps les droits de tous les citoyens à qui tout droit a été nié. Cette perspective transcende tout penchant vers la victimisation. En revendiquant les droits des victimes de la dictature, on contribue à un processus de sortie de la hiérarchisation sociale et culturelle qui est la marque de la société haïtienne, et donc en même temps un processus de construction de la nation comme communauté politique, faite de citoyens égaux qui ont droit à la liberté et à la participation à la vie politique, la dictature étant justement le déni de ces droits fondamentaux.
Bibliography
Bajeux, J.C. (2011), « Post-scriptum : le déblocage de l’injustice, un système d’impunité », dans B. Diederich, Le prix du sang, Tome II. Jean-Claude Duvalier, 1971‑1986, L’Héritier, Port-au-Prince, Imprimerie Deschamps.
Barthélemy, G. (1989). Le Pays en dehors, Port-au-Prince, Editions Deschamps.
Casimir, J. (2001). La culture opprimée, Port-au-Prince, édité par l’auteur.
Cénatus, B. et al. (dir.) (2016). Haïti : de la dictature à la démocratie ?, Montréal, Mémoire d’encrier.
Clastres, P. (1974.) La société contre l’Etat, Paris, Éditions de Minuit.
Dardot, P. et C. Laval. (2001). La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, la Découverte.
Despeignes, J. (1976). Le droit informel haïtien, Paris, Presses universitaires de France.
Diederich, B. (2005). Le prix du sang, Tome I, La résistance du peuple haïtien à la tyrannie, Francois Duvalier (1957‑1971), traduit de l’anglais par Jean Claude Bajeux, et Prologue de Jean-Claude Bajeux : « la Chute », Port-au-Prince, éditions Antilia, Centre œcuménique des Droits Humains et éditions Deschamps.
Diederich, B. (2011). Le prix du sang, Tome II. Jean-Claude Duvalier, 1971‑1986, L’Héritier, Port-au-Prince, Imprimerie Deschamps.
Dorval, M. (2003). « La place de la loi et des coutumes en Haïti », dans G. Paisant, De la place de la coutume dans l’ordre juridique haïtien, Presses universitaires de Grenoble, p. 8‑104.
Fick, C. (2006). « La révolution haïtienne dans l’Atlantique révolutionnaire », dans F. Midy (dir.), Mémoire de révolution d’esclave, Montréal, CIDIHCA, p. 145‑177.
Fick, C. (2014). Haïti, naissance d’une nation. La révolution de St Domingue vue d’en bas, Montréal, CIDIHCA.
Garapon, A. et al. (dir.) (2001). Et ce sera justice. Punir en démocratie, Paris, Odile Jacob.
Gilles, A. (2008). État, conflit et violence en Haïti : une étude sur la région de l’Artibonite, Port-au-Prince, Communication Plus.
Habermas, J. (1998). L’Intégration républicaine. Essai de théorie politique, Paris, Fayard.
Hector, M. (2006). Crises et mouvements populaires en Haïti, 2e Édition, Montréal, CIDIHCA.
Hurbon, L. (2016). « Les dictatures ou la suppression du politique », dans Cénatus, B. et al. (dir.), Haïti : de la dictature à la démocratie ?, Montréal, Mémoire d’encrier.
Lefranc, S. (2002). Les politiques du pardon, Paris, Presses universitaires de France.
Lefranc, S. (2014). « Pleurer ensemble restaure-t-il le lien social ? Les commissions de vérité “Tribunaux des larmes” de l’après-conflit », dans R. Nollez-Goldbach et J. Saada (dir.), La justice pénale internationale face aux crimes de masse. Approches critiques, Paris, éditions Pedone.
Mathon, A. et A. Turnier, (1985). La société des baïonnettes, Port-au-Prince, Imprimerie Le Natal.
Michel, G. (1999). Debout les morts (tomes I et II), Port-au-Prince, Imprimerie Le Natal.
Narcisse, P.R. (2010). L’Affaire Coicou, Dans L’ombre d’une exécution, New York, édité par l’auteur.
Oriol, R. B. (2014). Plaidoyer pour une éthique et une culture des droits linguistiques en Haïti, Montréal et Port-au-Prince, CEDH (Centre œcuménique des droits humains) et CIDIHCA.
Paisant, G. (dir.) (2003). De la place de la coutume dans l’ordre juridique haïtien. Bilan et perspectives à la lumière du droit comparé, Presses universitaires de Grenoble. Pierre-Louis, P. (2003). « Le système juridique haïtien entre ordre étatique et ordre coutumier », dans G. Paisant, De la place de la coutume dans l’ordre juridique haïtien, Presses universitaires de Grenoble, p. 105‑116.
Rancière, J. (2005), La haine de la démocratie, Paris, Édition de la Fabrique.
Ricœur, P. (1995). Le juste, Paris, éditions Esprit.
Roberson, E. (2013). Violence et ordre social en Haïti. Essai sur le vivre ensemble dans une société postcoloniale, Montréal, Presses de l’Université du Québec.
Saint Louis, V. (2004). Aux origines du drame d’Haïti. Droit et commerce maritime (1794‑1806), Port-au-Prince, Bibliothèque nationale, L’Imprimeur.
Salas, D. (2004). « Les enfants d’Orphée », dans R. Verdier (dir.), La Vengeance. Le face-à-face victimes/agresseur, Paris, Autrement, p. 209‑221.
Sen, A. (2010). L’idée de justice, Paris, Flammarion.
Soyinka, W. (2005). Climat de peur, Paris, Actes Sud.
Turnier, A. (2009). Quand la nation demande des comptes, Port-au-Prince, édité par l’auteur.
Notes
1 Concernant le 26 avril 1963, Diederich écrit : « 26 avril 1963 reste le jour qui caractérise jusqu’à la fin le régime Duvalier : pouvoir absolu, terreur absolue. Plus de 60 officiers mis à la retraite par Duvalier furent sommairement passés par les armes sans autre forme de procès, ainsi qu’un nombre indéterminé de civils, y compris femmes, vieillards et enfants. » (2011, p. 72‑73)
2 Sur l’extrême violence, voir les réflexions de E. Balibar (2010, p. 416). Également notre contribution « Les dictatures ou la suppression du politique » (Hurbon, 2016).
3 Sur les massacres perpétrés par Duvalier à Thiote, à Jérémie, voir encore le tome I de Diederich, B. traduit par J.C. Bajeux (2005). Il convient également de rappeler les vols de l’argent public par Michelle Benett Duvalier qui s’élèvent à près de 100 millions de $US (soit 94 603 083 $US) d’après les données du ministère de la Justice en 1987, recueillies par Diederich (2011, p. 378). Le détournement des fonds publics par la famille Duvalier est incommensurable, le procès est toujours en cours.
4 Voir Dépeignes (1976, p. 87‑104) qui part de l’hypothèse que la société haïtienne est ambivalente avec ses deux systèmes juridiques, formel et informel. Voir les critiques de cette perspective par Pierre-Louis (2003) et Dorval (2003).
5 J’entends encore souvent des déclarations sur l’immunité des ministres, de hauts fonctionnaires qui demeureraient passibles de la haute cour de justice même quand ils ne sont plus en poste. Ces déclarations passent sans être contredites par certains journalistes. Or l’article 186 de la Constitution (1987) est très clair et n’induit aucune confusion, il s’agit de crimes ou de délits commis « dans l’exercice de leurs fonctions ». Il suffit de se référer à l’article 189‑1 qui souligne des peines comme destitution, déchéance, privation de droit… J’ai trouvé curieux qu’on ne perçoive pas assez qu’en Haïti, une fois qu’on a une haute fonction, on croit faire partie d’une noblesse. Certains postes sont alors recherchés comme des « boucliers » contre la justice. Il est par exemple faux qu’un candidat à un poste électif dispose automatiquement d’une immunité. L’article 237 du décret électoral de 2015 est invoqué pour cela, or il s’agit d’éviter au candidat d’être « l’objet de mesures privatives de liberté… » et cela pendant la campagne électorale. Mais tous, qu’ils soient candidats ou anciens ministres ou fonctionnaires sont en principe des citoyens ordinaires passibles du droit commun. En France, aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, au Pérou, partout anciens ministres et anciens présidents répondent aux interpellations de la justice. Sauf en Haïti ?
6 Ce sont les cas des révoltes conduites par des leaders comme Goman dans la Grande Anse, Acaau dans le Sud au XIXe siècle et plus tard sous l’occupation américaine avec entre autres Charlemagne Peralte. Voir pour de plus amples informations l’ouvrage de Michel Hector (2006).
7 Il est clair que s’est imposée en Haïti depuis la chute de la dictature en 1986 la nécessité d’une réforme de la justice. Trente ans après, le problème est toujours à l’ordre du jour. En revanche, on ne saurait se rabattre sur la seule réforme institutionnelle, comme le suggère Amartya (2010, p. 115‑116). Les institutions ne sont pas l’incarnation de la justice, même si elles peuvent faire avancer la justice ; « le fondamentalisme institutionnel » peut empêcher de reconnaître « la complexité des sociétés » et de prendre en compte sur une base critique les problèmes de fond qui agitent le pays.
8 Ricœur explique que la performativité de la parole qui dit le droit réside non pas simplement dans le suspens de la vengeance, mais elle promeut la reconnaissance publique de la victime comme être offensé et humilié, donc rétablit sa dignité (1995, p. 199). Cette publicité, ajoute-t-il, est « une éducation à l’équité », et « le premier seuil de cette éducation est l’indignation » devant « le spectacle de la personne humiliée » (p. 200).
9 « Le processus démocratique est le processus de cette remise en jeu perpétuelle, de cette invention de formes de subjectivation qui contrarient la perpétuelle privatisation de la vie publique. » (Rancière, 2005, p. 70)
10 Voir Dardot et Laval (2014).
Author
Laënnec Hurbon
CNRS et Université d’État d’Haïti