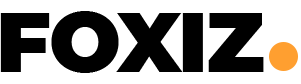L’étude du thème de la violence en Haïti et dans la Caraïbe soulève quelques difficultés de fond : d’un côté, il semble renvoyer à un problème qui relève de l’histoire elle-même de la région de la Caraïbe en tant qu’elle est marquée par le génocide indien, la traite, l’esclavage et la colonisation, mais alors le thème de la violence cesse d’être un discriminant, il devient trop vague et trop vaste ; de l’autre, s’il est donné pour un problème conjoncturel, il n’a plus de pertinence, car l’insécurité frappe également la plupart des grandes villes des pays industrialisés. On peut même se demander si cette insécurité qui se généralise n’est pas liée au processus en cours de mondialisation ou à des opérations de déstabilisation radicale du monde. Dans tous les cas, on aurait de faibles chances en partant du thème de la violence d’avancer dans une compréhension profonde de l’évolution des sociétés de la Caraïbe. Il y a plus, la violence aurait même un caractère naturel surtout là où, comme en Haïti, la pauvreté, la misère et l’absence d’éducation scolaire sont les marques principales de la société. Tout se passe comme si certains pays étaient naturellement prédisposés à la violence. Cette conception se défend d’être une position apparentée au racisme, bien au contraire, elle est même prête à avouer qu’elle est fondée sur une certaine tolérance, sur une reconnaissance de différences qui proviendraient de l’histoire elle-même et non de quelle qu’essence éternelle ou de pratiques inscrites dans les gènes. Quand par exemple on disait de l’Afrique noire qu’elle était encore dans une certaine proximité avec la nature et qu’en conséquence le règne de la violence y apparaissait normal, on n’avait aucune difficulté à mettre cette condition de proximité avec la nature sur le compte de l’histoire, comme Hegel le faisait dans ses cours sur La raison dans l’histoire.
Précisons cette question avec le cas d’Haïti : née dans la violence et de la violence, la société haïtienne semble elle-même intérioriser la violence comme presque son mode d’être ou son identité. En effet à chaque crise, à chaque carrefour de son histoire, revient en force le fantasme de la violence à travers le slogan de l’acte de l’indépendance : « koupé tèt, boulé kay » (« coupez les têtes, brûlez les cases »). Ce n’est point là chez les Haïtiens un attachement particulier à la violence ou une habitude de faire l’éloge de la violence. Celle-ci demeure à leurs yeux un mal, mais un mal qui ne peut être jugulé en retour que par la violence : « sé fè ki koupé fè », dit-on souvent, (littéralement « c’est avec le fer qu’on peut couper le fer »). Autrement dit, face à la violence on ne saurait directement opposer le travail de la raison, ou pour reprendre l’expression de Habermas la formation de la volonté discursive1. C’est dans les pays développés ou industrialisés que la violence apparaîtrait comme un épiphénomène, ou comme un reste qui attend sa résorption finale dans un système de civilisation en progrès constant2, alors que dans les pays du Sud la violence acquerrait aujourd’hui presqu’un statut de normalité ou de banalité à force de faire partie de la vie quotidienne. Certes, dans les grandes métropoles occidentales, les pays du Sud sont présents à travers les travailleurs immigrés, mais justement on a tendance à les considérer comme les nouveaux barbares dont la faible assimilation des codes du pays d’accueil peut être source de violence. Nous aimerions tenter d’analyser les pratiques de violence en Haïti en particulier, en mettant en rapport ces pratiques avec les rationalisations auxquelles elles donnent lieu dans le contexte de la démocratisation de la vie politique, mais aussi dans celui de la mondialisation. Nous serons ainsi conduits à porter l’interrogation sur le mode de réaction ou de définition du pouvoir face à la violence dans la région.
Dans un texte inspiré de la philosophie d’Eric Weil, Paul Ricoeur établit avec rigueur les présupposés de la problématique de la violence dans son rapport au langage et à la rationalité :
C’est pour un être qui parle, qui en parlant, poursuit le sens, pour un être qui a déjà fait un pas dans la discussion et qui sait quelque chose de la rationalité, que la violence fait problème, que la violence advient comme problème3.
En montrant comment le champ de la violence est coextensif à celui du langage, Paul Ricoeur parvient en même temps à soutenir que « c’est dans l’exercice normal de la politique que la conjonction primitive de la violence et du sens s’opère »4. Cette perspective ouvre pour nous les pistes d’un débat véritable sur la violence. Qu’il s’agisse en effet de ce qu’on appelle dans la presse des faits divers ou des pratiques ordinaires de la vie quotidienne censées appartenir à la sphère privée, Je thème de la violence renvoie toujours en dernière instance à un problème qui concerne l’humanité même de l’Homme (ce qui le distingue de la condition animale) et au pouvoir politique chargé en principe de favoriser l’émergence d’un « monde commun » (au sens de Hannah Arendt5 ) et d’empêcher ainsi l’instauration d’un ordre de la violence.
Nous nous proposons non pas de procéder à une énumération de faits déjà connus et rapportés par les organismes nationaux et internationaux de droits humains, mais de rechercher la logique de déploieraient de la violence en Haïti, prise qu’elle est dans les filets des interprétations données aux faits par le pouvoir comme par les différents acteurs de la vie politique et les victimes de la violence.
Ce qui frappe les observateurs et rend sans parole les victimes de la violence, c’est d’abord que la violence qui avait pour cible les opposants à la dictature de la famille Duvalier établie de 1957 à 1986, atteint aujourd’hui tout individu sans aucune distinction de son appartenance politique, de son quartier, de son âge ou de son sexe. Potentiellement l’insécurité est devenue la marque de la vie quotidienne, sans qu’on puisse l’attribuer de manière explicite à l’Etat. Cet aspect insolite de l’insécurité nous a conduit à tenter une première approche sociologique fondée sur la problématique de la dé-symbolisation du pouvoir qu’avait choisi de manière inconsciente le Président d’alors, René Préval (1995-2001) aux fins d’une dissimulation de ses pratiques absolutistes. Dans ce contexte, la violence était totalement déniée, banalisée, mise hors sujet dans les questions politiques6. Tel n’est pas le cas aujourd’hui avec le régime instauré par Aristide qui, lui, concentre entre ses mains de manière ostentatoire tous les pouvoirs et intervient dans tous les domaines comme un monarque auquel le pays tout entier appartiendrait. Si les méthodes de gouvernement diffèrent de celles de René Préval, elles ne demeurent pas moins régies toutes les deux par le même principe de dé-symbolisation du pouvoir. Autrement dit, les deux fonctionnent comme si le pouvoir leur appartenait en propre et ne constituait pas « la place inoccupable »7 dont parle Claude Lefort qui y voyait ainsi l’une des marques distinctives des régimes démocratiques.
L’étranger qui débarque en Haïti (ou même l’Haïtien qui revient au pays après 10 ou 15 ans d’absence) est surpris de voir partout dans la capitale des agents de sécurité en tenue de combat, armes au poing dirigées souvent à hauteur d’homme, le doigt sur la gâchette comme si le pays était installé dans un état de guerre. Dans les immeubles, les supermarchés, les banques, les boutiques et les maisons privées, les agents de sécurité sont partout au travail ; plus de 120 compagnies de sécurité fonctionneraient (et ce chiffre est en augmentation constante), pendant que l’insécurité ne fait qu’augmenter dans la capitale. Mais ce qui demeure inquiétant, ce ne sont pas les statistiques concernant le nombre de morts par balles, de viols, de maisons incendiées dans les bidonvilles par semaine ou par mois ; ce sont plutôt les formes que prend l’insécurité et surtout les discours placés en amont de l’insécurité, qui sont ici l’objet de nos interrogations.
Qu’on puisse voir certain jour un cadavre gisant à côté des étalages des marchands sur les trottoirs à Port-au-Prince ou à Pétion-ville et que personne ne semble y prêter attention, la vie continuant son cours, cela atteste une certaine accoutumance avec la mort ou si l’on veut une certaine proximité avec la mort comme mode d’être naturel de la société haïtienne d’aujourd’hui. Dans ce contexte, le policier peut passer lui-même à côté du cadavre et poursuivre son chemin. Démission ou absence de l’Etat ? Dans tous les cas, tout se passe comme si le pouvoir pour reprendre une expression de Jacky Dahomay, prenait plaisir à « donner à voir la mort »8, comme pour s’assurer d’une légitimité à tout instant défaillante ou qui, de toute façon, ne reposant sur rien, fait de la mort sa propre métaphore.
Le paradigme sous lequel on essaie d’habitude d’appréhender le problème de l’insécurité en Haïti est l’impunité. Plus un individu est assuré de l’impunité, plus il est encouragé au crime. C’est là presqu’un axiome. Effectivement si quelqu’un est abattu par des bandits ou par des policiers en pleine rue, cela n’entraîne pas automatiquement des poursuites ou des plaintes contre X, ni même des enquêtes. La victime semble avoir tout simplement tort d’avoir été victime. Tout semble se passer comme si nous étions en présence du fameux « état de nature » dont parle Hobbes. Sans doute, mais il faut encore approfondir une telle situation. Il y a bien à la clé ou en amont un pouvoir qui fournit le terreau de production des crimes comme moyen et forme d’exercice du pouvoir comme tel. Différents exemples peuvent nous aider à le comprendre. Tout d’abord, le pouvoir déclare que la justice elle-même est pourrie, ce qui autorise à se passer d’elle pour garder les mains propres ou à tout le moins pour se laver les mains vis-à-vis des crimes qui prolifèrent. Mais si d’aventure, il en vient à intervenir dans une lutte contre l’insécurité, il lui suffira d’adopter le slogan de la « tolérance zéro », à partir de quoi la justice sera radicalement disqualifiée comme lieu de mise à distance de la violence pour désormais laisser libre cours justement au simulacre de justice que représente la justice expéditive réalisée soit par des policiers qui exécutent en pleine rue des individus déclarés bandits qu’ils ont au départ capturés et mis sous menottes, soit par la foule contre des présumés voleurs ou contre des présumés « magiciens » qu’elle proclame responsables de la sécheresse dans un village. Un policier peut donc abattre en pleine rue un individu sans qu’il y ait ni enquête, ni mesure de l’inspection générale, ni arrestation. Parfois, pris en flagrant délit de corruption, de trafic de stupéfiants ou d’actes de banditisme, le policier est démis de ses fonctions, mais est vite repris sans aucune forme de procès et même est gratifié d’un poste plus important. Ainsi on aura appris d’un policier aujourd’hui en fuite que sous prétexte de « tolérance zéro »9, une cinquantaine de personnes sont exécutées sommairement par des policiers et jetées immédiatement sans aucune forme de procès dans une fosse commune dans la banlieue nord de la capitale. En dehors de ces cas, il y a eu dès la proclamation de ce slogan par le chef de l’exécutif, à travers tous le pays des scènes de lynchage, toutes documentées : 28 mars 2001 à Bainet, 24 juin à Cabaret et à Jérémie, 11 juillet à Port-au-Prince, puis à Mirebalais, 1er Août à Léogane, 21 août au Cap-Haïtien. L’ordre ainsi instauré d’une violence sans nom et sans bornes a, lui, paradoxalement un nom, c’est « la paix », un programme de paix, plus exactement de pacification de la population qu’il s’agit en vérité d’écarter de la vie politique, car toute politique se trouve légitimée et autorisée si elle est celle du pouvoir en place ; et ce programme se réalise cette fois sans masque et à visière levée. Comment cela est-il possible ? Pour le comprendre, il faudra éviter de se perdre dans la forêt des faits qui viennent illustrer ce programme, et partir à la recherche des assises et des fondements d’un tel programme, car pris en lui-même, il apparaît invraisemblable d’autant qu’il est assorti constamment d’une série de formules tout à fait bienveillantes pour l’Etat de droit ou pour la démocratie. Ce qu’on observe en effet, c’est une nette opposition entre le « laisser-faire » de son prédécesseur, René Préval et le dirigisme d’Aristide qui intervient personnellement dans toutes les institutions, dans tous les domaines allant du judiciaire au législatif, de l’économie et des finances à la culture et à la police. Dans les deux cas, les conséquences sont les mêmes : celles d’une situation de terreur diffuse qui n’est censée être imputable à personne, mais qui procède d’une véritable stratégie de gouvernement.
Au départ toute opposition est supprimée dans les collectivités territoriales et dans les deux chambres : maires, députés et sénateurs sont tous du même parti, comme s’il fallait écarter à l’avance toute possibilité d’expression d’une opposition politique, ou mieux comme s’il fallait rendre toute opposition illégitime et délinquante (« l’opposition n’est pas populaire, elle n’a personne avec elle, elle n’existe pas, ce sont les étrangers de la communauté internationale qui la font exister », disent souvent les partisans du pouvoir d’Aristide). Pour exprimer cette vision du peuple-Un, les organisations dites populaires reçoivent le mandat du chef de l’État de contrôler tous les rouages de l’administration, les pratiques du Parlement, de la presse et des opposants éventuels au régime. Les rues sont également non point sous le contrôle de la police mais des mêmes organisations populaires auxquelles celle-ci est plutôt soumise. Placées de fait au-dessus des lois, les organisations populaires sont des groupes de jeunes chômeurs choisis dans les nombreux bidonvilles qui ceinturent la capitale et certaines villes de province comme les Gonaïves et le Cap-Haitien. Etant pour la plupart armés, ils parviennent sans peine à être maîtres des rues, de la sorte, la distinction entre policiers et membres d’organisations populaires tend à s’estomper face à la recrudescence des vols de voitures, des kidnappings de personnes avec demande de rançon. Il arrive que la police opère des arrestations en cagoule et sans mandat, comme s’il s’agissait de véritables kidnappings, en même temps, un ordre d’arrestation de la part d’un commissaire ou d’un juge peut ne pas être exécuté. Il en est de même pour un ordre de libération d’un individu emprisonné illégalement. C’est que dans le fond comme dans la forme la police fonctionne comme une force armée au service du pouvoir avant d’être au service des citoyens. Dans ce contexte, des prisonniers peuvent être offerts à la foule pour être lynchés, mais dans d’autres cas, comme dans la ville de Limbé au nord du pays, la foule pénètre dans une prison et exécute six prisonniers à l’arme blanche sans qu’aucune suite n’ait été donnée à cet acte. De même, au commissariat de la ville St-Louis du Nord, un détenu est sommé de choisir le bâton avec lequel il sera battu, étant entendu que les bâtons qui lui sont présentés portent tous des noms macabres choisis par les policiers comme pour s’amuser : « zéro tolérance », « bâton sans pitié », « bâton nègre sale », « bâton krazé zo » (c’est-à-dire bâton à broyer les os). Nous avons là un aperçu des conditions de détention dans les prisons qui sont d’ailleurs toutes à la charge de la même police qui opère les arrestations illégales, exécute les mandats d’amener quand bon lui semble. En février 1999, on dénombrait 3090 détenus parmi lesquels 1172 attendaient depuis plus d’un an un jugement quelconque. Récemment une émeute éclate dans une prison de la capitale à cause des mauvais traitements (la faim, la malnutrition, la maladie, les coups et blessures de la part des policiers), et la plupart des prisonniers sont mis tout nus dans la cour, attachés par une corde les uns aux autres et livrés aux caméras des journalistes, comme pour renforcer la puissance de l’arbitraire du pouvoir : « L’enfer existe : c’est la prison en Haïti », tel était le titre d’un article récent du Miami Herald.
Un double10 sommet de la violence a été atteint d’un côté avec les événements du 17 décembre 2001, de l’autre avec une guerre des gangs déclenchée dans certains bidonvilles autour de la capitale. Sans nous y attarder, puisque de nombreux rapports ont été produits par les associations des droits humains haïtiennes et étrangères, signalons que sous les allégations d’un coup d’Etat perpétré dans la nuit du 16 au 17 décembre 2001, des bandes armées au milieu desquelles on repère de nombreux enfants des rues occupent les grandes artères de la capitale et se dirigent sous la protection de la police non seulement vers les locaux des partis politiques de l’opposition, mais aussi vers les maisons privées des leaders. Une fois qu’ils y ont pénétré par effraction, ils mettent le feu ou organisent un pillage des meubles et bibliothèques. Cette action s’est déroulée en même temps dans toutes les villes du pays et dans certains cas comme dans la ville des Gonaïves elle est accompagnée d’exécution sur la base du « Pè-Lebrun » ou supplice du pneu enflammé autour du cou de la victime. Mais ce qui se donne ici comme suspension de toute loi est dans la réalité l’expression d’un pouvoir qui exclut à l’avance toute dissidence. Tous les journalistes qui prétendent exercer la critique d’un tel système se trouvent facilement assimilés aux opposants politiques et reçoivent de fait des menaces de mort de la part des partisans du pouvoir, comme il en est advenu d’un jeune journaliste Brignol Lindor découpé à la machette par les membres d’une organisation populaire qui, après avoir annoncé leur intention de tuer, revendiquent le crime et se proclament du parti au pouvoir, sans être inquiétés par la police. D’un autre côté, depuis plusieurs mois des groupes de civils armés se battent en laissant chaque jour plusieurs cadavres dans les rues devant l’impuissance apparente de la police. Les tueurs sont connus, déclarent eux-mêmes dans des stations de radio, qu’ils ont tué : dans les six derniers mois, on évalue à une cinquantaine le nombre de personnes mortes par balles dans le bidonville appelé Cité Soleil ; dans un autre appelé Fort Mercredi, les rapports de la Coalition nationale pour les droits humains font état de 11 morts par balles et de 135 maisons incendiées. Mais aucune action publique n’est mise en mouvement contre les tueurs, comme si le pouvoir se résignait à n’exercer aucun contrôle sur ses partisans qui sont pourtant dénoncés par la clameur publique. Réunis récemment au palais national par le chef de l’exécutif, les chefs de gangs sont adoubés et confortés dans leur mode de lutte : ce ne sont pas des bandits armés qui sont reçus, mais des gens du peuple qui comme tels ont droit au respect du pouvoir, déclare le chef de l’exécutif. S’il convient de procéder au désarmement de ces gangs comme de partout les associations de droits humains le réclament, la police concède qu’elle les « accompagnera » dans ce processus.
Rapporter cet état de violence en Haïti au pouvoir politique, c’est, me dira-t- on, prendre un véritable raccourci dans la recherche des causes de la violence. Car si l’on se met à observer le mode de développement de la capitale et des grandes villes de province, on découvre qu’avec l’extrême densité de la population (1 528 739 habitants vivent dans les bidonvilles sur 22,15 % de l’aire totale urbanisée), et l’occupation anarchique de l’espace, une situation permanente de violence est la condition de vie ordinaire dans les bidonvilles11. Vivre au niveau des besoins primaires (sans eau, ni électricité, ni écoles, ni hôpitaux, ni système sanitaire, dans la promiscuité), c’est au sens strict survivre comme dans un camp de concentration sans barbelés, c’est du moins cette image que certains sociologues12 sont enclins à prendre pour rendre compte de la vie quotidienne dans les bidonvilles de Port-au- Prince. Dans la confusion entre espace privé et espace public, tous les coups sont possibles. Mais déclarer qu’il n’existe pas de parade à la violence qui peut éclater dans un bidonville, c’est déchoir de sa citoyenneté la population qui y vit, bien plus, c’est renforcer son exclusion et sa marginalité, comme si les institutions de la police, du système judiciaire et les services éducatifs seront de toute façon impuissants à intervenir. Que la misère et la pauvreté dans les bidonvilles proviennent d’une exploitation économique structurelle et de manière plus immédiate de l’exode rural causé par le dépérissement de l’agriculture, cela ne saurait suffire à expliquer les formes de violence qui se développent dans le pays. Le problème de la violence relève bien avant tout du politique au sens où Hannah Arendt le définit comme ce qui seul peut faire apparaître un monde humain et demeure constitutif de l’homme dans la mesure où le politique pose le principe du partage d’un monde commun ; et c’est donc précisément là où saute ce principe que la violence fait rage.
En comparant l’état de violence en Haïti avec la montée de l’insécurité dans les départements français de la Caraïbe (Guadeloupe, Martinique et Guyanne), on se rend compte que les crimes se produisent chaque fois dans un contexte où la parole est barrée13 et dans le même moment chaque fois que les institutions de l’Etat sont tenues pour allogènes à la société. Ce qui est interprété comme une fatalité, à savoir que tel individu a été poussé au crime par une force irrépressible, est encore l’aveu d’une impuissance à mettre en avant la raison dans le jeu des rapports sociaux. Les individus apparaissent alors atomisés, sans lien entre eux, sans articulation à une origine reconnue ; les lieux qui sont offerts pour la gestion des conflits étant en décalage par rapport aux mentalités, il semble que se renforce le penchant pour vivre dans une sorte de « marronnage » par rapport à l’Etat, mais du même coup, il en résulte une plus grande propension à la violence, puisqu’aucune référence, aucune tiers ne vient s’interposer entre les individus et que chacun ne connaît plus que « la mise en scène de soi ». Déclin de l’Etat et effondrement des grandes idéologies qui ont marqué le XXe siècle14 laissent l’individu livré à lui-même, sans les repères symboliques capables d’ouvrir le chemin à la parole, à la pratique de communication. Pour certains sociologues, il est probable que la violence qui se manifeste dans les milieux de jeunes et dans les bidonvilles des grandes métropoles représente un phénomène qui est à l’échelle mondiale et qui prend sa source entre autres, dans « la crise de la masculinité », résultante de la montée des mouvements de femmes. Argent, armes et drogue viennent à la rescousse d’une perte des pouvoirs liés au machisme15. Cette analyse est applicable sans aucun doute également à l’Haïti d’aujourd’hui. Mais la progression de la violence doit encore être rapportée à un déficit du politique et à une défaillance de la communication.
L’existence d’un monde commun présuppose une série de pratiques ou de flux de communication entre les différents acteurs de la société, groupes, classes, catégories sociales, associations diverses ; sur cette base les conflits sont gérés par la possibilité permanente qui est donnée à tous d’exprimer leurs opinions, étant donné que nul n’est censé posséder la vérité sur la société, tandis que tous sont crédités de raison qui n’est point ici la raison instrumentale (Verstand), mais la faculté de juger (Vemunft) au sens où Kant pour la première fois l’a mise au jour, rendant ainsi compte des conditions auxquelles est suspendu un Etat de droit démocratique. L’action politique dans cette perspective n’est point l’application d’une vérité toute faite, elle ne devient telle que si elle met en confrontation une pluralité d’opinions, des points de vue dissidents qui requièrent de chacun la faculté de juger. Là donc où il y a abdication de cette faculté, la liberté disparaît de l’horizon et le règne de la violence commence. Dans le cas d’Haïti d’aujourd’hui, l’absence de légitimité du pouvoir apparaît dans la violence qui devient la règle dans chaque conflit qui surgit, c’est-à-dire en dernière instance dans la volonté elle-même du pouvoir de se maintenir au cœur de ce déficit de légitimité, donc comme pouvoir qui ne parle pas aux citoyens, ou comme pouvoir qui ne parle pas du tout au sens d’une parole illocutoire. Arendt soutient avec justesse qu’un tel pouvoir qui ne repose plus que sur lui-même perd ce qu’elle appelle l’autorité (au sens de L’auctoritas des Romains) qui implique un mouvement de consentement des citoyens au partage d’un monde commun. A ce niveau de la réflexion, nous nous apercevons que le pouvoir politique ne peut être défini comme système de domination ni comme simple monopole de la violence. Mais s’il demeure difficile de nier que le pouvoir parle, c’est qu’on ne voit pas assez que la tyrannie a toujours besoin de se livrer à une tâche de séduction, et d’entretenir avec les citoyens un type de rapport dont les modèles sont à rechercher dans ce qui peut réveiller les pulsions infantiles de soumission et d’abdication de la raison critique. Ainsi par exemple, ce qui vient à occulter la source de l’état de violence qui perdure dans le pays est bien le discours fondé sur le paradigme de la famille, au sein de laquelle les relations sont soumises à des règles provisoires et régies par le principe de la faveur, puisque une fois que les enfants deviennent adultes et disposent de l’exercice de la raison à laquelle l’éducation est dédiée, ils sont appelés à laisser la maison familiale. En prétendant se modeler sur celui de la famille, le pouvoir politique aboutit nécessairement à une confusion dangereuse des sphères du privé et du public et ne connaît plus que des sujets et non des citoyens doués de la faculté de juger et donc capables de participer à l’organisation de la cité et de décider eux-mêmes du choix de leurs gouvernants. Plus grave est surtout l’impossibilité dans laquelle se trouverait la société pour tout ce qui concerne la justice : celle-ci devient un instrument totalement à la merci du dirigeant politique qui voit tous les citoyens comme des enfants auxquels il prodigue des faveurs à sa guise16. Il est curieux que la première constitution du pays en 1805 proclame que le chef de l’Etat est comme un père de famille et cette tradition se perpétue dans la pratique avec le droit que se donne un chef d’état en Haïti d’intervenir dans les affaires de justice comme un père de famille, d’arrêter sans mandat ou de libérer quand il le souhaite, n’importe quel prisonnier. La sphère privée ne peut dans ce contexte connaître aucune protection et à vrai dire n’est même pas pensée. L’Etat familial ne saurait souffrir de critiques, le citoyen qui prétend se soustraire à l’autorité du président- chef de famille, est appelé frère et comme tel il a constamment besoin d’être ramené au bercail. S’il persiste, il devient un ennemi de la nation et son extermination est méritée. Le seul vrai crime est alors la dissidence, aussi se produit-il avec aisance la banalisation des diverses pratiques de violence qui peuvent se développer dans la vie quotidienne.
On a coutume dans les sciences politiques de reconnaître dans le mode de fonctionnement de ce type de pouvoir les traits irrécusables d’une dictature. Ce faisant, on est porté à parler de cette dictature comme une situation provisoire que connaissent en particulier les sociétés du tiers-monde ou pays du Sud, mais dont les causes résideraient essentiellement dans une structure d’exploitation économique, ou à la rigueur dans la domination impérialiste articulée à un système culturel archaïque générateur de despotisme. Sans prétendre invalider ici ces explications rapides, il n’est pas inutile de rappeler que l’état de violence qui sévit en Haïti aujourd’hui et qui dans le fond n’a jamais connu de trêve véritable pendant deux cents ans d’indépendance est le microcosme d’une mondialisation qui s’opère sur la base de la dénégation du droit et de la justice et qui applique le principe de deux poids deux mesures dans les relations internationales17. La violence et l’insécurité qui marquent les temps actuels un peu partout dans le monde et de manière emblématique d’abord au Rwanda, puis plus récemment au Proche-Orient où la soi-disant communauté internationale se reconnaît impuissante à recourir à des lois et à des règles, reparaissent de manière presque caricaturale, mais dans toute leur vérité sur la scène d’Haïti, comme aux temps de la conquête et de l’esclavage. Les informations sur la violence en Haïti sont connues des services du département d’État américain, et autant de l’OEA (Organisation des États Américains) chargée de réaliser des négociations entre Aristide et les leaders de l’opposition regroupés au sein du mouvement appelé Convergence démocratique. Mais toutes ces instances préfèrent parler de la nécessité d’aider le pays à aller vers « plus de démocratie », à « renforcer la démocratie », pendant que dans la réalité sévit dans le pays l’un des systèmes les plus violents organisés par l’exécutif.
Si on accepte cette hypothèse, on pourra éventuellement mieux soupçonner pourquoi un véritable désespoir politique frappe tant de pays et qu’il convient plus que jamais de penser en profondeur les conséquences qu’entraînent les résistances à l’universalisation du droit et de la justice manifestées par les gouvernants des pays du Sud, comme par ce qu’on appelle la communauté internationale. Tout se passe comme si nous assistions au spectacle de la fin du politique à travers le monde et donc à un retour à l’état de nature dans lequel Hobbes lisait la guerre de tous contre tous. On dirait qu’on n’attend même plus du politique la possibilité qu’il refonde le lien social, car que signifient en dernière instance les succès des fondamentalismes religieux, des passions ethniques et des pratiques racistes si ce n’est la reconnaissance de fait de la faillite de la raison dans la constitution d’un monde commun ? On se réfugie dans l’imaginaire de la pureté des origines de sa religion, de sa « race » ou de sa « tribu » ou encore de sa « nation » comme source d’une sécurité ontologique, comme lieu d’invulnérabilité, sans se douter qu’ainsi on laisse se perpétuer dans son dos le cycle de la violence.
Notes
1 J. Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Tome I, Rationalité de l’agir et rationalisation de la société, tr. Jean-Marc Ferry, Paris, Fayard, 1987.
2 Sur les caractéristiques actuelles de la violence dans les pays industrialisés, voir les analyses proposées par Y. Michaud dans son art. « Les deux violences : régression archaïque et barbarie technologique », dans Esprit, déc. 1998, p. 24-35. Pour lui, les sociétés développées essaient d’occulter les violences ou de les médicaliser, tandis qu’ailleurs dans les pays moins développés on attend que « les guerriers » se transforment en « producteurs » (p.34).
3 Paul Ricoeur, Lectures, I, Autour du politique, Paris, Seuil, 1991 ,p. 132.
4 Ibid.,p.l34.
5 Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Levy, 1961 ; voir le commentaire de Françoise Collin, L’homme est-il devenu superflu ? Hannah Arendt, Paris, Ed. Odile Jacob, 1999, p. 67-102 : « Limites de la violence, violence des limites ».
6 Voir notre article dans Chemins Critiques, revue haitiano-caraibéenne, Port-au-Prince, vol. 5, No 1 Janvier 2001 : « La dé-symbolisadon du pouvoir et ses effet meurtriers ».
7 Claude Lefort, Essais sur le politique, Paris, Seuil, 1986.
8 Jacky Dahomay, « La tentation de la tyrannie », dans Chemins Critiques, vol. 5, No l, Janvier 2001.
9 Sur la « tolérance zéro », voir le témoignage publié dans, le journal Le Monde du 11 décembre 2001. Voir également les rapports des associations de droits humains comme le CEDH (Centre oecuménique pour les droits humains), Plate-forme des organisations haïtiennes droits humains : rapports d’observation (oct-déc 2001), Coalition nationale pour les droits humains, et (2000 et 2001), rapports du département d’État à Washington : Country Reports on Human Rigths Practices 2000 (publiés le 26 février 2001), Rapports de l’OEA (Organisation des États Américains) du 21 mai 2002 ; rapports de Reporter sans frontières du 25 février 2002. Nous nous sommes appuyé sur ces différents rapports pour écrire cet article.
10 Sur les événements du 17 décembre 2001, voir le rapport du Centre oecuménique des droits humains à Port-au-Prince et le rapport de l’OEA du 21 mai 2002.
11 Cf. Gérard Holly, Les problèmes environnementaux de la région métropolitaine de Port- au-Prince, Commission du bicentenaire de Port-au-Prince, 1999, p. 23.
12 Cf. par exemple André Corten, Haïti : misère, religion et politique, Paris, Ed. Karthala, 2000.
13 Cf. Jacques André, L’inceste focal aux Antilles, Paris, PUF 1987 ; de même, l’étude récente de Christiane Bougerol, Une ethnographie des conflits aux Antilles, Jalousie, commérages, sorcellerie, Pars, PUF, 1997, surtout les p. 48 à 51 sur « l’hostilité et son expression en face à face ».
14 Voir Yvon Lebot, La guerre en terre Maya, Communauté, violence et modernité au Guatemala, Paris, Karthala, 1992 ; de même, Daniel van Eeuwen (sd), La transformation de l’État en Amérique latine. Légitimation et intégration, Paris et Aix-en-Provence, Karthala- CREALQ1994.
15 Voir l’article de Hugues Lagrange, « La pacification des moeurs et ses limites. Violence, chômage et crise de la masculinité » dans Esprit, décembre 1998, p. 48-72 : « La violence interpersonnelle, écrit-il, apparaît donc aujourd’hui comme une crispation sur les valeurs du registre de la force virile au sein de groupes particulièrement touchés par la crise du travail et des rôles masculins », p. 72.
16 Sur la distinction entre État et famille, voir l’art, de Jean-Fabien Spitz, « L’État et la famille » dans Droits, Revue française de théorie juridique, L’État/21,16,1993.
17.À vrai dire, nous serions au seuil d’une nouvelle époque qui est celle de l’empire au sens où Toni Negri et Michael Hardt (dans leur ouvrage intitulé Empire, Paris, Exils éditeurs 2000, p. 238) viennent de le décrire : pour eux, l’empire n’a pas d’extérieur, il n’a pas de frontières, il cherche à gérer des crises qui pour lui ne sont que des petites crises, car il n’aurait plus d’ennemis unifiés directement visibles et identifiables. Sous ce rapport il ne peut être guère ému par le développement de la violence dans le monde ni même dans ses arrière-cours. Les événements du 11 septembre à New York ne disqualifient pas cette analyse.