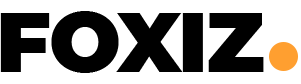Bel-Air, au cœur de Port-au-Prince. Un homme a reçu trois balles. Il est vivant, en route vers l’hôpital. Son ami, Alex, hurle en brandissant son tee-shirt trempé de sang. Des gravats et un poteau électrique abattu bloquent l’accès du quartier aux voitures. Pour se faufiler dans cette zone insalubre, sans aucun service public, il faut se frayer un chemin à moto sur les trottoirs défoncés, zigzaguer entre les ordures qui dégagent un fumet putride sous une chaleur de plomb, puis montrer patte blanche aux cerbères qui surveillent les allées et venues. L’endroit a connu quatre massacres depuis deux ans. Début avril, treize personnes ont encore été assassinées, cinq autres ont disparu. Les assaillants ont pris l’habitude de découper les corps en morceaux, de les jeter aux porcs et aux chiens errants ou de les brûler pour ralentir leur identification. Entre les attaques brutales, une guérilla urbaine de basse intensité fauche chaque jour ses victimes.
Assis à l’ombre d’une gargote, Roy Acasseit parle d’un ton las. Le leader de Bel-Air n’en peut plus de compter ses pertes : « Le gouvernement réprime l’opposition avec des gangs, pour s’approprier politiquement notre zone avant son référendum. Nous ne sommes pas un gang, mais comme la police ne nous défend pas, on se défend tout seuls. » Ici, on ne s’entre-tue pas pour de la drogue. On meurt pour des idées. Bel-Air est un quartier populaire opposé au président Jovenel Moïse, élu en 2016. Comme les autres secteurs rebelles, il est assiégé depuis trois ans par neuf gangs réunis dans une alliance, G9 Fanmi et alliés, réputée proche du pouvoir central haïtien.
Le pays connaît une crise politique plus violente, plus sanglante encore que toutes celles qu’il a déjà vécues depuis son indépendance, arrachée par les armes à Napoléon, en 1804, quand la « perle des Antilles » est devenue la première république noire libre de l’Histoire.
Le pays marche sur un fil au-dessus du chaos
En 2019, suivant les recommandations du FMI, Jovenel Moïse décide d’augmenter le prix de l’essence dans la nation la plus pauvre des Amériques. Des manifestations monstres bloquent le pays et réclament le départ d’un président accusé d’être impliqué dans une gigantesque affaire de corruption. Depuis, les braises couvent. Le pays n’a plus de Parlement. Son économie est au point mort. Le chef de l’État gouverne par décrets. Il estime que son mandat s’achèvera le 7 février 2022 ; l’opposition, elle, juge qu’il aurait dû quitter le pouvoir le 7 février 2021. Pourquoi une telle divergence ? Parce que Jovenel Moïse a été élu au terme d’un scrutin annulé pour fraudes, puis réélu un an plus tard. Dans ce contexte explosif, le président haïtien a décidé d’organiser, le 27 juin, un référendum constitutionnel, dénoncé comme une mascarade par l’opposition. En attendant, son pays marche sur un fil au-dessus du chaos.
Roy Acasseit nous emmène vers la ligne de front, en pleine ville. En chemin, on croise des blessés, des éclopés de cette bataille sans nom. Jean-Guy Wilson avec sa jambe qui pendouille, Chery Johnny et son orbite vide ; il a ôté lui-même la balle logée dans son œil… Sur les grandes avenues, il faut longer les murs, baisser la tête, écouter siffler les tirs des snipers, courir chacun son tour à découvert pour traverser la longue saignée bitumée de la rue des Césars, tandis que, à deux pas de cette scène de guerre, des jeunes écoutent nonchalamment des airs de zouk sur un énorme sound system des années 1990 qui fait trembler les murs. Une marchande ambulante leur vend des verres de rhum artisanal. Derrière une barricade, 300 mètres de no man’s land laissés aux rats, à la mort, à la poussière. Les avis de décès des dernières victimes sont placardés partout : Alkal, tué le 23 mars ; Ozinson, le 1er avril… Quand éclatent des tirs, tout le monde se baisse. Puis reprend sa route. Roy Acasseit avance, impavide. Il s’assoit dans les travées d’une petite église, abandonnée comme l’école primaire aux murs vert pomme criblés de balles. Au loin, on aperçoit les ruines de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, détruite par le séisme de 2010, qui fit 250 000 morts. « Ce qui se déroule ici, c’est ce qui s’est passé en novembre 2018 à la Saline, mon quartier », lâche « Champagne », 43 ans, sous son chapeau melon.
Les gangs massacrent en toute impunité
Le 13 novembre 2018, plusieurs gangs, aujourd’hui membres du G9, ont attaqué le bidonville de la Saline, bastion de l’opposition. Entre 15 heures et 5 heures du matin, sans que la police intervienne, les tueurs ont massacré les habitants et brûlé les habitations : au moins 71 morts, hommes, femmes, enfants, sans distinction. Le point de départ de la guerre des gangs. Personne n’a jamais été condamné, malgré les plaintes et plus de 500 témoignages recueillis par la police haïtienne et l’Onu. Dans ces rapports, 69 noms d’agresseurs sont cités, dont ceux de Serge Alectis, dit « Ti Junior », à la tête du gang Nan Chabon, et de Jimmy Cherizier, alias « Barbecue », ex-policier, à la tête du gang du quartier Delmas 6. Deux hommes censés être les plus recherchés du pays. Aujourd’hui, Ti Junior dirige le quartier de la Saline et Barbecue a pris la tête du G9. « C’est le règne de l’impunité », enrage Champagne, qui a encore deux balles, sur les quatre qu’il a reçues, fichées dans le corps. « Je marchais au milieu des cadavres, des cochons les dévoraient. C’est là que j’ai été touché. J’ai rampé. Je suis secouriste. Ça m’a sauvé. Mais j’ai tout perdu. Je suis réfugié ici. »
Pour se défendre, pour attaquer, il faut des armes, des cartouches. Une boîte de dix munitions coûte 25 dollars ; un fusil d’assaut, plusieurs milliers, dans un pays où le salaire mensuel moyen s’élève à 66 dollars. Comme les rentes payées par les commerçants pour être protégés, les kidnappings aident à financer le conflit. La plupart des gangs profitent de la manne ; on compte une dizaine d’enlèvements par jour à Port-au-Prince. De petites manifestations s’organisent spontanément sur les lieux des kidnappings. À Canapé-Vert, des pneus brûlent en l’honneur de Youry Dérival, étudiant en psychologie enlevé la veille. « On est pauvres, on est seuls, on est abandonnés aux gangs », crie Jean dans la foule en colère. Même spectacle à Lalue, où l’on prie dans les fumées des pneus en flammes pour l’ancien commissaire de police Manuel Gaston Orival, enlevé le même jour. À Bois-Verna, d’autres hommes bloquent la rue à la mémoire du docteur Ernst Pady, assassiné pour avoir refusé de monter dans la voiture de ses ravisseurs.
Dans le bidonville de Cité-Jaune, entre quatre tôles recouvertes de rideaux, près du réchaud et de la bassine qui constituent respectivement sa cuisine et sa salle de bains, Magdala, 33 ans, vendeuse de rue, relate son enlèvement : « J’attendais le bus, ils m’ont battue et brûlé les cheveux. » Ses ravisseurs exigeaient 1 million de dollars alors qu’elle en gagne moins de 50 par mois. C’est la famille d’une femme enlevée avec elle qui a payé la rançon, dont on ignore le montant. Depuis, Magdala ne sort plus. « N’importe qui peut être kidnappé », dit sa sœur Micheline. Les deux femmes habitent dans ce taudis, avec leurs trois enfants, après que le séisme de 2010 a détruit leur habitation et tué leurs parents.
Dans le quartier voisin de Mayard, allié de Bel-Air, à côté d’une voiture retournée et d’une charogne de chien que personne ne songe à enterrer, des hommes masqués patrouillent en armes, surveillant quatre lignes de front couvertes de détritus. « Le G9 nous a proposé d’intégrer leur alliance, explique Reginald, un ancien directeur d’école. Mais on ne pouvait pas accepter, pour des raisons idéologiques. Nous sommes opposés au pouvoir. Alors, depuis, c’est la guerre. » Reginald a perdu sa maison dans une attaque, l’été dernier, comme plus de mille autres habitants. Réfugiés à moins de 1 kilomètre de leurs domiciles abandonnés aux balles et aux flammes, tous survivent dans un dénuement total. Tee-shirt « Chanel » rouge, tongs « Lacoste », Pierre est policier et réside dans le quartier. Lorsqu’il rentre du commissariat, lui aussi prend les armes pour défendre sa communauté : « À la police, quand on décide quelque chose à midi, Barbecue est au courant à midi quinze. Au moins cinquante policiers travaillent pour lui. »
Un chef d’Etat allié aux gangs
« L’insécurité que nous vivons est une insécurité d’État, un banditisme d’État, le résultat de la gestion des autorités depuis que Jovenel Moïse a fait alliance avec les gangs pour museler la contestation. C’est la raison pour laquelle, depuis 2018, il y a eu onze massacres à Port-au-Prince, à Bel-Air, Saline, Cité-Soleil, Pont-Rouge. Avec, chaque fois, au moins 30 morts. Les quartiers d’opposition tombent les uns après les autres. » La voix est posée ; le regard glisse parfois sur l’écran qui, face au bureau, diffuse en continu les images de onze caméras de surveillance. Directeur du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), le sociologue Pierre Espérance dresse le bilan désastreux d’une administration qui, dit-il, a affaibli les institutions du pays : « La police est paralysée, la justice n’a aucun moyen. La Cour supérieure des comptes, le Sénat… personne ne peut travailler. C’est la première fois depuis Duvalier, en 1986, qu’un chef d’État s’allie aux gangs. Les plaintes sur les onze massacres sont documentées, déposées, mais il n’y a aucune poursuite. Les responsabilités du G9 sont établies. Et Jimmy Cherizier, Barbecue, n’est pas dans le maquis. »
Non, Barbecue n’est pas dans le maquis. Il est devant nous et vient de se réveiller d’une sieste. Le chef du G9 est trapu. Corps puissant, regard électrique. Il dort le jour, combat la nuit. Il nous scanne d’un œil noir puis offre des bières avant d’aller prendre une douche, tandis qu’un garde du corps cache son fusil d’assaut. « Les armes ne sont pas des trophées, inutile de les montrer », tempère le chef, soucieux de son image. Il porte sur le bras un tatouage de la police, même s’il en a été radié. Il revient quelques minutes plus tard. On l’accuse d’avoir massacré des gens à la Saline ? « Eh bien ! allons voir comment les gens m’y accueillent », lâche-il. Au moment de partir, il se met à genoux dans la rue et, selon un rite vaudou, dessine une croix avec de la Florida, une eau de Cologne mystique. Il enflamme le liquide, puis s’en asperge le corps et le visage pour se protéger. Il a déjà échappé à la mort neuf fois. « C’est parce qu’ils n’arrivent pas à me tuer qu’ils me mettent des massacres sur le dos. » Des colts 9 mm sont glissés sous les tee-shirts blancs de ses hommes. Nous voilà partis à une quinzaine de motos vers la Saline. Une horde sauvage qui soulève la poussière et fait baisser les yeux.
Arrivés dans le bidonville, l’homme fort du G9 entre dans les ruelles souillées, peuplées par des ombres. Les habitants le saluent, éberlués par sa présence. « Regardez ces gens, dit-il. Ils pourrissent dans la misère. Je ne peux pas les assassiner, j’ai vécu comme eux ! Mes ennemis, ce sont les riches hommes d’affaires, les douze familles qui contrôlent l’économie de l’île sans partager. C’est l’injustice, l’inégalité sociale qui me rend malade. Et tôt ou tard, je renverserai le système, au péril de ma vie. » Déterminé, Jimmy Cherizier s’enfonce dans la Saline, suivi par ses hommes silencieux. Il prône la révolution, affirme n’avoir jamais parlé avec le président haïtien. « Au contraire, je vais me battre contre le gouvernement. J’attends juste le bon moment pour agir. Sinon, dans dix ans, dans vingt ans, sans éducation, sans université, sans hôpitaux, on en sera au même point. »
À l’entrée de l’immense marché de la Croix-des-Bossales, cet homme qui a pour modèle Che Guevara pénètre dans une baraque et salue ses lieutenants, Ti Junior, le nouveau chef de la Saline, jeune et émacié, et, plus loin, « Mikano », le chef du gang de Wharf-Jérémie, en costume africain jaune, ancien taulard, de haute stature, sombre et discret, également accusé de massacres. « Ces hommes ne sont pas des chefs de gang ! Ils aident les gens, ils ont restauré leur quartier », assure Barbecue, franc-maçon depuis 2004 : « Sur ma foi maçonnique, dans les zones du G9, il n’y a pas de vols, pas de viols, pas de kidnappings. » Fils d’un chapelier et d’une mère vendeuse de poulets frits, Jimmy Cherizier explique tenir son surnom du métier de sa mère et non de sa réputation de brûler ses victimes.
Lire aussi.Enlevé en Haïti, le Père Michel confie: “J’ai parlé de Gandhi à mes ravisseurs”
L’équipée sauvage reprend la route pour Cité-Soleil, autre lieu de tueries dont le G9 est accusé d’être l’auteur. Barbecue prend une gamine miséreuse par le bras : « Les vrais gangs, ce sont nos dirigeants, l’opposition, les douze familles. Ils n’en ont rien à foutre de cette petite fille. » Elle s’appelle Tilari, elle ne connaît pas son âge, elle est vêtue de haillons, elle ouvre des yeux étonnés et tristes. « C’est ça l’avenir d’Haïti. Et ça me rend fou ! » Il se cache le visage sous un bras et pleure. S’il arrive un jour au pouvoir, quelle sera sa première mesure ? Ses larmes sèchent instantanément : « J’éliminerai les corrompus. De manière radicale. » La nuit tombe sur Port-au-Prince. Une pluie lourde éclate sur la ville, rinçant les caniveaux. Tilari doit se protéger de l’averse tropicale sous son toit de tôle crevée. Elle a beau ne pas connaître son âge, elle sait déjà que rien, jamais, ne sera facile.
Ces hommes sont prêts à parer les assauts du G9, alliance de neuf gangs ultra-violents instrumentalisée, selon les observateurs internationaux, par le président haïtien pour mater toute dissidence. Comme aux pires heures de la dictature des Duvalier, quand les « tontons macoutes » terrorisaient la population civile. Plongée dans l’enfer d’une capitale transformée en terrain de guerre.