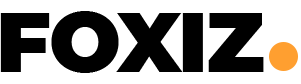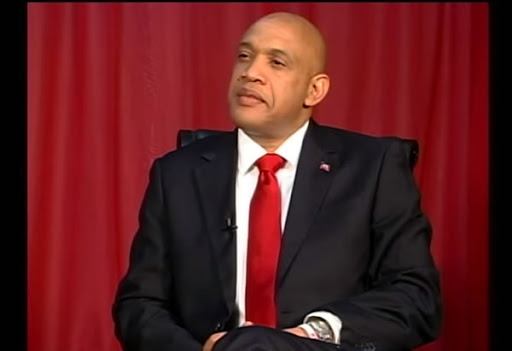Les leaders politiques peuvent être classés en plusieurs groupes selon leur origine, leur niveau d’instruction, leur engagement politique et la période de leur émergence.
De 1804 à 1970, la gestion du pouvoir politique a été assurée en majorité par des leaders nationalistes.Malgré leur niveau de formation assez hétéroclite, ces premiers dirigeants Haïtiens ont tous été guidés dans leurs actions par une même exigence, celle du nationalisme jugé indispensable pour mieux se défaire du joug colonial et asseoir les prémices d’une nation véritable.
Le 1er janvier 1804, lorsque Haïti accède à la souveraineté après avoir vaincu l’armée française à la bataille de Vertières, le vers de la violence est déjà dans le fruit de l’indépendance, proclamée par Jean-Jacques Dessalines sur la place d’armes de la ville des Gonaïves.Le roi Christophe se suicide,Dessalines se désigne empereur mais son règne est de courte durée. Deux ans après son sacre, il est assassiné par ses anciens lieutenants. Les soldats lui coupent les doigts pour voler ses bagues de valeur et le dépouillent de ses riches vêtements, avant de l’abandonner à la foule qui lapide sa dépouille à coups de pierres.La succession de Dessalines consacre la partition du pays. Le Sud est dirigé par le mulâtre Alexandre Pétion et le Nord par un président noir Henri Christophe qui se fait couronner roi. Ce dernier connaît lui aussi une fin tragique, lorsque ses hommes se soulèvent. Ne pouvant pas contenir la révolte, le roi Christophe se suicide en se tirant une balle dans la tête le 8 octobre 1820.
Le 12 mai 1902, une fusillade éclate au Parlement
Le Nord et le Sud sont réunifiés dans la foulée par le président Jean-Pierre Boyer. Mais la violence continue. Boyer reste au pouvoir pendant plus de 20 ans, avant d’être renversé par une nouvelle révolution. Il s’exile en France où il meurt en 1850.
Son successeur Tirésias Simon Sam subit le même sort. Le 12 mai 1902, une fusillade éclate au Parlement situé à proximité du petit séminaire des Spiritains à Port-au-Prince. Un prêtre raconte.Le petit séminaire a reçu pas mal de balles égarées. Il a même servi de refuge à plus de 400 personnes, parmi lesquelles des sénateurs et des députés avec leurs familles. Le président Sam lui-même a confié à nos pères trois de ses fils, députés du peuple, et quelques autres de ses amis.
Tirésias Simon Sam s’exile à Paris. Ses successeurs ne sont pas mieux lotis. En 1908, le président Nord Alexis est renversé par un coup d’État. Avec son Premier ministre Cincinnatus Leconte, il s’exile à Kingston.
Attentat au palais national
De retour d’exil, à la tête d’une armée, Cincinnatus Leconte s’empare du pouvoir le 10 août 1911. Mais un an plus tard, presque jour pour jour, le 8 août 1912, il connaît lui aussi une fin tragique dans l’enceinte même du palais présidentiel à Port-au-Prince.
“Ce matin vers 3 h 25, une horrible explosion réveillait toute la population. La formidable détonation était accompagnée de bruits de mitraille et de crépitements de balles. Le palais venait de sauter. On vit les flammes gigantesques promener leur lueur rouge sur toute une partie de la ville”, écrit le quotidien Le Matin.Le peuple se révolte et lynche le président Vilbrun Guillaume Sam
Accident ou attentat ? Le pays s’interroge. Le 27 juillet 1915, la violence ne faiblit pas à Port-au-Prince. Bien au contraire. Le président Vilbrun Guillaume Sam, fils de Tirésias Simon Sam, fait arrêter et exécuter près de cent-soixante opposants, dont son prédécesseur Oreste Zamor.
Mais le massacre se retourne contre son auteur. Le peuple se révolte et lynche le président Vilbrun Guillaume Sam. Résultat ? Les troupes américaines débarquent en Haïti, officiellement pour restaurer la stabilité et la sécurité. Elles resteront dans le pays pendant dix-neuf ans.
De Jean-Claude Duvalier à Jean-Bertrand Aristide…
En 1957, lorsque François Duvalier devient président, la violence est incarnée plus que jamais par les milices privées, les fameux tontons macoutes. Corruption, arrestations, tortures, assassinats, rythment le quotidien des Haïtiens.
Après des rumeurs de complot au sein de l’armée, il renforça la répression et, le 1er avril 1964, il se proclama «président à vie». La même année il commandita plusieurs massacres de population dans les campagnes, notamment le massacre des Vêpres jérémiennes qui fut une des nombreuses tueries exécutées par l’armée et les tontons macoutes. Il exerça jusqu’à sa mort une implacable dictature (on compta 2000 exécutions pour la seule année 1967 ; cette année-là sortit un film extrêmement critique sur sa dictature : Les Comédiens, basé sur un roman antérieur de Graham Greene). En février 1971, François Duvalier organisa un plébiscite pour désigner son fils, Jean-Claude, comme successeur.
De nombreux Haïtiens prirent le chemin de l’exil, principalement aux États-Unis et au Canada, mais également vers la Martinique, la Guadeloupe et surtout la Guyane française.
À la mort de Papa Doc en 1971 , son fils, Jean-Claude Duvalier, prend le relai. En 1986, confronté au mécontentement populaire et lâché par les États-Unis, Bébé Doc finit par quitter le pays. Même sort pour le président Jean-Bertrand Aristide, chassé du pouvoir à la suite d’un coup d’État en 2004.
Le nationalisme est commun à la fois aux pays anglophones, francophones et lusophones. Les difficultés autour de la construction d’un nationalisme sont nombreuses. Au-delà du sous-équipement des colonies fraîchement indépendantes et de la formation des élites nouvellement indépendantes, plus axée sur l’obéissance que sur la responsabilité, le principal obstacle des premiers leaders Haïtiens est celui du leadership . Haïti, à la recherche d’un modèle de développement autonome, était au centre de l’affrontement Est-Ouest. Les fervents du nationalisme estiment que seule l’idéologie de gauche qui prévalait à l’Est pouvait les aider à se défaire de la tutelle de l’Occident conquérant. Ainsi, presque tous les partis politiques qui ont conduit Haïti à l’indépendance étaient d’obédience marxiste-léniniste .
Ces différentes tendances ont aussi influencé les élites intellectuelles et la formation des leaders jusqu’à l’avènement de l’occupation Américaine.Malgré les difficultés que ces premiers dirigeants ont rencontrées dans la gestion de leur pays respectif, ils ont néanmoins laissé un important héritage qui continue de servir de référence jusqu’à aujourd’hui : le neo-nationalisme , devenu une exigence majeure pour mieux faire face aux risques de l’occident.
Le combat entamé par ces premiers leaders en faveur de la construction nationale était à peine amorcé qu’une nouvelle génération de leaders, celle des militaires, vint y mettre fin. Ainsi,”De 1888 à 1913, parmi les huit présidents qui se sont succédé au pouvoir en Haïti, cinq ont été obligés de se réfugier à la Jamaïque”, explique l’ancien ministre Jean Victor Généus, en pointant les ingérences étrangères. “Les institutions financières du pays étaient contrôlées par les Européens qui utilisaient toutes sortes de manœuvres pour renforcer leur position et s’assurer de juteux bénéfices”.Kingston, où ils prennent leurs quartiers, les exilés ne songent qu’à une chose : recruter des mercenaires pour repartir en Haïti et reprendre le pouvoir. Du coup, il n’est pas rare qu’en débarquant du bateau un président déchu croise son successeur qui s’embarque pour Port-au-Prince avec sa soldatesque.
En sens inverse il y a le débarquement des exilés qui est une scène pathétique. Ils arrivent à Kingston avec leurs bras en écharpe, la tête bandée, et les vêtements en lambeaux. Ils ne méritent aucune sympathie parce qu’ils vont passer leur temps en Jamaïque sans travailler et attendre leur tour. . C’est le début des régimes autocratiques, même dans les rares pays dont les dirigeants ne sont pas militaires. C’est le règne des partis uniques, avec pour conséquence la fin des espoirs nés des indépendances.
L’avènement de la démocratie en Afrique n’a pas entraîné une transformation radicale de la classe politique. Le mélange des dirigeants de cette période démocratique, entre civils et militaires, n’a pas permis à la démocratie d’être véritablement une réussite et, surtout, un facteur de progrès. Seuls quatre pays sont cités en exemple pour leur respect des exigences démocratiques : le Bénin, le Botswana, le Cap-Vert et le Ghana. Certains de ces pays ont inventé la conférence nationale, qui a servi de facteur de déclenchement du processus démocratique dans beaucoup de pays comme le Congo-Brazzaville, le Gabon, Madagascar, le Niger, la République démocratique du Congo… Il y eut beaucoup d’écrits sur les acquis de la Conférence nationale du Bénin (Adamon 1995 ; Banégas 1998). Certaines conférences sont restées inachevées, comme celle au Bénin qui visait uniquement à mettre fin au régime révolutionnaire en place. Les débats de fond sur le devenir des pays n’ont pas été abordés. Au Bénin toujours, il aura fallu l’organisation de la Conférence économique nationale de 1996 pour entamer les vrais débats sur l’avenir du pays. Les conférences nationales du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo ont été particulièrement longues avant d’aboutir à d’inutiles déballages publics. Seul le Mali a su tirer son épingle du jeu avec l’arrivée au pouvoir du parti de l’Alliance pour la démocratie au Mali (ADEMA), constitué de leaders issus d’une classe d’intellectuels brillants et fortement engagés en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations maliennes.
Somme toute, les leaders politiques Haïtiens depuis l’après indépendance , qu’il s’agisse des nationalistes de la première heure, des dictateurs, des militaires de la période autocratique ou des dirigeants de la décennie de l’ajustement structurel, ont, à quelques rares exceptions près, failli dans leur mission en faisant d’Haïti le pays le moins avancé de la planète. Ainsi, de l’indépendance à nos jours, l’Etat n’a jamais été approprié par les Haïtiens. L’Etat est le fait des puissances étrangères et le relais de l’idéologie coloniale. Du coup, les leaders politiques qu’Haïti a connus jusqu’ici sont majoritairement perçus comme de simples marionnettes à la solde des puissances dominantes .