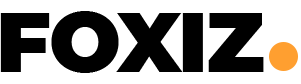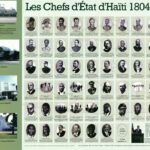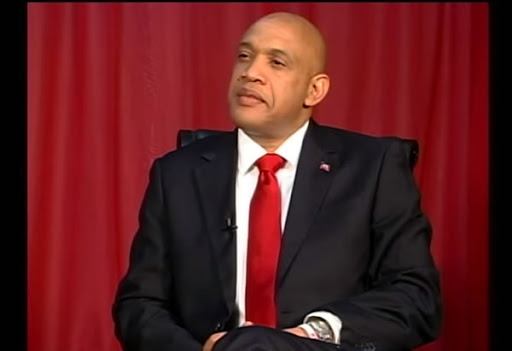À Martissant, le quartier de Martissant est la scène des actes et des opérations de violence et de terreur sporadiques depuis une vingtaine d’années. Ce qui a contribué à décapitaliser des gens de la petite bourgeoisie, de moyens commerçants et en mettant en péril le développement d’usines installées déjà dans les années 1970 dans ce quartier traditionnel dit de classes moyennes. De cohortes de migrants internes ont été observées au cours des périodes les plus chaudes. Des déplacements de courte durée ont été enregistrés aussi bien que des migrations et des cas de réfugiés.
Quelques victimes, au péril de leur vie, se maintiennent dans leur milieu de vie malgré les risques. Dans de situations de menaces dans la survie, selon Malthais (2001), les aînés pourtant sont les plus résistants à quitter leurs demeures. Ils savent souffrir davantage que les autres adultes des pertes subies en raison de leur fort attachement. Cependant, dans le cas de Martissant, ce ne sont pas de complices des auteurs de violences. Ils sont des gens qui ont eu une mobilité sociale par le travail ou aidés par des sponsors familiaux ou bien des employeurs pour s’acquérir d’un habitat.
« En effet, le 10 septembre 1953, la ville de Port-au-Prince allait intégrer par arrêté communal publié dans le journal officiel de la République, Le Moniteur, ses faubourgs dont Martissant », a souligné Georges Corvington dans le tome VIIIe de Port-au-Prince au cours des ans (2e partie, 1950-1956).
Entre-temps, dans les interstices du quartier de Martissant se sont établies des enclaves précaires d’habitat dont La Paix, Ti Bois, Jeannot. Des occupations à force de terrain concernent Jeannot, Deluy, soient des terrains appartenus à BNDAI, une Banque nationale de développement Agricole et Industrielle, selon Oriol (CEPODE, 2012:139-140).
Pour revenir aux réfugiés internes invisibles, ils se sont déménagés au fur et à mesure pour être accueillis par des proches là où la situation de sécurité est relativement moins menaçante. Bien souvent, ce sont de jeunes cadres qui travaillent à Port-au-Prince, Delmas, Pétion-Ville ou Tabarre. Dans d’autres cas, les enfants qui fréquentent l’école en ville ont motivé davantage à grossir les populations de réfugiés internes alors invisibles.
D’un statut de propriétaires, ils sont devenus de locataires ou d’hébergés. Ils sont souvent déclassés, appauvris, décapitalisés ou déracinés dans leur identité communautaire. Des ouvrières sont de grandes laissées pour compte, elles constituent quelques poches dans lequel quartier. Beaucoup d’étudiants se voient dans l’insécurité pour leurs études universitaires qui représentent alors une perspective de mobilité sociale. Ils sont enclins à la dépression, au découragement et à des conditions de vie précaires. Ils font aussi partie de ces réfugiés internes invisibles pour avoir habité un “quelque part” », pour emprunter ce concept de Debuys et Yepez Del Castillo (1987 ).
Les réfugiés internes invisibles que constituent des étudiants, ouvrières, cadres techniques, écoliers, commerçants, industriels sont loin d’attirer l’attention des pouvoirs publics et des organisations humanitaires aussi bien que celles des droits humains. Ils ne se sont pas encore convertis comme population clientèle de l’aide humanitaire dans les opérations spectaculaires des organisations sur place. L’Etat est sur le banc des opérateurs qui gèrent la manne humanitaire en abandonnant sa fonction régalienne en matière de promotion et d’exécution des politiques de sécurité et de sureté des populations notamment celles en situation de danger comme les riverains de Martissant.
Depuis le 1er juin 2021 s’est aggravé le problème de sécurité quand, sous l’influence de la guerre des gangs, des itinérants éternels se sont défilés par milliers pour se réfugier au « milieu de n’importe où », pour parodier Pipher (the middle of never where”. Le bilan de blessés, personnes tuées, des incendies, des saccages est préoccupant d’autant plus aucune autorité n’est en mesure de l’évaluer vu leur démission comme représentants de pouvoirs publics. Dans l’opération de camionage humanitaire se sont impliqués des ONGS, organisations civiques, organisations des droits humains, Organisations internationales, des organismes de l’Etat, la mairie de carrefour, des églises protestantes, adventistes et catholiques, l’Office de la Protection du citoyen, les Pompiers volontaires de la commune de Carrefour.
L’élan est à la parade du savoir faire spectaculaire et une reconquête du marché de l’humanitaire depuis le passage de l’ouragan Matthew en 2016. Tout est attisé à travers d’un parapluie d’acteurs désarticulés dans leurs interventions humanitaires.
Quant aux pouvoirs publics, ils définissent leur ligne de mire de démission désorganisée en matière de sécurité publique et de sécurité humaine abordées dans une attitude puérile et à la remorque.
Le chef du gouvernement se propose du relogement et du reconditionnement des personnes prises en charge par des institutions de l’Etat en partenariat avec des organismes des Nations unies. Un budget d’environ 800,000 dollars américains est prévu dans le cadre de cette intervention.
Les réfugiés internes invisibles se voient leur population grossie du fait qu’ils échappent de la saga spectaculaire du camionage humanitaire.
Il pourrait se compenser dans un imaginaire adaptatif comme forme alternative de résilience. C’est « une solution ultime d’adaptation, une contrée d’exil où l’on peut combler, même illusoirement, ses besoins » (Dorvil, 2007 :223).
Hancy PIERRE, Professeur Travail Social et Migration, Université d’Etat d’Haïti, et At The University of Findlay, Ohio, USA
Repères bibliographiques. Mary Pipher, The middle of everywhere-Helping refugees enter the American Community, First Harvest edition, United States of America 2003.-Danielle, Maltais, Catastrophes en milieu rural, Les Editions JCL, Québec 2003.-Danielle Maltais et autres, Désastres et sinistrés, les Editions JCL, Québec 2001.- Hancy Pierre, « Aide alimentaire, Environnement et Migration enHaïti, après le séisme du 12 janvier » in les Cahiers du CEPODE No2, 2e année, Imprimeur II, Port-au-Prince mai 2011.-Hancy Pierre, Défis, enjeux et politiques : migrations, environnement et changements climatiques en Haïti, Organisation Internationale pour les Migrations(OIM), Genève octobre 2015.- Hancy Pierre, « Au-delà du camionnage humanitaire-le système national de gestion des risques et des désastres en Haïti et le plan d’urgence au passage de l’Ouragan Matthew » in Le Nouvelliste, Port-au-Prince 11 octobre 2016.- Hancy Pierre, habitat et luttes sociales en Haïti (1930-20010): bilan et perspectives” in Revue Les Cahiers du CEPODE, NO 3, Editions du CEPODE, Port-au-Prince, juillet 2012 pp97-162.- Hancy Pierre, Ensayocritico de las politicas de Vivienda social en Haiti: los programas de Vivienda de la Empresa Publica de Promocion de Vivienda Social en Puerto Principe de 1994-1999” in Cuadernos Atlantea, Universidad de Puerto Rico,1999.- Michele Oriol, “le quartier de Martissant dans la commune de Port-au-Prince, Essai de diagnostic urbain”, février 2009.