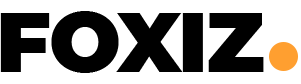La meurtrière chasse aux sorcières du Moyen Âge active des procédés juridiques semblables à ceux qui se mettent en place après les attentats du 11 septembre 2001. À certains égards, à tout le moins. La chasse aux sorcières, une entité difficile à cerner, a entraîné un abandon du droit qui n’est pas sans rapport avec l’état d’exception que nous avons accepté depuis 2001. C’est notamment ce que sont venus soutenir cette semaine à Montréal, à l’invitation de l’UQAM et de l’Université Laval, les historiens Pau Castell, de l’Université libre de Barcelone, et Martine Ostorero, de l’Université de Lausanne, tous deux spécialistes de la démonologie et de la sorcellerie.
Pour se livrer plus facilement à la chasse aux sorcières à compter du XVe siècle, l’état d’exception juridique devient courant, explique Pau Castell au Devoir. « Dans les Pyrénées, au XVe et au XVIe siècle, un comté, un duché, des seigneurs renoncent volontiers à toute liberté pour faciliter l’action de la justice, puisque l’on considère qu’il est très difficile de traquer la sorcellerie et qu’il faut donc donner toute la liberté possible aux inquisiteurs. »
C’est un peu la même chose qui se produit en Occident depuis 2001, observe-t-il. « Devant une menace que l’on juge énorme, que l’on gonfle soi-même par la peur, le droit recule », dit l’historien venu de la Catalogne. « C’est la même chose en France, renchérit sa collègue Martine Ostorero. L’exception est acceptée. Elle devient peu à peu la règle. On construit une figure du mal qui conduit à l’exception, puis qui devient permanente. »
Étudier les crimes imaginaires de la sorcellerie et la place qu’occupent les procès qui les concernent dans l’histoire, « cela peut nous aider à repenser le poids des tribunaux dans notre actualité », dit Martine Ostorero.
L’histoire de la sorcellerie diabolique a des accointances à plus d’un titre avec le présent. Pas étonnant qu’un cours en ligne sur le sujet, offert en anglais par l’Université de Barcelone, attire désormais plus de 27 000 étudiants de partout dans le monde.
« Cet intérêt pour l’univers de la sorcellerie et de la magie au Moyen Âge tient à beaucoup de choses, notamment à l’influence d’Harry Porter et de cette idée que la sorcellerie, bien qu’on n’y croie pas, comporte quelque chose de réel. Les gens se demandent si la sorcellerie comporte des recettes, des grimoires… Il y a sur ces sujets un brouillage des frontières, au nom d’un prétendu savoir secret et défendu. »
Or pas plus les sorciers que les sorcières n’existent, sinon par la définition que va en donner un système judiciaire qui s’autorise, au nom de la puissance du pouvoir, à arrêter, à torturer, à tuer.
À la fin du XVe siècle, on se fait croire que des gens se rendent dans des lieux pour adorer le diable, afin de nuire aux récoltes, d’empêcher la reproduction, de tuer des enfants pour les manger ou encore pour provoquer des tempêtes, l’infertilité, les nuées de grenouilles, n’importe quoi. « On les soupçonne aussi de se livrer à des actes sexuels avec les démons, puis de vols nocturnes où ils chevauchent des balais ou des bâtons », dit Martine Ostorero.
L’image du diable et des démons est très antérieure à la chasse menée contre la supposée sorcellerie. Mais l’imaginaire du sabbat diabolique va les incorporer dans la réalité des chrétiens en leur donnant soudain des corps. Les inculpés sont en effet contraints, en devenant en quelque sorte des marionnettes désarticulées par la torture, à relater des expériences sensorielles de la présence diabolique. La scène judiciaire se transforme ainsi en un laboratoire expérimental qui apporte non seulement la preuve de la culpabilité des individus, mais aussi, pour les théologiens, des preuves irréfutables de l’existence d’un monde démoniaque. « En Catalogne, des milliers de femmes seront brûlées », note Pau Castell.
Des documents de différentes natures témoignent de l’émergence de cette croyance dans la chrétienté. Entre le XVe et le XVIIe siècle, des textes qui établissent la nature de la sorcellerie sont répandus en Europe occidentale. Ils vont s’incruster durablement dans les consciences de lieux variés. La superstition se diffuse comme un poison.
« En 1428, on découvrit dans les pays du Valais la méchanceté, les meurtres et l’hérésie des sorcières et des sorciers, hommes et femmes », qui se réunissent, croit-on, dans des écoles clandestines. Le diable les obligerait, dit-on, à embrasser son postérieur. Le but de cette supposée secte ? Renverser le pouvoir et élire son roi. Une chasse aux sorcières va en découler. « Alors qu’il s’agit de crimes totalement imaginaires, la répression terrible est, elle, tout à fait réelle », dit Martine Ostorero.
« Ce que pouvaient faire vraiment ces gens accusés, nous n’en avons pas idée », poursuit-elle. La sorcellerie n’existe au fond que par les procès qu’on fait subir à ceux que l’on accuse, selon des récits déjà constitués dans les mentalités. « On criminalise sous l’angle de la démonologie chrétienne. »
Cette chasse n’est pas inventée à partir de rien. Elle reprend des discours déjà présents, les réinvestit dans un nouvel imaginaire qui se mâtine de traditions locales. Elle met à jour des politiques d’exclusion dont avaient déjà souffert les Juifs, les hérétiques, les apostats et d’autres groupes. La nouveauté est que la sorcellerie ne décrit pas un groupe. « N’importe qui peut soudain en être accusé », explique Pau Castell.
« La féminisation de la sorcellerie est exagérée », soutient Martine Ostorero au cours du même entretien. On parle facilement de sorcières, mais la réalité des sources historiques montre une réalité beaucoup plus complexe, selon les régions. « En Suisse romande, au XVe siècle, ce sont 70 % d’hommes qui sont incriminés et 30 % de femmes seulement. » En Pologne, observe pour sa part Pau Castell, on trouve aussi une majorité d’hommes. « On a théorisé la sorcière avec l’historien Jules Michelet au XIXe siècle et les théories féministes au XXe siècle, mais cela va trop loin », plaide Martine Ostorero.
La femme n’en est pas moins une cible facile de cette Inquisition. « Les femmes sont plus susceptibles d’être accusées que les hommes, comme elles le sont davantage pour des questions d’adultère », précise Pau Castell. Le crime de sorcellerie est beaucoup utilisé contre les femmes parce qu’on peut accuser un homme de plusieurs autres choses. Mais l’accusation de sorcellerie pour une femme est plutôt commode : on pourra facilement dire d’une femme qu’elle est une sorcière parce qu’elle a un savoir qui tient à son rapport avec les ingrédients des cuisines, les herbes, les marmites ou parce qu’elles sont des sages-femmes.
Ce fantasme d’une démonologie tient aussi à une volonté de matérialiser un pouvoir. La sorcellerie illustre une volonté de construction de ce pouvoir. Les recherches des dernières années ont montré que le crime de sorcellerie est beaucoup plus fréquent dès lors qu’on se trouve loin du pouvoir central, dans des territoires ou des principautés en marge, lesquelles sont plus ou moins toujours en quête de leur souveraineté.
« En revanche, poursuit l’historien de l’Université de Barcelone, ces procès apparaissent nombreux et meurtriers dans les vallées, dans les régions éloignées. »
Quand la justice est livrée loin des sources des accusations, les chances pour les accusés de s’en sortir sont beaucoup plus grandes. Au contraire, « là où le pouvoir n’est pas bien constitué, dans les villes autonomes, en Allemagne par exemple, des milliers de femmes sont condamnées au bûcher ».
Au fond, par l’entremise de ces procès pour sorcellerie qui tournent à la boucherie, ce sont deux souverainetés symboliques qui s’affrontent : celle du roi et des princes chrétiens contre celle du diable. « Là où le roi règne, le diable n’envahit pas la société. Des textes le disent. La majesté royale éloigne le diable », explique Martine Ostorero. Étudier l’histoire de la sorcellerie permet ainsi de révéler l’importance et la place du pouvoir solidement constitué dans une société. Et chaque société bien entendu a ses démons.
Le président de la Commission, le sénateur de l’Artibonite Youri Latortue l’a avoué à la presse : «Il existe une association de malfaiteurs au sein de l’administration publique haïtienne.» Le sénateur Steven I. Benoit, membre de la Commission, a repris la même expression quelques jours plus tard. Ces déclarations sont très graves, mais elles n’inquiètent plus personne. Puisque tout le monde sait que la culture de l’éthique a longtemps disparu de la sphère politique, du secteur privé des affaires, de l’administration publique, bref, de la société haïtienne dans son ensemble. La corruption n’est qu’un des corollaires de cette disparition. Et comme les institutions sont faibles et les sanctions quasi inexistantes, alors la criminalité, sous toutes ses facettes, prend l’allure d’une activité licite.
Notant au passage qu’un directeur de BMPAD, d’après les informations du sénateur Benoit, sont grassement payés: 10 000 US $ par mois, soit 120 000 US $ l’an, plus un mois de boni, des frais, des avantages et des privilèges. Ils gagnent plus que de nombreux professeurs titulaires des grandes universités québécoises. Par ailleurs, l’ex-ministre de l’Économie et des Finances, Marie-Carmelle Jean-Marie, avait suggéré d’enquêter également sur les parlementaires, insinuant ainsi qu’ils ont participé également à cette vaste opération de criminalité économique et financière. Certains d’entre eux ont eu leurs propres compagnies de construction et ont participé, dans certains cas, au pillage des deniers publics. Ils ont bénéficié de beaucoup de projets et n’ont pas toujours livré la marchandise. Il se pose alors un problème de crédibilité et d’éthique au Parlement qui n’avait nullement joué son rôle de contrôle.
La notion de responsabilité politique « centrale dans le nouveau modèle présidentiel-gouvernant du régime démocratique » peut être convoquée dans l’examen des luttes contre la corruption. La responsabilité, qui ne concerne pas le lien entre le dirigeant politique et le Parlement, est « indispensable à l’entretien de la foi dans la capacité de la démocratie à impliquer les citoyens dans la vie publique…à maintenir la confiance, l’autorité, la légitimité. » Les dirigeants qui ont la charge des fonds publics sont désormais soumis à trois formes de relation entre les citoyens et les dirigeants : la présentation d’une comptabilité, la justification d’actes posés, l’évaluation de politiques qui ont été menées.
Dans le cas de Petrocaribe, des efforts sont engagés a posteriori pour rendre compte de l’usage des fonds, à travers des rapports étayés par des données chiffrées, discréditées par l’opinion publique. Il faut se demander si la présentation d’une comptabilité est une condition suffisante à écarter tous soupçons de détournement.
Le principe de la responsabilité implique réparation des dommages. Comment spécifier le niveau de réparation des dommages causés par le détournement des fonds ? Comment déterminer les bénéficiaires de la réparation ? Au-delà des sanctions, comment tirer les enseignements du Procès de la Consolidation ? Pourquoi après plus deux cents ans, la reddition des comptes ne s’est pas institutionnalisée en Haïti ? Quels sont les obstacles à l’inscription du principe de la transparence dans
l’ordre normatif ?
https://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158902/PetroCaribe-un-vaste-crime-economique
https://calenda.org/600389?file=1
https://www.ledevoir.com/monde/ameriques/570624/un-pays-ramasse-mais-toujours-pas-reconstruit
https://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158902/PetroCaribe-un-vaste-crime-economique