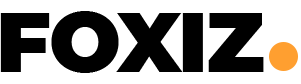LA résistance manifeste des Haïtiens au régime qui s’est substitué, le 30 septembre, à celui du président Aristide, massivement élu en décembre 1990, ne suffira pas à imposer le retour à la démocratie. L’isolement économique et politique du pays, décidé par la communauté internationale, sera déterminant. Mais les Etats-Unis « étudient » si longuement le contenu de l’embargo qu’il risque d’intervenir trop tard. En France, notamment, des considérations « humanitaires » plaident en faveur de la modération. Après une prompte condamnation du coup d’Etat, l’Occident accepterait-il de fermer les yeux, comme au temps des Duvalier ?
Le renversement du président de la République haïtienne, M. Jean-Bertrand Aristide, le 30 septembre dernier, à la faveur d’un soulèvement militaire, risque d’anéantir pour longtemps les chances de redressement du pays le plus pauvre du continent américain. La désignation à la tête du gouvernement, sous les auspices de l’armée, d’un champion de la défense des droits de l’homme, M. Jean-Jacques Honorat, après une dizaine de jours d’extrême violence qui ont fait environ cinq cents morts, témoigne des incohérences d’une société à la dérive où plus aucune force organisée n’a suffisamment de légitimité pour justifier sa présence au pouvoir.
L’institution militaire se sait trop discréditée aux yeux de l’opinion nationale et internationale, voire trop divisée, pour diriger elle-même Haïti. L’empressement de son commandant en chef, le général Raoul Cédras, à se débarrasser de la direction de l’Etat, rend compte de l’épuisement de son capital de confiance, dilapidé au cours de quatre années sur cinq de « transition démocratique » sous l’autorité des forces armées, après la chute de M. Jean-Claude Duvalier. En 1986, le général Henri Namphy, héritier de la dictature, avait été — brièvement, il est vrai — surnommé « Chouchou » par la population.
Cette fois, les militaires n’ont pas souhaité détenir directement le pouvoir. Et la classe politique elle-même, critique à l’encontre du Père Aristide mais en grande partie consciente de la nécessité, fût-elle conditionnelle, de son retour, a résisté à cette tentation, s’abstenant finalement d’entrer dans un gouvernement d’union nationale que lui proposait le nouveau premier ministre. En effet, sa cuisante défaite, lors des élections générales de décembre dernier qui avaient vu M. Aristide triompher avec 67 % des suffrages, lui confère une représentativité limitée.
De toute évidence, le coup d’Etat se solde par un constat de carence : improvisé à l’occasion d’une mutinerie, il ne parvient pas à combler le vide créé par l’éviction du président en fonctions depuis le 7 février 1991. A l’exception d’une poignée d’opportunistes, le Parlement désemparé s’est mis le plus longtemps possible en position d’attente. Puis il s’est laissé contraindre à un simulacre de respect de la Constitution en désignant un président provisoire d’opérette, M. Joseph Nérette, tiré de la Cour de cassation.
La seule personnalité un peu consistante placée à l’avant-scène par les événements reste le nouveau chef de gouvernement, qui, de président du Centre haïtien de défense des droits de l’homme, passe à la direction d’un exécutif issu de la violence. Sorti du képi des militaires qui l’ont choisi en raison de sa haine viscérale à l’égard du Père Aristide, qu’il ne cessait d’accuser d’être un dictateur larvé, il ne représente que lui-même. Avec lui, la bourgeoisie reprend les rênes de l’Etat ; elle peut ainsi espérer préserver encore un statu quo ante menacé par l’entrée des pauvres (le revenu annuel moyen s’établit à 1 800 F) dans la gestion des affaires publiques.
Héros des couches populaires, le Père Aristide tirait également son pouvoir d’un contrat très personnalisé avec ses « adorateurs ». Parmi les principaux candidats à l’élection présidentielle de décembre 1990, il fut le seul à éviter de prendre formellement appui sur une fiction de formation politique « à l’occidentale », préférant jouer de son charisme et lancer l’opération Lavalas (l’”avalanche”, en créole), mouvement d’enthousiasme inconditionnel fondé sur un programme de démocratie participative (1). Le Front national pour le changement et la démocratie (FNCD), improvisé le jour de sa déclaration de candidature et censé soutenir le président au Parlement, ne pouvait, tant il est hétéroclite, lui tenir d’assise politique : un tiers de ses trente-huit députés n’ont-ils pas d’ailleurs, approuvé, le 7 octobre 1991, la désignation de son remplaçant à la présidence ?
Une élection qui violait la tradition
DANS ce climat d’affrontement entre le peuple et la bourgeoisie, les élections n’avaient d’autre but, pour les déshérités, que d’arracher l’Etat à la minorité qui se l’appropriait. De ce point de vue, l’écrasante victoire du Père Aristide au suffrage universel a si profondément violé la tradition politique qu’elle est apparue aux perdants comme un coup d’Etat constitutionnel…
Le Père Aristide n’a pas cherché à imposer de compromis politique, ni tenté d’expliquer aux pauvres que son opposition parlementaire, également élue, représentait légitimement une partie de la nation souvent en désaccord avec lui. Mais, était-il possible de s’engager dans la voie des transformations radicales, compte tenu de la pression permanente des duvaliéristes, de certains milieux d’affaires et d’une partie de l’armée sur le nouveau régime ? Quoi qu’il en soit, le 13 août dernier il a laissé un millier de ses partisans menacer les députés avec des pierres et des « pères Lebrun » (pneus enflammés autour du cou des victimes de lynchage) jusqu’à ce qu’ils renoncent à interpeller le premier ministre d’alors, M. René Préval, sur le bilan de ses six premiers mois de gestion. Même le Parti unifié des communistes haïtiens(PUCH), résolument dans l’opposition, accusait le pouvoir d’errements dangereux risquant de conduire à une « dictature cléricale » .
Ces événements n’ont guère contribué à rassurer les adversaires, y comris démocrates, du président Aristide Il est vrai qu’il devait en grande partie son investiture à la magistrature suprême à la mobilisation de la rue.C’est elle qui, le 7 janvier dernier, a étouffé dans l’oeuf la tentative de coup d’Etat de Roger Lafontant, baron duvaliériste, récemment abattu dans sa prison. L’armée n’avait alors manifesté aucune velléité de profiter des circonstances. Et le maintien en état de vigilance de ses troupes de partisans faisait partie des mesures ordinaires de précaution et d’autodéfense prises par le Père Aristide contre le mauvais sort.
Cette mobilisation permanente a accentué le culte de « Titid », qui n’a pas toujours su éviter les dérapages inhérents à un prophétisme également lié à ses convictions de théologien de la libération. De retour de New-York, où il avait prononcé un discours remarqué l’Assemblée générale des Nations unies, le Père Aristide a ainsi provoqué, le 27 septembre, un vent de panique au sein de l’armée et dans les milieux aisés quand, à l’encontre de « ceux qui n’ont pas faim », il a publiquement évoqué, sans le nommer, « ce bel instrument » — le « père Lebrun » : « Ah ! quel bel outil ! Ah ! quel bel instrument ! Il est beau, il est chic, il est pimpant, il est élégant, il sent bon, partout où vous passez (…), a-t-il déclaré en encourageant cinq mille de ses partisans. Il est inscrit dans la même loi qui met les Macoutes hors la loi (2) . »
Cette tolérance à l’égard des « porteurs de pneus » n’a pas, autant qu’on puisse le vérifier, suscité de lynchages, même si le doute plane sur l’existence d’un lien de cause à effet avec l’assassinat, le 29 septembre aux Cayes, du leader du Parti démocrate chrétien haïtien (PDCH), Sylvio Claude, aussi opposé au président Aristide qu’aux Duvalier.
La condamnation des riches n’avait d’ailleurs pas ouvert la voie aux bouleversements économiques qu’elle semblait sous-tendre. Respect du secteur privé et tentative d’assainissement du secteur public ont caractérisé une gestion orthodoxe des affaires. L’Etat a, par exemple, licencié cinq mille de ses fonctionnaires dans un souci à la fois de rigueur et de purge ; le président n’a pu éviter la perte de huit mille emplois dans les ateliers de sous-traitance qui ont souvent fermé leurs portes par peur de la nouvelle conjoncture politque. Et si le salaire minimum journalier devait être fortement revalorisé en octobre, avec l’accord du Parlement (de 15 gourdes — 16,50 F — à 26 gourdes — 28,50 F — dans la capitale), au grand dam de l’Association des industriels d’Haïti (ADIH), les pays occidentaux avaient néanmoins accordé leur satisfecit en promettant,le 11 juillet à Paris, une aide de 437 millions de dollars étalée jusqu’en 1993, quand M. Renaud Bernardin, ministre du plan, n’en espérait que 250 millions.
Ce classicisme économique atténue passablement la vigueur de certains propos du président Aristide. Son renversement s’explique, par conséquent,par la peur de deux groupes sociaux encore et toujours héritiers d’une structure sociale issue du temps de l’esclavage. Le long confinement du pouvoir aux mains de l’élite, jusqu’en février 1991, équivalait à l’assimilation de l’Etat à une institution privée (3) : dès lors, son entrée dans le domaine public, à la faveur d’élections honnêtes sous contrôle de centaines d’observateurs internationaux, constituait en soi une révolution. Les trafiquants de drogue, les magnats de la contrebande et, avec eux, nombre de cadres de l’armée et les duvaliéristes, ont perdu d’un seul coup le pouvoir et leurs privilèges.
Dans de telles conditions, le Père Aristide se savait fragile et il a tenté de consolider sa situation à l’aide d’une image de personnage providentiel. Menant sans cesse l’offensive verbale pour se ménager un rempart populaire, il n’a pas toujours mesuré à quel point ses propos pouvaient dérouter des alliés potentiels dans certaines couches de la bourgeoisie, au sein d’une classe politique artificielle mais souvent démocrate, et même parmi quelques cadres professionnalisés de l’armée.
Les enlèvements, arrestations arbitraires, tortures et autres exactions de l’armée, qui se poursuivent, derrière le masque d’une normalisation des institutions, tentent d’obliger le peuple à renoncer à ses rêves de justice et d’Etat de droit. Malgré ses faiblesses, pesonne d’autre que le Père Aristide ne pourra acquérir, avant longtemps, en Haïti, le capital de confiance indispen sable à la modernisation du pays. L’Organisation des Etats américains (OEA), y compris les Etats-Unis, a semblé souscrire à ce constat en exgeant, dès le 2 octobre, la restitution « au président Jean-Bertrand Aristide de l’exercice de son autorité légitime (4) ». La France et avec elle la Comunauté européenne affichent la même détermination. Pour y parvenir, Washington et Paris, tout particulièrement, devront imposer à l’armée haïtienne de se transformer en une simple force de police et, en échange, lui garantir sa sécurité. En attendant, dans un tract diffusé le 7 octobre à Port-au Prince, l’opinion populaire analyse sans illusions les causes du retour de la dictature : « Il faut que les pauvres sachent qu’ils ne sont rien (…). Il faut que les pauvres comprennent qu’éliminer des mouches, des ravets (cafards) et des pauvres, c’est la même chose. Le pauvre doit renoncer au mot espoir. Il e faut. L’inutilité même du massacre doit l’en convaincre (5) . »
Jean-Pierre Alaux
(1) « L’espérance du droit en Haïti », le Monde diplomatique, janvier 1991.
(2) Libération, 9 octobre 1991.
(3) « Haïti : la déception et la colère », le Monde diplomatique, août 1987.
(4) Résolution de l’OEA du 2 octobre 1991. L’ambassadeur de France à Port-au-Prince, M. Jean-Raphaël Dufour, a sauvé la vie du président Aristide lors du coup d’Etat.
(5) DIAL, n° 1 626, 1er octobre 1991.