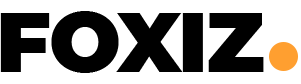Par Alin Louis Hall
En levée de rideau, les orientations stratégiques de la carnavalisation avaient poussé les « tèt kale » à déclarer Haïti « open for business ». Bien entendu, les imbéciles heureux peinent à se rendre à l’évidence qu’il s’agissait plutôt d’une vaste opération de faire semblant. Le pays était ouvert en réalité à tout sauf au gros bon sens et à la raison. Confortablement lotie sur le fonds PetroCaribe, la « soulouquerie » rose utilisa le social comme un des paravents pour méticuleusement organiser le pillage systématique du Trésor public. Le faire semblant pousse les Haïtiens à faire appel à la commisération. Aussi la masturbation philanthropique devient-elle le parfait stratagème pour s’enrichir. En stratifiant des couches superposées de ramifications nationales et internationales, la malice rose a pu réussir des crimes financiers collectifs parfaits. Dans ce monde à l’envers, le faire semblant incite les Haïtiens à croire qu’on peut tirer l’économique avec le social, la distribution de kits alimentaires et de kits scolaires. Ce courant de pensée a également fait école en diaspora où chaque expatrié ne jure que par la création de sa propre fondation caritative. Implicitement, nous proposons un débat puisqu’il est temps, c’est notre point de vue, de faire le bilan de ces incitations directes au statu quo.
Avec cette culture de la frime et du simulacre, rien ne pouvait barrer la route à l’imposture « Nèg bannan lan ». Ce choix du roi du carnaval peut paraître paradoxal lorsqu’on sait que ce dernier avait toujours pris le soin de s’entourer des meilleurs talents en studio comme pour le défilé des trois jours gras. Évidemment, puisqu’il n’a jamais été question de croissance économique ni d’un avenir partagé, la nomenclature des critères se retrouve toujours renversée. Dans l’univers politique haïtien, le dauphin est choisi parmi les meilleurs chiens couchants. Ceux qui ont la mémoire courte peuvent revisiter les annales de la transition « Titid – Ti René ». Alors, comme le magicien tirant le lapin du chapeau, le « Sweet » présenta son « Nèg Bannann » . Et tout naturellement, les cerveaux lents ont cru que ce dernier était capable de marcher sur l’eau. Évidemment, ce pas vers l’inconnu nous a mené tout droit à l’intersection de tous les dénis et de tous les dangers. Une fois encore, la première expérience de décolonisation se retrouve seule à assumer les conséquences de la désespérance. Haïti continue de cuire dans son propre jus.
En effet, la calamité rose qui s’est abattue sur Haïti ressemble de plus en plus à une onzième plaie d’Égypte. Cependant, au départ des Duvalier, il était pratiquement inconcevable que la panne d’inspiration serait aussi endémique, collective et nationale. Personne ne pouvait anticiper de si beaux jours pour le folklorisme politique. On se rappelle que, face aux enjeux de la dé-duvialérisation, le complot contre le savoir avait donc choisi le personnage le plus obscur du mouvement « ti legliz ». On a donc vu la satrapie « lavalassienne » s’investir de la mission essentiellement folklorique d’assurer le triomphe du faux sur le vrai. Le statu quo a pu non seulement compter sur les bons et loyaux services d’un René Préval mais a été aussi secouru par le rocambolesque Évans « Kompè Plim » Paul. Ce n’est pas contradictoire que ces deux grands chevaliers de l’Ordre du nihilisme haïtien aient tendu la main à « Papa Chawonj la » pour sauver grande vadrouille rose.
Autrement dit, dans notre modèle relationnel de convivialité excessive, chacun a son vaurien présentable, son vilain sympathique et son voyou fréquentable dans l’autre camp. Le vacuum éthique à l’intérieur duquel s’est refermée la société haïtienne est bien présent dans les consciences publiques. Cette façon de voir le monde est bien explicite dans l’expression proverbiale : « Pa gen rat k ap bouche twou kote sourit fin pase, li ka bezwen l yon jou pou l sovetou. » (Le rat ne bouche pas le trou où la souris vient de passer, il peut en avoir besoin un jour). En ajoutant la méfiance que nous traînons depuis les temps pharaoniques, la coterie devient alors une institution pour assurer le triomphe de la corruption. On s’explique ainsi qu’aucun procès contre le régime des Duvalier ni contre ses sbires n’ait eu lieu. À notre tourde spéculer si Jean-Bertrand Aristide, le polyglotte autoproclamé, n’aurait pas été plus utile à la société s’il était né muet. Comme nous l’avons constaté, cette consécration de la facilité a été en réalité un saut dans le vide. Évidemment, les incrédules peinent à se rendre à l’évidence que le moule à fabriquer ces personnages insolites ne donne aucun signe de fatigue ni d’obsolescence.
Toutefois, sur l’échec de la saute d’humeur « lavalas », deux postulats s’affrontent. L’un soutient que ce serait la suite logique du mauvais tournant de 1957. L’autre thèse accuse plutôt que notre conception du chef et de la chose publique n’a pas changé de « Papa Toussaint » à « Ti Pè a » en passant par « Papa Doc ». Cependant, dans les deux hypothèses, il appert que tout se passe comme si Jean-Bertrand Aristide offrait le prétexte idéal à la classe moyenne « noiriste » et mulâtriste de manifester leur haine séculaire contre la masse afro-paysanne. Et ce n’est pas un hasard que ceux et celles qui mangent à tous les râteliers ne ratent jamais la moindre opportunité de les rendre responsables de tous les malheurs du pays. Dans la société haïtienne, peu importe la sincérité des sentiments, l’injure suprême est d’être soupçonné de sympathie pour les opprimés. On s’explique ainsi que la « lavalassophobie » est une carte de visite.
Pour dire les choses autrement, l’Haïtien n’est motivé que par le maintien de son statut et de sa place dans l’ordre social. Pour y arriver, tous les efforts sont déployés. L’essentiel est de projeter une autre image de soi. Largement influencé par une insécurité affective, il est obsédé à changer le regard des autres et semble être toujours en mode séduction. Aussi, passe-t-il un temps fou à se projeter comme une personne amiable et sociable. Le regard de l’autre est fondamental dans la perception qu’on se fait de soi-même. L’essentiel est d’être vu comme un « bons nègres » (de service) pour obtenir la validation des autres afin qu’ils agissent différemment avec nous. Au bout du compte, on a vraiment du mal à imaginer ce qui pourrait empêcher l’Haïtien de sourire. Cependant, si cette attitude n’est pas mauvaise en soi dans la mesure où un sourire, même forcé et faux, peut aider à prendre les choses avec davantage d’optimisme et de recul, toutefois la dynamique des relations sociales qui émerge promeut le déni de réalité et contribue à renforcer la culture du faire semblant.
Évidemment, la séparation du bon grain de l’ivraie n’a jamais été la préoccupation de la société coloniale sans sanction. Dans ce monde où le bandit est légal, on ne maudit pas les « petrocaribards » mais plutôt ceux qui ont eu le courage de dénoncer la concussion des deniers publics. Et comme rien ne doit être négligé pour respirer les odeurs du roi du carnaval, il faut également arborer la couleur rose pour ne pas tomber en disgrâce. Ne faut-il pas vraiment un âge mental ne dépassant pas 5 ans pour afficher de pareils comportements ? Lors des prestations du « Sweet », on se rappelle la facilité déconcertante avec laquelle les imbéciles heureux reprenaient comme à l’école maternelle les refrains « se chen ou ye se pou’w jape…houp, houp, houp, … », « se chat ou ye se pou w myole, myaw, myaw, myaw… », etc. Avec un coefficient mental aussi bas, il devient aisé de comprendre que ceux qui se sont donnés la peine de naître aient revendiqué « tèt kale » pour donner le ton à « lavalas ». Lorsqu’une société décide d’abdiquer sur le rationnel, les soupapes de sûreté fuitent et finissent par sauter. De « Papa Doc » à « Nèg Banann nan » en passant par « Bebe Doc », « Ti Pè a » et « Ti Simone », le folklorisme politique a gagné sur tous les fronts au point où il importe de reconnaître les symptômes d’une schizophrénie collective.
À ce stade de décomposition avancée de la société haïtienne, il importe de rappeler que le « Sweet » avait gagné en popularité en montrant son derrière. Est-ce cet aspect qui avait charmé une Odette Roy Fombrun ? Lorsqu’on sait que les Haïtiens connaissaient déjà l’odeur de la putréfaction rose, que doit-on conclure sur nos outils et référentiels ? Ces questions demeurent sans réponses quoique la panégyriste du « konbitisme » était déjà passée aux aveux et confidences lors du colloque international « Patrimoine, tourisme culturel et développement durable en Haïti : Enjeux et perspectives d’avenir ». Organisée conjointement par l’Université d’État d’Haïti et l’Université Laval par l’entremise de l’Institut du patrimoine culturel, cette activité s’était tenue du 10 au 13 novembre 2011 au Karibe Hotel. Alors, en présence de participants dont l’africaniste Norluck Dorange, Odette Roy Fombrun se devait de s’exclamer : « Martelly, c’est encore nous ! » Vraiment, c’est à se demander comment un membre de la Ligue féminine d’action sociale puisse revendiquer une quelconque affiliation avec un misogyne et un sociopathe de la trempe du « Sweet ». Sachant qu’elle a été l’origine du service civique mixte et obligatoire dans la Constitution de 1987, peut-on conclure qu’Odette Roy Fombrun considère le « Sweet » parmi les richesses culturelles à exploiter ? Autrement dit, connaissons-nous vraiment nos personnalités réputées crédibles et dites morales ?
Au bout du compte, on se rend de plus en plus à l’évidence que la calamité rose a des racines profondes et nombreuses. Si la revendication de la médiocrité a créé un courant nihiliste qui promeut le triomphe du rien et des vauriens, on n’arrive pas cependant à expliquer pourquoi les mulâtres évitent soigneusement de s’identifier à Vincent Ogé, Jean-Baptiste Chavannes, Julien Raimond, Pierre Pinchinat, Louis Jacques Beauvais, Nicolas Geffrard, à Louis Étienne Gabart, ou encore à Boyer Bazelais. La moindre allusion à l’Éntrevue du Camp-Gérard suggère une rencontre au restaurant « Chez Gérard ». Quant aux Jacques Roumain, Dr. Georges Rigaud, Étienne Charlier, Anthony Lespès, etc., ils ont été apostasiés. À la vérité, on ne devrait pas s’étonner de voir la « mulâtraille » se réclamer de la soulouquerie rose. Avec la « négraille » de 1957, elle constitue une paire de racailles qui a toujours encouragé l’encanaillement de toutes les couches de la société. Pour une poignée de dollars, les noiristes comme les mulâtristes sont prêts à tout et même à être des maîtres-chiens. Afin de maintenir leur statut et garder leur place dans l’ordre social, ils ont une longue tradition d’accepter volontairement soit d’être utilisés comme des chiens en laisse, soit de devenir de bons chiens couchants pour réglementer le « chenmanjechen ».
On savait déjà que les Haïtiens ne se faisaient jamais prier pour rendre service au Blanc. En ce sens, nous avons bâti une renommée à toute épreuve. Déjà, le général américain Waller avait constaté en 1916 que les Haïtiens s’offraient volontairement pour être des espions pour les troupes d’occupation.Lisons le général :
« À Cuba pendant longtemps, dit le général américain Waller, je n’ai pas pu recruter un espion. Aux Philippines, la seule fois qu’un homme s’est offert, c’était un agent des rebelles, mais à peine avions-nous débarqué à Port-au-Prince que des citoyens s’engageaient dans notre service d’espionnage. Volontairement. Comment ne pas les mépriser ![i]»
Le mal est donc profond. C’est avec cet état d’esprit qu’il faut appréhender la décoration de Bill Clinton malgré les aveux de ce dernier sur sa participation directe dans l’anéantissement de la filière rizicole haïtienne. Les Haïtiens ont établi une solide réputation de préférer être avilis par un Blanc que de l’être par un Noir. Comme Léon Laleau l’a si bien expliqué, « le coup de pied n’importe pas. Ce qui importe c’est la couleur du pied qui vous entre dans le derrière[ii] ». Cette « blanchitude » revendiquée par les Haïtiens comme valeur dominante n’avait pas manqué d’attirer l’attention de l’anthropologue Michel Rolf-Trouillot en ces termes: « De Toussaint Louverture à François Duvalier, en passant par Dessalines et Salomon, ils misaient tous dans un certain futur clair. Ce n’est pas sans raison que Jean-Claude Duvalier fut mulâtriste dans sa pratique : les présupposés venaient d’en haut. Fou qui croit que Jean-Claude Duvalier trahissait le rêve : C’était ça, le rêve ![iii]» Le moins qu’on puisse ajouter est que le déterminisme épidermique de la « blanchitude » a été bien mis en orbite dans la lignée du dépositaire de la négritude totalitaire. De François à Nicolas en passant Jean-Claude, les Duvalier ont tout fait pour démontrer que l’épiderme est resté un marqueur social suprême. En bons Saint-Dominguois, ils ont illustré de fort belle manière que le mulâtrisme est l’horizon indépassable du noirisme.
Sans surprise et avec une étonnante habilité, les « tèt kale » se montrèrent à la hauteur de leur réputation. En ajoutant la touche ludique au faire semblant, ils n’ont pas démérité de leurs mentors duvaliéristes. Des moments forts de cette grande vadrouille, retenons le bracelet rose qui avait remplacé le bracelet en or des « tonton makout ». La chemise rose substitua au safari bleu. Seul le foulard rouge retenu autour du cou par la boîte d’allumette n’a pas été reconduit. Cependant, le raffinement du simulacre allait pousser le « Sweet » à louer pendant son quinquennat un avion pour ses déplacements à l’étranger. Dans l’entendement de ce dernier, étant donné que le président américain dispose d’Air Force One, le président haïtien se devait de donner la réplique avec FADH One. L’illusion des sens a encore bien eu raison des Haïtiens. Les semences de l’ignorance du mauvais tournant de 1957 ont tenu leurs promesses avec les hibiscus fanés de Stéphanie Balmir Villedrouin. Particulièrement, l’histoire doit retenir que tous les records de la frime et du simulacre ont été battus par les « tèt kale ».
La moisson a été si abondante que les dépositaires du folklorisme politique se devaient de parachever l’imposture. Pour une tâche aussi délicate, l’ordre de mission a été remis à un alchimiste aux pouvoirs illimités sur les éléments (eau, terre, soleil, etc.). Évidemment, d’une manière générale, le commun des mortels a toujours été fasciné par les coups d’audaces et les faussaires très habiles. Aussi les menteurs impénitents ont-ils pu parvenir à leurs fins en exploitant les faiblesses de la société. Nous attirons ici l’attention sur la caravane du faire semblant, une « structure présidentielle paraministérielle » pour parler comme Robenson Geffrard dont le premier pas a été de marcher à reculons comme les écrevisses. Puisque jusqu’ici rien ne parait annoncer la victoire de la gouvernance de soi sur la vacuité d’être, ces personnages folkloriques n’ont pas fini de défiler. Mais comment expliquer une société haïtienne incrédule et ébahie devant des crimes presque parfaits commis par des criminels notoires écrivant les plus belles pages de l’escroquerie et de la fraude ? Clairement, si la première expérience de décolonisation n’était pas devenue depuis le mauvais tournant de 1957 une république de non-voyants, le public s’en serait déjà lassé.
C’est assurément l’observation de ce phénomène qui fit dire à Louis Joseph Janvier en 1908: « Singulier petit pays, même les cochons, s’ils le pouvaient, le quitteraient. » Ce que dénonçait Janvier est le reflet de notre éducation de base qui tend à créer des individus narcissiques persuadés que le monde tourne autour d’eux. De ce fait, notre conscience s’en ressent car elle ne voit pas immédiatement l’ensemble mais plutôt l’individu. Sans libre arbitre, l’arbitraire devient la source de pouvoir. Avec cette vision du monde, on peut expliquer ainsi l’absence du mot « droit » dans l’Acte de l’Indépendance. Fait significatif démontrant que nous sommes les dépositaires de la pédagogie coloniale de l’arbitraire d’autant plus que le document fondateur est rédigé par Boisrond Tonnerre, un mulâtre qui fit ses études en France à un moment où la question des droits de l’homme et du citoyen était grandement agitée. Ainsi, le type de pouvoir que les anciens commandeurs exerçaient sur la plantation devint le paradigme de commandement dans la première expérience de décolonisation.
De ce navet en rotation permanente, nous retenons un maquillage horrible, des acteurs piètres et mal fagotés, une abominable mise en scène et un décor lamentable. Pour diriger cette horrible pièce, le régisseur ne s’occupe ni des lumières ni du son mais plutôt du montage et du démontage du décor. La coordination de la fatalité représente le nœud dramatique de cette tragi-comédie et le dénouement de l’intrigue débouche toujours sur de nouvelles aventures rocambolesques. Fou qui croit que les cerveaux lents commencent à se lasser de ce spectacle dégueulasse. Alors, au milieu de toutes ces considérations, des questions encore plus pertinentes émergent. Sans pour autant faire un clin d’œil au génocide vendéen qui avait inspiré Boisrond Tonnerre, comment rédiger le bilan de cette calamité ? Ne faudrait-il pas un bistouri pour plume, du fiel pour encre, le crâne d’un « tèt kale » pour encrier et la soutane « rose » du prince de l’Église pour parchemin ?
[i] Antoine Pierre-Paul, La première protestation armée contre l’occupation américaine, op. cit., p. 47.
[ii] Léon Laleau, Le Choc : chronique haïtienne des années 1915-1918, Port-au-Prince, Librairie La Presse, 1932 ; Port-au-Prince : Imprimerie Centrale, 1975, p. 88.
[iii] Michel Rolf-Trouillot, Les racines historiques de l’État duvaliérien, Port-au-Prince, Deschamps, 1986, p. 136