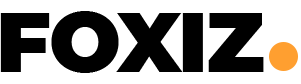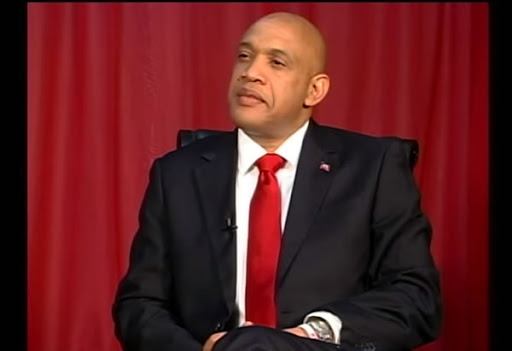« La population des quartiers contrôlés par des bandes armées endure un niveau de violence intolérable : entre janvier et juin 2020, le Binuh a documenté qu’au moins 159 personnes ont été tuées et 92 autres blessées — y compris des enfants, en raison de la violence liée aux gangs », indique la représentation de l’ONU dans un communiqué de presse.
Des manifestations pour dénoncer ce climat de violence totale ont eu beau avoir lieu dans les rues de la capitale, rien n’a changé. Dans les mêmes rues, les hommes des gangs ont ensuite défilé à leur tour, sans la moindre honte, levant au contraire leurs armes automatiques et tirant en l’air pour montrer leur force. Pas le moindre policier n’a osé intervenir.
Les membres des gangs sont les êtres « les plus vils, malades et vicieux qui existent au monde » éructait Donald Trump fin mars 2019 lors d’un meeting politique à Grand Rapids, dans l’état du Michigan. Cette déclaration violente à l’encontre des « gangs » qui sévissent aux États-Unis n’est pas sans rappeler celle qu’il avait déjà faite en mai 2018 lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, qualifiant ces criminels d’animaux.
Trump a largement déployé ce discours envers les membres de gangs pour justifier certaines de ses actions politiques ou médiatiques, telle que la construction potentielle d’un mur entre les frontières américaines et mexicaines afin de protéger les citoyens américains de gangs latino-américains dont la référence principale est le MS-13.
Ces visions mélodramatiques des gangs comme la personnification même de la violence, du danger et de la brutalité, voire de la barbarie sont cependant à la fois anciennes et bien diffusées à travers les institutions politiques, juridiques et l’opinion.
Or, si elles servent le propos de certains acteurs politiques, elles cachent cependant tout ce que les gangs révèlent de nos sociétés et que nous refusons de voir.
Dans l’imaginaire collectif, les gangs représentent des phénomènes incontrôlables semant l’anarchie, le chaos et la destruction.
Leur brutalité pathologique est de mise dans les médias, les récits et les films.
En Amérique Centrale, un cas classique est celui des maras ou pandillas, perçus comme les acteurs principaux d’une criminalité largement étendue mais dont la violence surpasserait celle des nombreux conflits révolutionnaires armés ayant ébranlés la région dans les années 70 et 80.
Les gangs de cette région ont particulièrement été décrits par les institutions juridiques et les journalistes comme une menace sécuritaire, voire comme une « une nouvelle forme d’insurrection urbaine » qui tenterait de renverser le pouvoir.
La réponse publique a été celle de la répression violente, à tel point qu’il n’est pas exagéré de décrire les états d’Amérique Centrale comme menant une guerre aux gangs.
Ces constructions alarmistes se fondent souvent sur des stéréotypes et des modes, que ce soit en Amérique Centrale ou au-delà.
Cependant, elles demeurent diffuses notamment parce que les gangs forment des boucs émissaires idéaux pour les autorités, permettant de justifier des formes de contrôle étendues et des interventions musclées, y compris par le biais de la ségrégation spatiale comme c’est par exemple le cas au Nicaragua où de nouvelles formes d’organisation spatiale des villes sont censées préservées certains habitants des « gangs ».
Ces stéréotypes perdurent d’autant plus que les gangs constituent un phénomène universel, historique et contemporain à la fois.
L’historien romain Titus Livius, connu sous le nom de Livy, montre dans son ouvrage de référence, Ab Urbe Condita que les gangs criminels ont joué un rôle éminemment politique durant la République romaine au Ier siècle de cette ère.
Il décrit ainsi la façon dont les politiciens se sont appuyés sur les bandes rivales pour établir physiquement l’assise de leur pouvoir, mobiliser des soutiens ou au contraire, perturber ceux de leurs opposants. Ce phénomène a également été mis en lumière dans la fiction du romancier Robert Fabbri ‘Crossroads Brotherhood Trilogy’.
Plus d’un siècle de recherches sur les gangs ont montré qu’ils existent dans des pays aussi divers que les États-Unis, le Kenya, l’Afrique du Sud, le Brésil, le Salvador, le Nicaragua, la Chine, l’Inde, la France et le Royaume-Uni, parmi d’autres.
L’ubiquité des gangs laisse clairement voir que ce sont des systèmes sociaux institutionnalisés. Le sociologue américain Frederic Thrasher écrivait d’ailleurs dans son étude pionnière au sujet des gangs de Chicago dans les années 20, que ces derniers témoignaient d’une
« vie, dure et sauvage [et donc] riche en éléments et processus sociaux clefs pour la compréhension de la société et de la nature humaine ».
Les gangs s’insèrent dans un vaste panel de pratiques humaines comme l’exercice du pouvoir politique, l’accumulation du capital, la socialisation, la définition de l’identité d’un individu et d’un groupe, le contrôle d’un territoire, le défi de l’autorité et la structuration des relations de genre. Tous ces processus, communs à l’ensemble du genre humain sont particulièrement intéressants à observer du point de vue des gangs.
C’est aussi pour cette raison qu’ils offrent, d’une certaine façon un miroir pour la société, mettant en évidence ses traits et ses tendances les plus crispantes.
L’étude de Thrasher a ainsi pour mérite non seulement de présenter des détails sur le fonctionnement des gangs de Chicago mais aussi d’illuminer l’économie politique et sociale de la ville. Il fait ainsi le lien entre l’émergence des gangs et les communautés – souvent immigrantes – socialement exclues dont les droits ont été bafoués, pointant les inégalités criantes et croissantes de la société américaine des années 1920 et 30.
Les gangs ne constituent pas juste un phénomène social autonome aux logiques internes complexes, avec des dynamiques propres, mais sont donc aussi des épiphénomènes, qui reflètent et sont formés par une structure sociale plus large.
Ils nous montrent ainsi les changements au sein de notre société.
Dans ses recherches, le sociologue Sudhir Venkatesh a étudié les activités économiques d’un gang de rue à Chicago dans les années 1980 et comment ce dernier a bouleversé le marché de la drogue, en individualisant peu à peu un système de ventes auparavant collectif, imitant en cela les tendances de l’économie américaine, la « Reaganomics » poussant vers toujours plus d’individualisme.
De manière similaire, le travail des sociologues français Marwan Mohammed et Laurent Mucchielli a mis en lumière comment l’évolution des gangs en France, en particulier des « blousons noir » dans les années 50 et 60 aux gangs des Zoulous dans les années 80 pouvait être liée à la fin des « trente glorieuses » et la restructuration profonde de l’économie française qui s’en suivit.
Comprendre la logique des gangs nous informe ainsi sur des changements sociétaux plus larges. Ainsi lorsqu’un gang devient plus violent ou lorsque ses activités se recentrent sur un secteur à l’exclusion d’autres, cela peut marquer un tournant dans les politiques publiques de répression ou de discrimination à l’égard de certains groupes de la société. Par exemple, le fait que les gangs d’Amérique centrale soient devenus de plus en plus brutaux et qu’ils soient passés de l’action d’autodéfense à l’extorsion et au trafic de drogue peut être associé à la nature de plus en plus oligarchique et ségrégative des sociétés dans la région.
Plus les gangs sont armés et puissants, plus ils veulent régner sur des quartiers entiers et se font évidemment la guerre. Cet été notamment, Cité Soleil s’enflamme de nouveau. Le vaste bidonville qui s’enroule autour de Port-au-Prince, comme les favelas brésiliennes à Rio de Janeiro, en a pourtant connu, des pics de violence ! Mais cette fois, l’intolérable a été atteint.
A la mi-juillet, un nourrisson de huit mois a été tué par balles au cours d’un affrontement entre bandes au coeur du bidonville, puis au début du mois d’août, un autre bébé de quatre mois y est mort dans les mêmes circonstances. Leurs familles éplorées ont reçu un grand soutien de la population locale, choquée, profondément émue, révoltée. Mais pas un mot, pas un geste des forces dites de sécurité et de la classe politique.
Les gangs sont volatiles. Ce qui implique dans toute enquête d’aborder la question de leur émergence, leur propagation, leur évolution et leur déclin en évitant de les catégoriser ou de les définir d’une manière trop rigide.
Par exemple, nous devons nous demander ce que nous entendons par le terme « gang ». Ce mot n’est pas seulement chargé, il est aussi utilisé de manière très variable, appliqué à des phénomènes sociaux qui incluent le crime organisé, des associations de détenus dans les prisons et même des groupes informels de jeunes au coin de la rue qui adoptent un comportement « antisocial ». Ils peuvent aussi changer de forme rapidement : le gang de jeunes d’aujourd’hui pourrait devenir une organisation de trafic de drogue demain, et une milice politique le surlendemain.
Nous avons donc besoin d’une définition large qui nous permette d’englober ces différentes itérations. Nous devons aller au-delà de la seule dynamique organisationnelle ou de l’appartenance à un gang, et considérer leur environnement et leurs circonstances structurelles, y compris la façon dont ils se connectent à d’autres acteurs tels que des membres du crime organisé, la police (PNH), les politiciens (parlement )ou les élites du monde des affaires et entrepreneurs, entre autres.