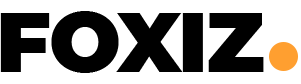Les paysans, qui composent la majorité de la population, ont toujours été exclus de la vie politique. Ils doivent maintenant pouvoir y participer comme citoyens à part entière.
Le séisme du 12 janvier 2010 est vécu par le peuple haïtien comme un immense malheur social. On compte, d’un côté, ce qu’on a perdu : disparition de son chez-soi, de proches intimes, des relations de voisinage, des repères de son quartier et de sa ville. De l’autre, on a sous les yeux la tristesse ou l’indignation que suscite ce qui reste : le handicap physique de parents rescapés qui ont dû être amputés pour être sauvés; les camps de tentes improvisés aux conditions de vie exécrables, durablement installés dans la promiscuité; l’espoir profondément fissuré d’un lendemain meilleur, au vu d’une gouvernance désordonnée et sans vision face à l’immensité et la nouveauté des défis de l’après-séisme. Plus que l’effondrement visible d’infrastructures physiques, ce qui inquiète surtout, c’est l’effilochement avancé du lien social et l’affaissement de la capacité de l’État d’assurer les conditions du vivre-ensemble.
Bien sûr, il faut reconstruire; on le dit vite dans l’urgence mais, dans les faits, on attend encore le début de la reconstruction un an après le séisme. La question préalable est de savoir ce qu’on entend par « reconstruire Haïti ». Les Haïtiens répondent tous ou presque qu’il s’agit de « refonder la nation ». Un enjeu capital remis à l’ordre du jour par le séisme.
On pourrait croire qu’un projet de société nouvelle est en train de s’instituer à nouveau dans l’imaginaire et que le vieux régime d’inégalités et d’injustices s’est effondré avec le séisme. Ce projet, en tant qu’imaginaire social de masse, remonte aux années 1980. Il a été l’horizon du mouvement social pour le changement[1] qui appelait à la construction d’une société de droit, de justice, d’égalité, de solidarité. Il a conduit à la chute du régime Duvalier et, plus tard, à l’accession au pouvoir de Jean-Bertrand Aristide. Animé par l’Église catholique, ce mouvement social demandait la fin de la société où « bourik travay chwal galonnen » (l’âne travaille, le cheval en tire les galons), la fin de « Leta kraze zo » (l’État répressif), la fin du quasi-apartheid social structuré en, d’un côté, une élite urbaine et, de l’autre, une paysannerie exclue de la citoyenneté, le tout en vue de l’intégration nationale.
Une société d’exclusion
L’exclusion dont la paysannerie est l’objet est institutionnalisée, massive et totale. Elle touche la majorité de la population du pays et s’exerce dans tous les rapports sociaux, politiques, économiques, sociaux, culturels. Elle définit à la fois la société haïtienne et la condition paysanne en Haïti : société élitaire d’exclusion, paysan « moun andeyò » (gens en dehors).
Exclusion économique. Encore aujourd’hui, une grande partie des cultivateurs haïtiens sont de tout « petits paysans » propriétaires – souvent sans titre de propriété assuré – de lopins de terre minuscules, dits « mouchoirs de terre » dans leur langage imagé. Sans soutien gouvernemental à l’agriculture, ils se voient obligés, pour survivre dans la misère, de se livrer à une culture intensive et de chercher à augmenter le périmètre cultivable en coupant les quelques rares arbres et arbustes protecteurs. Ce faisant, et en l’absence de toute intervention de l’État, ils se trouvent, malgré eux, à contribuer à la dégradation continue des sols, à l’érosion des terres et à la déforestation, participant ainsi au processus cumulatif qui cause le sous-développement. Pour arriver au moins à nourrir un peu – le plus souvent mal – sa famille, le petit paysan propriétaire doit aussi cultiver des parcelles des grandes terres des riches propriétaires fonciers (la récolte est partagée à égalité entre le propriétaire et le cultivateur), ou cultiver, à titre de « fermiers », des parcelles des terres de l’État et de citadins absents.
Émergées de la dynamique du mouvement social pour le changement, deux grandes organisations d’implantation régionale et d’influence plus ou moins nationale regroupent et défendent aujourd’hui les intérêts de ces paysans pauvres : ce sont le Mouvement paysan de Papaye (MPP) implanté surtout dans le département du Centre, et l’organisation Tèt Kole ti Peyizan (TKP) – Union des petits paysans –, surtout active dans le département du Nord-Ouest. Avec d’autres organisations paysannes d’influence exclusivement régionale ou locale, elles mènent la lutte contre l’exclusion historique et systémique de la paysannerie.
Exclusion géographique et culturelle. Depuis toujours, les campagnes et leurs « habitants » existent à peine dans l’agenda et les politiques gouvernementales; ils sont privés de tout service public. Pas de routes intérieures pour sortir le paysan de son isolement ancestral, permettre la circulation entre les localités, entre les régions et avec les centres urbains, faciliter la distribution des récoltes paysannes, dont une grande partie est perdue faute de moyens de transport.
Le paysan est socialement stigmatisé. Il est classé tout au bas de l’échelle sociale, presque au rang de sous-être humain : « se pa moun » (il n’a pas la qualité d’être civilisé), entendre par là qu’il appartiendrait à une ethnie particulière et inférieure. Jusque dans les années 1960, son acte de naissance (quand il en a un) portait la mention distinctive de « paysan ». Du point de vue juridique et politique, ils ne sont pas des citoyens : ils naissent et meurent à l’insu de l’État. Aux yeux de la République élitaire, la paysannerie ne mérite ni attention, ni considération. Dans la pratique, elle est tenue en dehors des préoccupations de l’État et du regard de l’élite dite éclairée, confrontée à un quasi-apartheid culturel.
Exclusion sociale et politique. Jusqu’à la première moitié du XXe siècle, la paysannerie n’a disposé d’aucune école publique pour l’éducation de ses enfants. Un ministre de l’Éducation sous la présidence d’Élie Lescot (1941-1946), qui voulait étendre l’instruction aux enfants des « classes inférieures » et prônait l’enseignement en créole (la seule langue comprise d’elles), fut pris à partie par l’élite traditionnelle qui n’en voyait point l’utilité sociale. Pendant longtemps d’ailleurs, l’école rurale relevait du ministère de l’Agriculture, de façon à être bien distinguée de l’école des villes dépendant du ministère de l’Éducation. Dans le domaine de la santé et des services sociaux aux paysans, c’est la même chose : pas d’hôpitaux, peu de dispensaires. Heureusement, les églises et les ONG y ont longtemps suppléé, à la mesure de leurs moyens. Mais cette action palliative n’empêche pas le fait que l’espérance de vie soit très basse – aujourd’hui encore, elle se situe à moins de 50 ans.
De la vie politique du pays, le paysan a été tout simplement écarté. Si, au moment des luttes sanglantes pour le pouvoir entre les différentes factions de l’élite urbaine, il y apparaissait en arrière-scène, c’est plutôt en tant que figurant forcé ou manipulé. Il a fallu attendre le recul du régime militaire et la fin de la dictature des Duvalier pour le voir entrer en scène comme acteur collectif dans les années 1980, au sein du mouvement social pour le changement.
La cumulation de toutes ces formes d’exclusion exprime la nature du système social haïtien structuré en « république élitaire » d’un côté, et « pays en dehors » de l’autre.
Une nécessaire refondation
La nécessité de refonder cette société inégalitaire a été mise en lumière par de nombreuses études sociologiques sur les paysans haïtiens et l’économie rurale. L’ouvrage Haitian people (Yale University Press, 1941) de James Leyburn montre comment la société est divisée en une mince élite urbaine exclusiviste et une masse paysanne assujettie. Celui de François Blancpain, La condition des paysans haïtiens (Karthala, 2003), étudie les législations oppressives de l’État et ses codes ruraux consacrant la dépendance du paysan. De même, l’étude de Mats Lundahl, Peasant and Poverty (St. Martin’s Press, 1979) relie la paupérisation croissante du paysan et le sous-développement du pays aux pratiques prédatrices d’un État parasite, qui surtaxe le paysan sans lui offrir aucun service. Plus explicitement, Le paysan haïtien de Paul Moral (Éd. Maisonneuve et Larose, 1961) montre l’obstacle insurmontable que constitue « l’anonymat légal, admis, de la paysannerie », son exclusion institutionnalisée. L’auteur insiste sur la nécessité fondamentale de satisfaire « les besoins généraux, impérieux » du paysan, de « rompre l’isolement ancestral des campagnes, [de] les faire participer largement à la vie nationale » et d’achever ainsi l’édification de la nation haïtienne.
Le sens de la refondation d’Haïti a donc été dégagé depuis longtemps. Celle-ci passe par la désertion de la société haïtienne hiérarchisée en « pays en dehors »[2] composé de paysans dépendants d’une république élitaire urbaine. Elle consiste en la reconstruction d’une société nouvelle fondée sur la reconnaissance égale de tous ses membres et leur intégration dans une même communauté solidaire.
Comment traduire ces principes et orientations en politiques concrètes dans la situation de l’après-séisme? Quelles mesures effectives correspondent à la perspective de refondation nationale au sens depuis longtemps dégagé? En premier lieu, il s’agit de reconnaître pleinement le paysan comme acteur politique, en vue de le sortir de « l’anonymat légal » qui le refoule dans la marge d’une société élitaire et le prive des services publics (éducation, santé, bien-être social, routes, encadrement agricole, soutien technique et financier, etc.). La pleine reconstruction d’Haïti passe par la prise en considération de ces laissés-pour-compte majoritaires. Qu’ils soient enfin reconnus comme des citoyens égaux et, plus encore, dans le sens de la demande de l’Église catholique et du mouvement social pour le changement des années 1980, comme êtres humains intégraux reconnus dans tous leurs droits : « tout moun se moun » (tout être humain est digne de reconnaissance). Les revendications principales de la première révolte paysanne significative de l’histoire d’Haïti (1844-1848) sont encore à l’ordre du jour. Dirigés par Jean-Jacques Acaau et réunis dans « l’armée souffrante », les paysans du Sud demandaient : « Des écoles! De la terre! Baisse des prix trop élevés des produits de commerce des villes! ».
Concrètement, l’intégration des paysans comme citoyens égaux exige la décentralisation politique du pays – prévue par la Constitution de 1987 – et des programmes de développement local au profit des communautés paysannes. Les paysans se sont déjà donné des organisations autonomes de promotion de leurs propres intérêts. Ils sont aujourd’hui un acteur collectif visible et reconnu sur la scène nationale et sont en voie de s’intégrer dans les réseaux de solidarité des organisations militantes des Caraïbes et des Amériques. L’actuel président de Via Campesina est le coordonnateur du Mouvement paysan de Papaye. Reste aux autorités politiques du pays à soutenir leurs efforts d’auto-organisation et leurs initiatives d’auto-développement économique à travers des entreprises d’économie sociale solidaire (coopératives de production et de transformation, caisses populaires d’épargne et de crédit, mutuelles de solidarité).
En outre, leur intégration citoyenne exige des politiques publiques de soutien à l’agriculture et à la paysannerie. Haïti dépend de son économie rurale; son secteur industriel est rachitique et repose sur une industrie d’assemblage mobile qui peut être à tout moment relocalisée, dépendant de la direction vers laquelle souffle le vent du marché. Le mouvement paysan a constamment demandé la sécurisation des titres de propriété des lopins de terre des familles paysannes menacées de dépossession. Celles-ci les ont acquises en vertu de la loi haïtienne qui prévoit qu’une terre cultivée pendant 20 ans d’affilée sans réclamation devient la propriété de celui qui la cultive. Mais sans enregistrement légal, certains en profitent pour les en déposséder. Le mouvement paysan réclame aussi une réforme agraire, consistant notamment à redistribuer aux paysans les terres appartenant à l’État et confisquées par les grands propriétaires terriens. Il demande aussi le soutien technique du gouvernement, la disponibilité de crédit pour la production agricole (il n’y a pas de banque de crédit agricole pour la petite agriculture et les banques ne prêtent pas au petit paysan), un programme d’irrigation et de protection de l’environnement, l’érosion et la déforestation étant responsables des inondations destructrices qui emportent les champs et le bétail et menacent la survie de tout le pays.
Reconstruire Haïti, c’est d’abord reconstruire la base de l’auto-développement durable du pays. Forcé par le FMI et les États-Unis d’ouvrir son marché aux productions agricoles étrangères, industrialisées et subventionnées, Haïti doit maintenant importer quelque 60 % des produits alimentaires nécessaires à sa subsistance, pendant que l’agriculture artisanale agonise et que les paysans souffrent de plus en plus de la faim. La principale demande actuelle du mouvement paysan haïtien, c’est la souveraineté alimentaire misant d’abord sur la production agricole nationale pour nourrir le peuple haïtien.
Franklin Midy
[1] Voir l’article de Fritz Deshommes dans ce dossier.
[2] Voir Gérard Barthélémy, Pays en dehors, Paris, L’Harmattan, 1990.