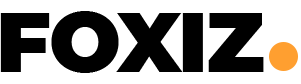Le XXIe siècle est marqué par l’étiolement, l’inefficacité et l’instabilité du pouvoir. Moises Naim, chercheur au Carnegie Endowment for International Peace et ancien rédacteur en chef de Foreign Policy, analyse dans un livre remarquable* ce qu’il nomme «la fin du pouvoir» qui frappe les conseils d’administration, les syndicats, les Eglises et naturellement les Etats.
Le plus fort gagne de moins en moins de conflits armés, selon une étude de Harvard. Entre 1800 et 1849, le plus faible n’a gagné que 12% des conflits. Mais entre 1950 et 1998, il l’a emporté dans 55% des cas. Les coûts sont de plus en plus asymétriques. Al-Qaida a dépensé 500 000 dollars pour produire le 9/11, mais le coût des destructions et de la réponse américaine a dépassé 3300 milliards, le cinquième de la dette du pays. Il en va de même des attaques des pirates au large de la Somalie ou du conflit au Mali.
Le pouvoir est défini par l’auteur comme la capacité à diriger ou empêcher les actes présents ou futurs d’autres groupes ou individus. Il s’appuie sur quatre instruments dont l’efficacité est dorénavant remise en cause: la force ou sa menace, la récompense, le code (tradition, morale, attentes sociales), la persuasion (publicité).
Selon la thèse de Moises Naim, l’efficacité de ces instruments est menacée par trois «révolutions», celle du «toujours plus», celle de la mobilité et celle des mentalités.
Au XXe siècle, en vertu des théories de Max Weber, la clé du pouvoir dépendait d’une organisation bureaucratique bien huilée. Couplée à l’effet de taille, elle permettait de réduire les coûts de transactions. En économie, l’emblème de ce modèle était incarné par General Motors.
Le déclin du pouvoir centralisé a débuté le 9 novembre 1989 avec la chute du mur de Berlin, selon l’auteur. Les opportunités ont alors explosé. Le «toujours plus», soit l’augmentation des richesses et des choix, a profité à tous les pays et individus, mais il a perturbé l’exercice du pouvoir et changé les mentalités. Depuis 1950, le PIB mondial par habitant a été multiplié par 3,5 bien que la population se soit accrue de 2 milliards. Et la qualité de vie s’est améliorée. Ces dix dernières années, la mortalité infantile a diminué de 17% dans le monde. La classe moyenne s’est développée très vite. Elle a doublé en trente ans pour atteindre 2 milliards d’individus en 2012 – en dépit du discours misérabiliste propagé par les syndicats et le Parti socialiste suisse. Face à ces nouvelles richesses, il est toujours plus difficile pour un Etat centralisé de contrôler, surveiller et réglementer l’individu.
Les effets de la «révolution de la mobilité» altèrent également l’efficacité du pouvoir. Répondant à une évaluation relative de leur avenir, les gens quittent souvent leur pays. Il y a 214 millions de migrants en 2012, en hausse de 37% en vingt ans. De même, il est de plus en plus difficile de gérer les frontières ou d’administrer une audience captive avec le développement des moyens de communication: 6 milliards d’abonnés à la téléphonie mobile, 700 millions à Skype, plus de 2 milliards d’individus connectés à Internet.ADVERTISING
Les mentalités changent aussi. Les aspirations des gens se développent bien plus vite que la capacité des gouvernements à les satisfaire, selon l’auteur. La confiance du citoyen à l’égard des autorités ne peut qu’en souffrir.
Ce n’est plus la taille, l’étendue, l’histoire et la tradition qui déterminent les événements. L’heure appartient aux «micropouvoirs», selon l’auteur.
Les entreprises sont également frappées par cette transformation. Le patron est assis sur un siège éjectable: chaque année, 14,4% des directeurs généraux des 2500 plus grandes entreprises au monde perdent leur emploi. Et les centres de décision se déplacent de plus en plus vers le Sud: 20 000 multinationales ont leur siège dans un pays émergent.
Dans tous les domaines, le pouvoir est à la fois plus aisément accessible et plus difficile à conserver et à exercer. Les barrières qui protégeaient le pouvoir se sont abaissées.
Face au déclin du pouvoir, les gouvernements peinent, ne prennent que des décisions de dernière minute qui ne résolvent pas les vrais problèmes. Les accords multilatéraux se raréfient, les veto se multiplient. Et la défiance s’accroît. Certes, la proportion de démocraties dans le monde s’est accrue de 50% en vingt ans. Mais parallèlement, seuls quatre des 34 démocraties les plus «riches» ont un gouvernement capable de s’appuyer sur une majorité au parlement. Incapables de procéder aux réformes, les Etats sont paralysés.
La fin du pouvoir est peut-être une chance. Selon l’auteur, elle rend les sociétés «plus libres, accroît la concurrence et les options». Elle ouvre de nouvelles perspectives. Mais le déclin du pouvoir porte en germe différents dangers, de l’incapacité des gouvernements à décider à l’émergence de mouvements extrémistes.
Le problème est avant tout politique. Les systèmes de contrôle et d’équilibre sont nécessaires à la prospérité d’un pays, mais à partir d’un point optimal, aujourd’hui dépassé, ils réduisent la stabilité et le bien-être.
Le modèle se heurte à un «problème d’action collective», selon Moises Naim. «Personne ne peut réaliser les changements nécessaires et tous les acteurs sont incités à l’attentisme», écrit-il. Face à ces blocages, méfions-nous de ceux que l’historien Jacob Burckhardt appelait les «terribles simplificateurs», les mouvements d’une seule cause et autres idéologues du grand soir.
L’auteur plaide alors en faveur d’un large débat sur les conséquences de la fin du pouvoir. Car seule une politique largement partagée peut être mise en place. Il faut éviter les «discussions d’ascenseur», selon lesquelles un pays ou une catégorie est en hausse et une autre en baisse. La solution doit être «inclusive». En effet «le monde est devenu interdépendant. Pour la première fois dans l’histoire, il n’appartient plus à un pays représentant le centre de gravité», explique Charles Kupchan. Avec la fin du pouvoir, le monde n’est plus décidé de haut en bas, mais de bas en haut. Et si l’innovation n’a jamais été aussi vive en économie, en politique elle se fait attendre. De nouvelles institutions sont à créer.
Aussi longtemps que nous ne changeons pas notre façon de voir le monde, nous serons toujours ce que nous sommes et la Constitution demeurera ce qu’elle est. C’est à nous de nous hisser à la hauteur de la Constitution. Nos déficiences ne seront jamais lois.
La promulgation des Décrets par le Président Jovenel Moise, hors des couloirs parlementaires, est une violation du principe fondateur de la démocratie : la séparation des pouvoirs. Et je me demande perplexe : si ce n’est pas cette velléité de diriger par décret qui nous empêche d’organiser les élections à temps ?
Pourtant, l’article 150 de la Constitution est tranchant : “Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution” . Qui saurait me dire par quelle norme constitutionnelle le Président de la République peut prendre des décrets d’intérêt public ayant force de loi ?
Par dessus-tout, les articles 60 et 60.1, dans un style lapidaire, disposent : “Article 60 : Chaque Pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu’il exerce séparément. Article 60.1 : Aucun d’eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la Constitution et par la Loi .
Somme toute, on ne peut pas gérer un pays sans le respect scrupuleux des lois, ni repère. Je suis tristement persuadé que l’imaginaire haïtien a horreur des lois et en manifeste au plus haut sommet une aversion inédite. Dès qu’on dit loi, on cherche d’ores et déjà à la contourner.
Comme par une réminiscence désagréable, les lois semblent nous rappeler les temps génocidaires de l’esclave et de la colonisation. Combien de fois n’avons nous pas entendu un Juge de la Cour de Cassation dire : « Il n’y pas de loi en Haïti » ; et un Premier Ministre crié : « Haïti n’existe ni dans le réel, ni sur le papier ».
Il est temps qu’on cesse de rechercher des excuses préfabriquées pour ne pas organiser des élections. Il est temps qu’on sache quand quelqu’un est incapable de respecter un devoir constitutionnel, il n’a qu’à tirer la révérence. Lors des campagnes, nous faisons croire au peuple que Haïti sera plus belle que les Etats-Unis en deux ans.
Et quand nous parvenons à nous hisser au timon des affaires de l’État, nous nous pressons de déclarer publiquement que ce sont les difficultés qui nous empêchent de respecter et de faire respecter la Constitution. Quelle ignominie ! Quelle personnalité, quelle mentalité qui entremêle souhaits et résultats.
De même, gare à tous ceux qui crient à tout bout de champs : dialogue national, conférence nationale, états généraux et leur générique. Nous ne respectons pas nos engagements parce que nous savons qu’à la fin nous solliciterons un dialogue national.
Notre supercherie et nos mascarades deviennent rébarbatives et révoltantes. Aucun dialogue national ne sera efficace si les responsabilités ne sont pas attribuées et les coupables rétribués. Lorsque ceux qui ont délibérément violé la Constitution crient au dialogue, nous prenons tout le monde pour des nuls accomplis.
S’il faut rebattre les cartes, s’il faut relancer la partie mal jouée, il faut préalablement juger les présumés coupables. On ne construit rien de grand et de durable sur l’impunité. Sinon, nous aurons encouragé les futurs candidats à préparer leur petit tour de mensonge et de coquinerie. C’est ce qui explique l’échec assuré de nos dialogues et accords « bidon ».
Le pire des choses, chaque candidat a dans sa poche sa propre Constitution qui s’adapte à ses propres lacunes. D’où le discours le plus populaire et populiste : changeons la Constitution. Prenons-en conscience ! Alors que celle qui est en vigueur n’a jamais été respectée, ni mise à l’épreuve de son application. D’ailleurs, pas un seul Conseil Electoral Permanent depuis 1987, après 33 ans ! Et nous voulons changer quoi ?
En fin de compte, le président Jovenel Moise n’est pas habilité à prendre des décrets ayant force de loi dans l’intérêt public. Ces attributions relèvent de la compétence exclusive du Parlement et aucune délégation de pouvoir n’en a été prévu. En outre, le président Jovenel Moise aurait dû prêter serment le 3 janvier 2017. Cela n’a pas eu lieu. La Constitution a été violée et la prestation de serment le 7 février n’a aucun fondement constitutionnel. Dans son silence, il a cautionné cette violation.
Au nom du principe Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans, « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (négligence, faute, comportement illégal ou fraude), le président ne peut profiter de cette erreur monumentale à laquelle il a participé.
Il en résulte que la violation de la Constitution lui enlève toute qualité de faire prévaloir un droit qu’il n’a pas défendu pour des raisons que la raison connait. Donc, le Président doit partir le 7 février 2021.
En attendant, il n’est pas autorisé à prendre des Décrets ayant force de loi. Il ne peut non plus nommer ces citoyens à des postes électifs, ni leur conférer des prérogatives y afférentes, peu importe le nom qu’on leur donne.
De même, que ceux qui vont concourir aux prochaines élections sachent que les pendules constitutionnels sont en marche et ne s’arrêteront point pour plaire aux individus qui auront des mandats écourtés à cause de notre réticence à respecter la Constitution et la tolérance de ceux qui en observent.
* The End of Power, Moises Naim, Basic Books, 306 p., 2013.
La classe moyenne s’est développée très vite. Elle a doublé en 30 ans pour atteindre 2 milliards d’individus