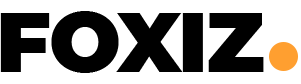Le soir tombe sur les ruines de Port-au-Prince, bientôt plongée dans l’obscurité. On ne distingue plus, au loin, qu’un feu rouge qui se balance au-dessus d’un carrefour. Partout où l’œil se pose, les décombres envahissent l’espace. Les chiens ont pris possession de la nuit. De temps à autre, leurs cris rompent le silence.
Au matin, les moteurs vrombissent. Dans la lumière crue du petit jour, les voitures tentent de se frayer un chemin au milieu du chaos d’une ville surpeuplée. Les tap-tap — taxis collectifs — contournent des cratères qui dictent les méandres de la circulation. Dans l’air, une odeur de mort mêlée à celle des eaux usées qui s’échappent d’un égout à ciel ouvert et à la poussière des ruines, que le vent souffle sur les vivants. Les Haïtiens vivent dans une douce surréalité : les disparus sont toujours présents ; on les imagine à chaque détour, encore prisonniers du béton.
Les enlèvements, arrestations arbitraires, tortures et autres exactions de l’armée, qui se poursuivent, derrière le masque d’une normalisation des institutions, tentent d’obliger le peuple à renoncer à ses rêves de justice et d’Etat de droit. En attendant, dans un tract diffusé à Port-au Prince, l’opinion populaire analyse sans illusions les causes du retour de la dictature : « Il faut que les pauvres sachent qu’ils ne sont rien (…). Il faut que les pauvres comprennent qu’éliminer des mouches, des ravets (cafards) et des pauvres, c’est la même chose. Le pauvre doit renoncer au mot espoir. Il e faut. L’inutilité même du massacre doit l’en convaincre . »
Des dix hommes noirs d’Etzer Vilaire, expression d’une société mélancolique du début du 20e siècle, on se retrouve dans une société de colère, de coquins et de cruauté. Cette conjoncture pourrie dans laquelle nous pataugeons se traduit éloquemment par ce chapelet de kidnapping de violences institutionnelles.
Nous continuons à patauger sou chemen pèdi tan ou un pouvoir insouciant qui n’arrive pas à remplir ses fonctions régaliennes. Un état prédateur qui ne se met pas au service de sa population. Une force de police qui ne fait pas honneur à son uniforme et qui tient la République en échec en inondant de gaz lacrymogène l’avenir et la gloire de ce pays, ces jeunes résidents et internes, pour avoir eu le mâle courage de manifester les mains nues, et pour seul porte-drapeau leurs blouses blanches témoins de tant d’années de sacrifices et de détermination dans un pays où tout décourage la jeunesse et concourt à la décourager. C’est plus qu’une honte pour Haïti, c’est un affront à la démocratie, une violation flagrante de l’une des valeurs fondamentales des droits de l’homme.
Cette bienveillance, également manifeste à l’égard d’autres pays en voie de développement peu démocratiques, conforte, dans l’opinion, la conviction que toute délégation de pouvoir équivaut à l’abandonner au profit de forces obscures et lointaines.
Les duvaliéristes ont longtemps fait vibrer cette corde sensible de la conscience collective haïtienne pour discréditer, en bons populistes, l’opposition démocratique.
Dans ce climat, la pression de Washington en faveur d’élections précipitées pèse lourd . Elle hypothèque le capital de confiance du prochain président, et interdit à la société paysanne, attachée à des valeurs communautaires « archaïques », de se donner les moyens politiques d’imposer ses exigences, surtout au lendemain de régimes très attentifs à enrayer toute initiative de réflexion et d’organisation au sein des forces les plus populaires.
Comme s’il s’agissait, au fond, de recueillir les fruits antidémocratiques de la dictature et d’en perpétuer la lignée, le département d’Etat et une partie de la bourgeoisie locale jouent une course contre la montre destinée à assurer l’émergence d’une démocratie simplement formelle, privilégiant l’accession au pouvoir d’une personnalité plutôt que d’un programme, dans l’espoir que le miracle du suffrage universel éteindra l’effervescence d’une société incontrôlable. Une démocratie sans contrat social, pour des lendemains désenchantés.