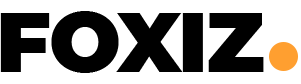Depuis juillet 2018, Haïti connaît une situation insurrectionnelle. Rues barricadées, circulation bloquée, activités commerciales paralysées : le pays est régulièrement mis à l’arrêt, parfois pendant plusieurs semaines. À l’origine de ce mouvement social inédit ici, la fusion de deux colères : celle contre la «vie chère» et celle contre la corruption, deux fléaux désormais identifiés comme soutenant un même système.
Vendredi 6 juillet 2018. L’équipe du Brésil, très populaire en Haïti, affronte les «diables rouges» belges en quart de final du Mondial de football. Le gouvernement profite de l’occasion pour annoncer une augmentation de 38% du prix de l’essence. La mesure, longtemps cachée, fait partie d’un accord signé avec le Fonds monétaire international (FMI) le 25 février de la même année. Le plat pays l’emporte, Haïti se soulève.
En moins d’une heure, des barricades s’élèvent dans les rues de Port-au-Prince, la capitale, prémisses d’une insurrection urbaine qui dure deux jours, jusqu’au retrait de la mesure et à la démission du premier ministre. Mais la colère ne retombe pas : un mois plus tard, le 14 août 2018, une photo postée sur Twitter, avec le hashtag «petrochallenge», devient virale sur les réseaux sociaux. On y voit l’écrivain et cinéaste Gilbert Mirambeau Jr, les yeux bandés, tenant un carton sur lequel est écrit, en créole : «Où est l’argent de Petrocaribe?» (lire ci-dessous). Social et éthique, le double détonateur de l’été 2018 illustre que vie chère et corruption sous-tendent un même système : celui dont les Haïtiens ne veulent plus.
Dès le mois de mai 2017, des milliers d’ouvriers embauchés par les industries textiles des zones franches — en fait, dans leur majorité, des ouvrières — prennent régulièrement la rue pour demander une hausse du salaire minimum, alors fixé à 300 gourdes (4 euros) par jour. Ignorée, leur revendication se fond dans une autre ébullition, qui préfigure le soulèvement populaire de l’année suivante : celle qui entoure, au mois de septembre, le vote du budget.
Le texte cristallise l’hostilité. Dans le pays le plus pauvre (près de 60% des Haïtiens vivent sous le seuil de pauvreté), mais également l’un des plus inégalitaires d’Amérique latine, le pouvoir n’innove guère. Les nouvelles recettes identifiées proviennent d’une hausse supplémentaire de taxes affectant l’ensemble de la population. Par contre, les tarifs douaniers qui s’appliquent au riz, par exemple (passés de 35% à 3% en 1994), n’évoluent pas, condamnant Haïti à la dépendance : 80% du riz consommé sur place est importé, dans un marché contrôlé par une poignée d’importateurs richissismes. Et pour équilibrer les comptes? Une dose plus forte encore de libéralisation, dont le pouvoir espère qu’elle attirera les investissements étrangers. Mais, outre la reconduction d’un modèle déjà en panne, le budget entérine surtout le détournement de la puissance publique par l’élite. Alors que l’environnement, la santé et l’éducation restent délaissés, le parlement et l’exécutif s’octroient davantage de moyens discrétionnaires.
Phénomène inédit, les protestations contre le budget se doublent bientôt d’une forme d’audit populaire de ses attendus. L’opération consiste à exiger des comptes, au propre comme au figuré. Peu à peu, le mouvement citoyen de lutte contre la corruption ne cible plus uniquement les mille et une formes de prévarication mais le détournement de la mission de service public des institutions en général, et de l’État en particulier. En poste depuis février 2017, le président Jovenel Moïse se trouve bientôt sous le feu des projecteurs.
Un tel phénomène s’explique sans doute par le fait que, si la corruption n’est pas neuve ici, elle a changé d’échelle et s’est institutionnalisée depuis le mandat de M. Michel Martelly (2011-2017), dont M. Moïse est le dauphin. Elle est également plus visible puisque, plus arrogant, le pouvoir ne tente plus de la cacher. L’ampleur du phénomène — qui concerne l’ensemble de la classe politique, le monde des affaires et bon nombre de fonctionnaires —, ainsi que la gravité et la diversité des irrégularités démontrent la faillite de tous les mécanismes de contrôle et de sanction. L’impunité est devenue telle que le phénomène, si longtemps subi, puis accepté, engendre soudain la révolte.
Jamais peut-être depuis la chute du dictateur Jean-Claude Duvalier, dit «Bébé doc», en 1986, un gouvernement n’a été aussi impopulaire et l’opposition si intense et unanime, regroupant syndicats, enseignants, églises, artistes, paysans, ainsi que la majeure partie du secteur privé. Le maintien de M. Moïse ne tient plus qu’à deux fils. D’une part, l’oligarchie locale, qui contrôle les douanes, les ports et les banques, et tire l’essentiel de ses ressources des importations, elles-mêmes liées à la subordination de l’économie au géant nord-américain. De l’autre, les soutiens internationaux, au premier rang desquels, Washington (qui a obtenu, depuis 2019, un alignement de la politique étrangère haïtienne sur la sienne dans le dossier vénézuélien). De son côté, le Parlement européen a adopté, le 28 novembre 2019, une résolution condamnant la répression, notamment le massacre de La Saline (un quartier populaire de Port-au-Prince) en novembre 2019, qui a fait 71 morts. Le texte reconnait que l’«impunité et le désintérêt de la communauté internationale ont encore attisé les violences». Mais le texte en appelle, comme toujours, à un dialogue «inclusif» : une forme de soutien au président dont la majorité de la population estime qu’il participe du problème, pas de la solution.
S’il est difficile de fixer avec précision les visages de cette révolte populaire, une nouvelle configuration de forces sociales émerge cependant. D’abord, le «pays en-dehors», pour reprendre la belle expression par laquelle l’anthropologue Gérard Barthélémy désignait la paysannerie haïtienne, s’applique aujourd’hui aux travailleurs du secteur informel, aux ouvriers, à la majorité de la population, dont un quart vit dans l’extrême pauvreté. La hausse des prix, alimentée par les effets cumulés de l’inflation (20%) et de la dévalorisation de la monnaie locale, les a frappés de plein fouet, aggravant une situation où survivre demande un effort quotidien.
Ensuite, la jeunesse urbaine, tiraillée entre son éducation de classe moyenne et la précarité qu’elle subit. Celle-ci se montre particulièrement sensible à la dégradation des droits (montée de l’insécurité, des menaces et de la répression envers la presse et les défenseurs des droits humains), à la captation des institutions publiques, à la corruption et au risque croissant de déclassement. L’émigration constituait traditionnellement pour cette population le seul horizon, mais les portes se ferment alors que, face à l’afflux, divers pays d’accueil traditionnels (comme le Chili) exigent désormais un visa. Le mouvement citoyen anticorruption des petrochallengers — apparus après la circulation de la photo de Mirambeau Jr et dont Nou pap dòmi (nous ne dormons pas) représente le collectif le plus connu et le plus puissant —, constitue l’expression privilégiée de cette force sociale née au cours de l’été 2018.
Enfin, confrontées directement à l’insécurité alimentaire, à l’absence d’accès à la santé et aux violences, les femmes, dont des féministes de premier plan, sont présentes en masse dans les mobilisations. Le modèle néolibéral leur a sous-traité de force les services sociaux dont il a délesté l’État. Elles sont l’en-dehors de cet en-dehors… Elles portent jusque dans leurs corps l’impossibilité du statu quo, le refus de tout retour à la normale.
La jonction de la protestation sociale et de la révolte éthique bouscule les fractures de classe : par des voies différentes, la marchande informelle, la jeune entrepreneuse au chômage, l’ouvrière des zones franches et le fonctionnaire expriment la même soif de respect et de dignité, de droits et de services sociaux, d’institutions et de politiques publiques dignes de ce nom, et de souveraineté populaire.
Discrédité, sans moyens pour satisfaire les revendications, combien de temps M. Moïse pourra-t-il encore tenir? Nombreux sont ceux qui estiment sa chute certaine avant le terme de son mandat, à la fin de l’année 2021. Si elle advenait — mais quand et à quel prix? —, sa démission ouvrirait la voie à un changement, cadenassé par sa présidence. Elle constituerait le signe que la corruption n’est pas une fatalité, que l’impunité a une fin. La deuxième étape serait le procès de Petrocaribe en Haïti et de toutes les affaires de corruption, accompagné d’un audit de la gestion publique. Il faudrait ensuite reconstruire les institutions, de sorte qu’elle retrouve leur fonction première de service aux citoyens…
Utopique? Pas plus finalement que ne l’était de tirer la Cour supérieure des comptes de sa léthargie, au point d’obtenir d’elle l’impossible : la publication de deux rapports d’audit démontrant et détaillant les détournements des fonds issus de Petrocaribe. Laissées à elles-mêmes, ni la classe politique, délégitimée, ni les institutions, affaiblies, ne sont en mesure d’opérer le changement requis. D’où l’appel, non à des élections, qui, dans les conditions actuelles, ne pourraient éviter de consacrer la reproduction du même, mais à une «transition de rupture» dont le mouvement social serait le moteur. Le singulier alliage que les mobilisations actuelles sont en train de forger sera-t-il à la hauteur d’une telle ambition?