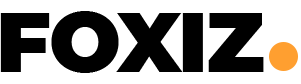Pourquoi sont-ils aussi nombreux à vouloir être président de la République, ministre, député, maire, responsable d’associations, à s’obstiner à prendre pareille charge de soucis, de conflits, de responsabilités ? La réponse de Maurice Berger, psychiatre et psychanalyste, est loin d’être rassurante : souvent doué d’une intelligence remarquable, « l’homme de pouvoir » révèle des sentiments profondément infantiles. D’une excessive fragilité narcissique qui le rend dépendant du regard d’autrui, il trouve dans la gestion de la vie publique un moyen privilégié pour soigner la folie cachée qui l’habite.
Le lieu vide et les paroles creuses
On pourrait résumer la leçon pascalienne en disant que Napoléon n’est pas fou pour autant, et aussi longtemps, qu’il se souvient d’avoir été Bonaparte. Un roi qui ne veut pas s’illusionner sur son état doit vivre avec le secret de son illégitimité. Louis Marin a défini au plus juste ce secret qui destitue l’absolutisme mieux que toute séparation institutionnelle des pouvoirs :
Le monarque absolu est un monument vide, un cénotaphe, un tombeau qui n’abrite aucun corps, mais qui est dans sa vacuité même corps royal17.
Le secret déposé dans l’esprit des grands est le seul moyen dont ils disposent pour échapper à l’hybris du pouvoir qui consiste à faire corps avec son statut social.
À lire Pascal, on se demande pourtant ce que l’on gagne à appeler « folie » cette démesure de l’imagination. Dire que les puissants sont des « rois de concupiscence » signifie qu’ils empruntent leur pouvoir à la concupiscence de ceux qui les servent en espérant en retirer un bénéfice. Pourquoi convoquer la sémantique de la folie pour dénoncer un mécanisme qui s’apparente au calcul utilitaire ? Justement, Pascal le fait pour montrer qu’il y a autre chose que du calcul rationnel dans les mécanismes du pouvoir. Il a en vue toutes les sortes de cérémonies de couronnement destinées à recouvrir le vide sur lequel reposent les relations hiérarchiques. Davantage que les rapports de force, c’est ce cérémonial qu’il juge délirant chez ceux qui y adhèrent en s’y soumettant et, plus encore, chez ceux qui s’y réfèrent pour revendiquer leur légitimité.
La référence à la folie présente l’avantage de placer une imagination débridée là où l’on ne voit d’habitude que de la force brute, des calculs ou des délibérations équitables. Selon Pascal, le pouvoir ne peut être décrit par aucun modèle rationnel : ni le mécanisme des forces, ni le jeu des intérêts, ni la raison communicationnelle. De ce point de vue, le détour par sa pensée est d’autant plus utile que nos sociétés ont tendance à rationaliser le pouvoir de mille manières. En apparence, tout sépare une critique qui ne voit que de la violence nue dans les rapports sociaux d’une philosophie du droit qui recherche les fondements de la légitimité. Mais elles partagent le présupposé selon lequel le pouvoir est susceptible de vérité. A contrario, l’hypothèse pascalienne sur la folie sort de l’alternative entre la rationalité froide du calcul et la rationalité fondatrice de l’autonomie : partout où l’on voit des raisons d’agir, elle met des images.
Ces images peuplent-elles encore nos démocraties désenchantées ? Pierre Legendre s’est interrogé naguère sur les fictions qui traversent ce qu’il appelle les « institutions nationalistes18 ». Dans une veine pascalienne, il soutient que les institutions modernes ne se contentent pas de penser, mais qu’elles délirent d’une « espèce de folie » repérable dans les discours bureaucratiques apparemment les plus raisonnables19. Disciple de Lacan (un autre grand pascalien), Legendre diagnostique la substitution du « discours de l’Université » au « discours du Maître », c’est-à-dire le remplacement de la parole du prêtre par celle de l’expert. Certes, nous ne croyons plus à ce que Pascal appelait les « grandeurs naturelles » : personne ne peut plus s’avancer sur la scène publique en prétextant de son aura ou de sa naissance. Legendre semble regretter ce temps où l’autorité ne présentait pas les raisons qui justifient son pouvoir symbolique. Mais cela n’enlève rien à la justesse de son diagnostic sur le « délire de vérité » qui s’empare régulièrement des institutions républicaines. Désenchantées, nos sociétés ne le sont pas tant que ça qui convoquent de plus en plus souvent des formules magiques (« République », « laïcité », « vivre-ensemble ») censées dessiner un espace de l’indiscutable. Tout récemment, les autorités françaises ont proclamé l’existence d’un « esprit du 11 janvier » en lequel résidait (magiquement ?) l’unité nationale. Cela n’a pas été sans psychose collective dès l’instant où l’on a oublié que cet « esprit » n’était au mieux qu’une métaphore : des enfants de huit ans qui n’avaient pas la chance de le percevoir se sont retrouvés au commissariat.
Cette passion de la légitimité concerne le pouvoir en général, mais aussi la manière particulière dont il s’exerce .
On se préoccupe beaucoup de la légitimité des chefs, plutôt qu’on ne songe à leur demander des comptes ou à les rendre responsables, effectivement et non rhétoriquement, de leurs actes.
Les institutions de la Ve République n’incitent pas le roi, bénéficiant de l’onction populaire, à se souvenir qu’il n’est qu’un naufragé reconnu par l’imagination des citoyens. Ni les citoyens à admettre qu’ils habitent une « île », et non un empire paré de tous les oripeaux de la souveraineté. En France, le pouvoir fait beaucoup de phrases, mais il est rare qu’il parle vraiment. Il préfère identifier son discours à celui de l’universel déposé dans des lois garanties par une administration qui ne doute pas de sa légitimité.
On répliquera que, depuis l’époque de Pascal, l’État en a rabattu sur ses prétentions folles à incarner le vrai. Ce retour à la modestie constitue un progrès de la démocratie si, comme le veut Claude Lefort, celle-ci met en scène le « lieu vide du pouvoir » que personne ne peut occuper sans devenir suspect d’usurpation. Mais l’affaiblissement (relatif) de la rhétorique étatiste s’est accompagné de l’émergence d’un autre discours de la Vérité : celui du marché où, en droit, tous peuvent prétendre au statut de chef. Dans l’imaginaire collectif, les « rois du pétrole » ont pris la place des rois drapés de pourpre. Il est vrai qu’ils ne fantasment plus leur naissance comme preuve de leur grandeur : c’est généralement dans un garage minable qu’ils prétendent avoir eu une idée commerciale ou technique qui devait révolutionner le monde. D’après leur biographie officielle, ils ne sont pas nés rois, mais ils le sont devenus par la seule grâce de leur esprit. Ivres d’une légitimité devenue individualiste, ils délirent autant que ceux qui, autrefois, ne voulaient rien concéder aux hasards de leur naissance. Dans les deux cas, la folie identitaire (« Je le vaux bien ») consiste à occulter ce que la légitimité doit à l’imaginaire social et à ses dérèglements.
Toutefois, les personnes qui ont le plus besoin de détenir le pouvoir sont-elles le moins capables de l’exercer sainement. Un livre à l’usage de tous les citoyens soucieux de comprendre les mécanismes souterrains qui régissent leur destin.