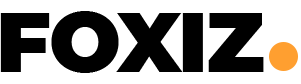HORMIS les 4 000 familles disposant d’un revenu annuel de 90 000 dollars, toutes les couches sociales d’Haïti vivent dans l’obsession du départ. Depuis une dizaine d’années, les migrants haïtiens se déversent en Floride et dans les îles Caraïbes. Refoulés ou déportés vers Port-au-Prince, ils recommencent les démarches pour un nouveau voyage. Ils sont déjà plus de 400 000 en République Dominicaine, 25 000 aux Bahamas et 70 000 à Miami ; on sait en outre que plus de 200 000 vivent à New-York et plusieurs dizaines de milliers à Montréal ; en tout, les Haïtiens de l’extérieur sont au nombre de 1 million.
L’une des causes de cette émigration est sans doute la situation économique ; Haïti est, en effet, le pays le plus pauvre des Caraïbes, avec un revenu annuel par tête de 60 dollars pour 61 % de la population (en 1979, le P.N.B. moyen par tête était de 230 dollars). Toutefois cette situation ne peut, à elle seule, expliquer les terribles risques encourus par les migrants qui bravent les tempêtes des Caraïbes à bord de voiliers de fortune, de frêles felouques, ainsi que des conditions d’accueil éprouvantes : camps d’internement en Floride et à Porto-Rico, néo-esclavage des « braceros » en République Dominicaine. Selon Mats Lundhal, qui a étudié la question dans Peasants and Poverty : a Study of Haïti (1), cette émigration massive est avant tout le résultat d’une politique : celle du président Duvalier.
L’ordre « tonton macoute »
LES corps de répression créés par le duvaliérisme n’ont pas fait seulement régner la terreur dans les milieux urbains, ils sévissent également dans les campagnes et poussent des masses de paysans, souvent analphabètes, à fuir le pays. Rares sont cependant les paysans ou les sous-prolétaires des villes qui acceptent spontanément d’invoquer les causes politiques de leur départ : « Je viens à l’étranger chercher du travail. A Haïti, je ne faisais rien, je ne pouvais pas nourrir ma famille, ni envoyer les enfants à l’école. » La politique reste un tabou tant qu’un climat de confiance ne s’est pas instauré avec l’interlocuteur. Vingt-cinq ans de dictature ne s’effacent pas du jour au lendemain dans l’imaginaire de l’émigré : il continue à croire en la présence cachée d’espions duvaliéristes un peu partout dans le monde. L’attitude des polices étrangères l’incite à une prudence bien souvent justifiée ; tout se passe comme si le travailleur haïtien migrant s’efforçait de protéger les membres de sa famille encore sur place à Haïti. Se définir comme réfugié politique pourrait entraîner la rupture des amarres avec sa famille ; une demande d’asile politique lui apparaît donc, à la limite, comme le premier geste d’une fracture culturelle. Même installé à l’étranger, il espère secrètement revenir un jour en Haïti, ne serait-ce que dans le but d’offrir des actions de grâce à ses esprits vaudou protecteurs (les Iwa ) et à ses morts, tous également membres (invisibles) de sa famille.
Le pouvoir établi par François Duvalier — élu d’abord président en 1957, réélu en 1963 et auto-proclamé « président à vie » en 1964 — possède deux caractéristiques principales : il fait appel aux classes moyennes et à la petite bourgeoisie pour qu’elles profitent de leur part de richesses dans le secteur étatique ; il pousse, en outre, à son extrême limite la discrimination qui s’exerce traditionnellement à l’égard de la paysannerie. Concrètement, François Duvalier se présente comme le « leader noir » apportant, par sa seule vertu de Noir au pouvoir, la solution magique à tous les problèmes sociaux. Ainsi, la paysannerie, laissée à elle-même politiquement au siècle passé, se voit désormais contrainte de sortir de son repli traditionnel pour faire de son propre espace de vie l’espace de l’Etat duvaliériste. Toutes les institutions du pays (armée, police, Eglise, éducation, information, etc.) seront réorientées au service d’une seule cause : le maintien de Duvalier au pouvoir. Un nouveau corps parallèle de répression — les « tontons macoutes » — est mis en place dans ce but.
Dès lors, l’ordre social traditionnel subit une involution et se boucle sur lui-même ; le duvaliérisme devient une référence centrale, impossible à contourner. D’où le nouveau dilemme de chaque Haïtien : ou s’y fondre, en se proclamant duvaliériste, c’est-à-dire en devenant complice des « tontons macoutes », ou simplement en prenant, au sens exact, le large.
Tout Haïtien vivant à Haïti exprime son allégeance à Duvalier, seul propriétaire du pays, par ces mots : « M-pa fè politik » (je ne fais pas de politique). Avouer le contraire reviendrait à entrer dans la contestation du régime. Tout refus de participation aux fêtes de la dynastie Duvalier, dites fêtes nationales, est considéré comme un acte de désobéissance civique, une trahison. Mgr Ligondé, archevêque de Port-au-Prince, dans une lettre adressée aux prêtres des paroisses, insistait aussi, récemment, sur le caractère incivique d’une telle attitude. Régulièrement, des bandes armées de « tontons macoutes » sillonnent les campagnes et contraignent les paysans à se rendre en ville pour témoigner de leur adhésion au régime. L’Etat peut réquisitionner les services de tout citoyen pour le faire participer à des meetings, des rassemblements duvaliéristes, voire pour lutter contre les rebelles. Ceux qui s’opposent à cet embrigadement et « marronnent » peuvent être abattus sur place sans autre forme de procès. De même, refuser d’entrer dans le corps des « tontons macoutes », quand la demande expresse en est faite, c’est exprimer une indépendance coupable, grosse de risques.
Les arrestations ou exécutions, souvent sans motif, au gré des humeurs de certains « tontons macoutes », visent à démontrer qu’un seul ordre existe : l’ordre duvaliériste.
Disposer, à la campagne ou en ville, d’un petit commerce florissant, avoir gagné à la loterie populaire (la boulette), posséder quelque lopin de terre, etc., tout cela expose à la rancœur du premier « tonton macoute » venu, lequel peut exproprier ou rançonner. Car, bien que 40 % des fonds publics aillent aux organes de répression, seuls les chefs « tontons macoutes » perçoivent un salaire régulier ; leurs subalternes (40 000 selon les déclarations officielles) se paient eux-mêmes en s’emparant, l’arme au poing, des biens et des revenus de ceux qu’ils accuseront, a posteriori, de « faire de la politique ». Le vol et la corruption, généralisés, sont les modes ordinaires de fonctionnement du système.
Dès lors, le problème de l’émigration n’est pas seulement lié à la misère extrême, mais d’abord à l’impossibilité de s’en sortir quand on n’est pas duvaliériste. Ce blocage du pays, vécu dans le présent, se projette sur le futur : la perspective de la dictature héréditaire, à vie, démontre au paysan que ni lui ni sa descendance n’ont la moindre chance de connaître une amélioration de leur condition à Haïti. Il est donc acculé à prendre la fuite.
Dès le début des années 60, la fraction de la bourgeoisie qui s’oppose au régime émigre pour éviter les persécutions politiques. Les intellectuels et les cadres suivront, avec l’approbation du dictateur, qui considère ce départ comme un bon débarras. Au cours des années 70, une partie de cette bourgeoisie exilée revient au pays, accepte de se soumettre et se proclame duvaliériste : ce régime leur garantit un enrichissement rapide. Aujourd’hui, plusieurs familles de la bonne société sont fières de compter un de leurs rejetons parmi les « tontons macoutes », en qui elles voient un instrument de « paix sociale ».
La contestation ouverte est presque inexistante. Des tentatives se sont toutefois produites de 1976 à 1979 à la faveur de la politique de défense des droits de l’homme prônée par le président James Carter ; elles ont juste consisté à revendiquer une certaine « indépendance ». Quelques stations de radio diffusèrent des éditoriaux « indépendants » ; la revue le Petit Samedi soir publia des textes dans cet esprit et divers groupes d’artistes s’en réclamèrent publiquement.
Un univers concentrationnaire
DÈS le lendemain de la victoire électorale de M. Reagan, le régime qualifia tous les « indépendants » de « subversifs » et organisa les arrestations massives du 28 novembre 1980. Cette nouvelle vague de répression incite alors à la fuite : le trafic de visas et de places de bateau se généralise. Beaucoup cherchent à s’évader de cet univers concentrationnaire. Et si le régime permet à quelques journalistes et syndicalistes connus de l’opinion internationale de prendre le chemin de l’exil, il ne peut empêcher que plusieurs milliers de paysans partent vers la République Dominicaine, où ils savent pourtant qu’un nouvel esclavage les attend dans les champs de canne.
Haïti vit en état de persécution politique collective : tout citoyen est sommé tôt ou tard de se reconnaître duvaliériste pour pouvoir disposer du droit de vivre dans son pays. C’est cela ou l’exil, et les paysans émigrent par milliers. Leur attitude exprime une nouvelle forme de « marronnage », dernier mode possible de protestation. Aucune expérience d’humiliation en terre étrangère ne les dissuade de reprendre cent fois le chemin de l’exil.
Laënnec HurbonChargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique ; auteur de Dieu dans le vaudou haïtien (Payot, Paris 1972) et de Culture et dictature en Haïti : l’imaginaire sous contrôle (l’Harmattan, Paris 1979).