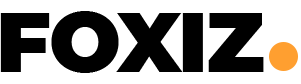Les sciences sociales se trouvent confrontées à une situation nouvelle qui appelle l’examen de la frontière entre violence et politique. Toute violence n’est pas (en dernière instance) politique, et on peut considérer que la politique n’est pas (en dernière instance) violence, mais tracer une séparation trop radicale entre les deux termes constitue probablement un obstacle à la compréhension des violences émergeant à l’intérieur du régime démocratique et non plus comme des projets visant sa déstabilisation. À la fin des années 1980, tout semble indiquer la fin de la violence politique. Pratiquement aucun groupe politique ne revendique la violence armée dans la poursuite d’objectifs politiques ou doctrinaires. Parallèlement, la démocratie ne connaît plus d’ennemis. Aucun acteur politique, révolutionnaire ou réactionnaire, ne cherche à abolir la démocratie. Ces mouvements cachent pourtant, derrière l’adhésion qu’ils suscitent naturellement, un troisième aspect. Tout se passe comme si l’emploi de la force implosait. À la violence politique organisée succède une dissémination de la violence devant laquelle le système judiciaire semble impuissant. Ses réponses sont insuffisantes, contestées, perçues comme illégitimes. Cependant, aucune autre solution n’est revendiquée, seule la Justice peut répondre légitimement à la violence. Deux problèmes découlent de cette tension : les rapports entre violence, politique et justice (et la légitimité de l’État dans l’utilisation de la force), et la présence de nouveaux répertoires d’action pour les classes populaires.
Le cas argentin permet de voir comment l’expansion du sentiment d’« impunité » a mis la Justice devant le procès instruit à son encontre par les victimes, les accusés ou les nombreux mouvements sociaux constitués précisément en raison de ses insuffisances. Les difficultés du système judiciaire à fournir une solution aux blessures provoquées par le terrorisme d’État (notamment celle des « disparus ») et par les deux crises majeures qu’ont été l’hyperinflation de 1989-1991 et la récession de 1998-2002, ont alimenté ce sentiment d’impunité tant dénoncé par les Mères de la Place de Mai. Les « puissants » responsables des pires atrocités et des catastrophes économiques ne sont jamais jugés. Puis, à l’intérieur des institutions (police, justice, parlement, gouvernement), la corruption et les dysfonctionnements sont si profonds que les institutions deviennent une partie du problème qu’elles sont censées régler. La corruption du régime protège à la fois politiciens, juges, entrepreneurs et policiers. L’impunité constitue le ciment de cet alliage qui fait le lien entre les violences et les critiques de la corruption politique. Elle permet également de réunir des faits de nature très diverse. Si ces « violences » impliquent très indirectement les pouvoirs en place, l’impuissance ou la lenteur de l’action judiciaire les unifie et les politise.
À l’image des mouvements revendiquant la vérité sur le sort des victimes de la dictature et le jugement des responsables, les mobilisations récentes en demande de « justice » court-circuitent les partis, portées par des citoyens et les médias. Initiées pour la plupart par les proches des victimes, ces mobilisations reprennent le modèle d’action inventé par les « mères » sous le régime militaire, puis continué par les grands-mères et les fils des « disparus ». La Loi se montre incapable de soumettre le Pouvoir. L’État a bien récupéré son monopole de la force, reste encore qu’il l’exerce dans la légalité. En France, on n’observe pas un tel dysfonctionnement de la Justice. Mais les soupçons de partialité à l’égard des forces de l’ordre, des entrepreneurs et des hommes politiques politisent également la violence au sein de la démocratie. Un sentiment exacerbé d’inégalité à l’égard des riches, des politiciens et des technocrates alimente la distance entre gouvernants et gouvernés. Et la mémoire des guerres coloniales, les guerres que l’Occident mène dans des pays islamistes et les discriminations à l’égard des minorités renforcent cette politisation de la violence.
Les liens entre l’extension des différentes formes de violence et l’augmentation vertigineuse des exclus, des pauvres et des désaffiliés sont évidents ; et ceci aussi bien en Argentine qu’en France, même si l’objectivité de ces processus de désintégration sociale n’a pas la même ampleur dans les deux pays. Dans la mesure où les liens entre question sociale et extension de la violence sont évidents non seulement pour l’observateur mais également pour les couches sociales aisées, le profil des nouvelles « classes dangereuses » se précise : la si souvent citée « fracture sociale » risque de se doubler d’une frontière quasi statutaire. L’association entre la violence éparpillée et la nouvelle question sociale est telle qu’elle excède le seul traitement de l’illégalité par les institutions judiciaires et de police. Dans ce contexte, la réponse aux questions posées par la violence ressentie comme excessive et insupportable ne semble pouvoir venir que du politique.
La séparation radicale entre « violence » et « politique » rend impossible toute alternative qui ne se résume pas à une pure et simple condamnation de la violence, et alimente ainsi les tentations sécuritaires. Cette séparation bride aussi bien l’action des hommes et des groupes politiques que les discours des universitaires et des intellectuels. Elle agit comme une contrainte intellectuelle qui débouche sur un véritable aveuglement quand on cherche à comprendre la réalité politique des classes populaires.
La présence des classes populaires au sein de la démocratie a évolué ces trente dernières années jusqu’à permettre l’identification d’une nouvelle « politicité » populaire. Les classes populaires d’aujourd’hui ne se distinguent pas de la classe ouvrière seulement par leur « sociabilité » (le chômage, la précarité et l’inscription territoriale), elles s’en distinguent aussi politiquement. En premier lieu, parce que l’État a mis en place une véritable batterie de politiques publiques en direction de l’univers populaire, qui peut aller de la création de corps spécialisés de police et de tactiques répressives à la mise en place de politiques sociales de nature diverse (politique de la ville, d’insertion, de lutte contre le chômage, éducatives, etc.). En deuxième lieu, parce que les classes populaires ont développé des stratégies de survie et des modes d’action collective qui les mettent fréquemment en contact avec la violence et qui les laissent souvent en situation d’illégalité. Trafics, occupations illégales de terres, travail au noir, saccages (saqueos), émeutes (estallidos) et barrages de routes en Argentine ; bizness, illégalismes divers dans le parc de logement social, immigration clandestine, occupations d’usines et séquestrations de cadres dirigeants, casseurs et émeutiers, occupations de la voie publique et de locaux d’institutions diverses, destruction de cultures, affrontements répétés avec la police en France.
La caractérisation de ces formes d’action comme « violentes » a pour conséquence une certaine disqualification des classes populaires qui les met en dehors de l’espace politique ; cette disqualification augmente la perplexité des acteurs politiques censés « réceptionner » les messages portés par ces actions qui s’exercent depuis la périphérie de l’ordre social. Intellectuels, enseignants, travailleurs sociaux, journalistes, et hommes politiques manquent de mots politiques pour nommer ce qu’ils ont en face d’eux – quand toutefois ils ont la volonté de comprendre politiquement cette altérité. Ainsi, dans une enquête récente, nous avons demandé à des bibliothécaires des quartiers de la Seine-Saint-Denis de nous dire quels ont été les faits violents les plus fréquents dont ils avaient été victimes ou témoins. Ils n’ont ainsi que rarement évoqué des violences physiques contre les personnes (moins de 1 %), mais assez fréquemment les violences contre les biens (50 %), et dans l’immense majorité des cas (plus de 90 % de réponses), le mot « violence » vient qualifier des indisciplines, des échanges verbaux et généralement tout refus d’obéir aux injonctions d’une autorité (bibliothécaire, enseignant, policier, animateur). Dans une conjoncture de changement social et politique comme celle que nous vivons, il convient de mettre en question ces distinctions taxinomiques qui séparent radicalement la politique du social, de la violence et de l’économie. C’est pourquoi nous avons proposé le concept de « politicité » qui devrait nous permettre de mieux comprendre la vie politique de nos régimes démocratiques et, surtout, d’observer la manière dont la présence des classes populaires provoque une inflexion politique au sein de nos régimes.
Hannah Arendt faisait appel aux notions de « bureaucratie » et de « règne de l’Anonyme » pour désigner « le plus tyrannique » des « systèmes de domination », et elle y trouvait l’une des causes qui pouvaient conduire à la violence dans les sociétés contemporaines. En effet, le caractère systémique de la domination « rend impossible la localisation de la responsabilité et l’identification de l’adversaire » . Dans le contexte actuel, on peut penser que quelque chose de cet ordre demeure dans l’analyse de nos régimes politiques. Les mécanismes de domination économique et d’exclusion sociale ayant lieu dans le cadre de la loi et de la légitimité démocratique, il est difficile d’identifier un opposant à l’heure de contester ces formes de domination et d’exclusion. À ceci près qu’on n’observe pas aujourd’hui de revendication idéologique de la violence. Ainsi, les « émeutiers » et les « casseurs » disent seulement, comme beaucoup de leurs pairs des « quartiers », que les voies classiques de la mobilisation politique (vote, manifestation, grève et participation aux politiques sociales), « ça ne sert à rien ». L’évolution sociale des dernières décennies ne les dément pas. La « politicité » populaire se déroule tout à l’intérieur de l’espace démocratique mais dans le cadre d’une dépréciation des formes de participation et de mobilisation qui ont été constitutives de l’espace démocratique lui-même. D’où la situation particulièrement tendue et difficile des catégories les plus exposées : les individus qui les composent revendiquent la citoyenneté et pour ce faire font violemment irruption dans un système politique incapable de les entendre, ce qui risque d’ajouter, comme beaucoup l’ont signalé, une raison politique à leur exclusion sociale.
Dire la violence à l’intérieur de l’espace démocratique est difficile car celle-ci y est inscrite sur un mode contradictoire. D’un côté, « la violence » apparaît comme un mot fourre-tout, foncièrement indéterminé qui permet de qualifier des formes d’action très hétérogènes, de l’insulte à la contrainte physique. Il est, de ce point de vue, pratiquement impossible de parler de « la » violence sans préciser le sens accordé au signifiant. Mais il y a, au sein de notre régime politique, un usage du mot qui est au contraire surdéterminé : semble être violent tout ce qui sort de l’espace démocratique, et tout ce qui est violent est politiquement exclu. Alors, dans les conditions sociales d’inégalité, de discrimination, d’appauvrissement et de désaffiliation qui marquent le quotidien d’une partie croissante des classes populaires, cet usage du mot sert en pratique à la disqualification de certains modes d’action et à la défense de l’ordre existant.
Source :
- H. Arendt?: «?Sur la violence?», in Du mensonge à la violence, Paris, Calmann-Lévy/Pocket, 2000, p. 105-187 (Crises of Republic, 1972).
- [2]V. Bedin et J.-F. Dortier, Violence(s) et société aujourd’hui, Paris, Sciences humaines, 2011. L’ouvrage réunit une trentaine d’auteurs et d’articles d’anthropologues, sociologues, psychologues, historiens, politologues.
- [3]Pour une description détaillée des formes de la violence dans l’Argentine démocratique, voir Merklen D. et Sigal S., «?Violence et politique. Une approche argentine?», La Nouvelle Revue Argentine, no 2, avril 2009, p. 11-20.
- [4]Deux associations de défense des droits humains ont émergé en réponse aux exactions policières, la Commission de familles des victimes de la violence institutionnelle (cofavi) et la Coordination contre la violence policière et institutionnelle (correpi).
- [5]S. Pereyra, «?Cuál es el legado del movimiento de derechos humanos??», in F. Schuster et alii?: Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Prometeo, 2005, p. 151-191.
- [6]Kessler G., Sociología del delito amateur, Buenos Aires, Paidós, 2004.
- [7]Merklen D., «?Une nouvelle politicité pour les classes populaires en Argentine?», in P. Bouffartigue et S. Béroud?: Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives??, Paris, La Dispute, 2009, p. 237-251.