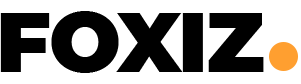1986-2000, déjà bien longue, la période de transition de la dictature vers la démocratie !… Et pourtant, Haïti semble encore loin du but, peinant sur « un chemin montant, sablonneux et marécageux », miné par l’Intelligence américaine, défoncé par la gendarmerie haïtienne, crevassé par des pluies torrentielles et des lavalas soudaines. Le naufrage électoral de mai dernier a montré avec éclat la difficulté de passer d’un État de force à un État de droit, alors qu’en 1986 « le peuple tout entier » avait dit non au « système de pouvoir basé sur la force », non à « la chape de nuit duvaliérienne ». Grande aujourd’hui est la déception de constater qu’Haïti a une fois de plus raté le coche.
Mais pourquoi donc est-ce si difficile et pénible en Haïti, la transition vers la démocratie ? Ce ne serait pas tourner en rond que de répondre : parce que la sortie de la dictature est difficile et pénible. Mais l’explication serait, d’un certain point de vue, circulaire, dans la mesure où elle ne laisse rien entrevoir sur la singularité de la forme dictatoriale haïtienne. A la recherche d’une réponse étoffée, avançons l’hypothèse que la transition difficile vers la démocratie s’explique, en profondeur, par la difficulté qu’a la société haïtienne à se libérer de ce que je décrirai comme le cercle du familialisme asservissant.
Bien sûr, on pourrait chercher une réponse, à un premier niveau, au plan psychologique et culturel, dans le caractère des « chefs » politiques et dans la culture politicienne dominante. La démarche serait en partie justifiée, du point de vue scientifique : l’histoire concrète est faite par des acteurs, individuels et collectifs, qui sont mus par des mobiles singuliers et dirigés par des modèles culturels dominants. James Morrell a tenté une telle approche dans son effort pour comprendre la volonté de Fanmi lavalas de « prendre tout le pouvoir », un comportement apparemment irrationnel, à effet boomerang de toute évidence. Dans son article paru dans International Policy Report et diffusé sur Internet à ciponline, il explore « les dimensions culturelles et psychologiques » d’un tel comportement du parti Fanmi Lavalas. Il entend le chef de famille, annonçant en 1998 sa candidature aux élections présidentielles de 2001 : « Lavalas ne fera pas de cadeau… Il n’y aura pas de place pour les woulibè… Le prochain gouvernement sera 100 % lavalas ». Il écoute un citoyen ordinaire, chauffeur de taxi à Port-au- Prince : « Lavalas aurait gagné, même s’il n’avait pas triché. Mais il voulait écraser l’opposition ». Il cite mon article sur « la guerre des légitimités » entre Fanmi Lavalas et OPL, diffusé en janvier 1999 à ciponline et mettant en relief « la figure charismatique de Jean-Bertrand Aristide qui prétend incarner seul les vraies aspirations des masses haïtiennes et en être le vrai représentant légitime » (Midy, 1999). Il rapporte d’autres témoignages sur l’apparente incapacité naturelle des Haïtiens à rechercher le compromis. Tous ces points de vue, conclut-il, permettent d’élucider la culture de prise du pouvoir, qui règle le jeu politique haïtien (Morrell, 2000).
Si l’approche psychologique et culturelle est productive quand il s’agit d’expliquer des conduites individuelles et de mettre en lumière le rôle singulier de leaders charismatiques, elle n’offre pas de réponse satisfaisante à la question de savoir pourquoi la transition vers la démocratie en Haïti est difficile. Elle laisse même hors de question, à proprement parler, le processus de production sociale de « leaders ». Il y a, en effet, une dialectique leaders charismatiques-serviteurs fidèles, l’offre de leadership appelant la demande de leadership et vice versa. Autrement dit, l’offre de leadership est d’autant plus vite reçue qu’une demande potentielle de leadership l’attendait pour se manifester, de même que la demande de leadership trouve toujours des leaders potentiels prêts à naître pour y répondre. C’est la reproduction continue en Haïti d’un tel processus de production sociale de « leaders » et de « fidèles », datant de la période coloniale, qui entrave aujourd’hui la voie vers la démocratie. Il convient donc d’aller à un niveau plus profond d’analyse, pour tenter d’observer cette dialectique à l’œuvre.
Je situe ce niveau profond dans l’imaginaire social ; ce champ de représentations et d’aspirations partagées par une collectivité et constituant comme une sorte de mémoire vive de travail pour les membres de cette collectivité ; qui y puisent schèmes de pensée, modèles culturels et idéologies pratiques. J’aborderai l’imaginaire social par une entrée, celle de la représentation du pouvoir. Fouiller, explorer l’imaginaire collectif, à la recherche de ce qui travaille la société haïtienne et s’exprime à travers elle. Il s’agit du point de vue méthodologique de chercher derrière les comportements individuels, en deçà du conjoncturel dans la profondeur de l’histoire, les schèmes de pensée actifs, les modèles culturels prégnants du passé, les idéologies pratiques d’usage courant reliés au pouvoir. Comme le montre l’exemple des paysans français sous Napoléon III, analysé par Marx :
La tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c’est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu’ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu’ils leur empruntent leurs noms, leurs mots d’ordre, leurs costumes, pour apparaître sur la scène de l’histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté (Marx, 1969 :15).
N’en est-on pas là aujourd’hui en Haïti ? Les esprits du passé ne se sont-ils pas emparés du mouvement social pour le changement sous un déguisement respectable et un langage emprunté ? Pour la mise au jour d’un tel imaginaire fondateur de tradition, je recourrai à une démarche interprétative inspirée de l’herméneutique de Gadamer et cherchant à « saisir le phénomène lui-même dans le concret où il se révèle unique et historique » :
Ici peut être à l’œuvre autant que l’on voudra l’expérience générale : il reste que l’on ne se propose pas de confirmer et d’étendre ces expériences générales pour parvenir à la connaissance d’une loi… On veut au contraire comprendre comment tel l’homme, tel peuple, tel Etat, est ce qu’il est devenu et, en général, comment il a pu se faire qu’il en soit ainsi (Gadamer, 1996 :20).
L’article part de l’hypothèse que la société haïtienne n’est pas encore libérée de la tradition issue de la société coloniale esclavagiste, prise qu’elle est dans le cercle du familialisme asservissant du passé, une situation qui rend difficile la transition vers la démocratie. Il procède par éclairage successif. Dans un premier temps, je compose trois ou quatre notes théoriques, qui me serviront de base et me guideront dans l’interprétation de l’imaginaire du pouvoir. Une seconde partie travaillera à mettre au jour et à élucider le cercle du familialisme asservissant, qui exprime les rapports réels de pouvoir et en même temps les masque en les imprimant dans les esprits sous les traits de relations familiales. La dernière partie tente de dégager de l’étude de l’imaginaire du pouvoir la nature du pouvoir réel. L’analyse d’ensemble ouvre des pistes de réflexion sur les conditions de cheminement sans entraves et sans dérives vers la démocratie.
L’imaginaire social : base théorique d’exploration
Il suffit de prêter un peu d’attention au langage courant pour découvrir avec étonnement l’omniprésence et la prégnance de certains mots dans la culture haïtienne. C’est le cas, peut-être unique, de trois d’entre eux ; unique, parce que intimement unis l’un à l’autre, formant une trinité indissociable. Ce sont les mots « maître », « papa », « famille ». Ces trois mots ont traversé sans rides et toujours main dans la main toute l’histoire, du début de la colonie de Saint-Domingue à l’Haïti post-coloniale.
MAITRE. Hier, le colon est maître de ses esclaves, légalement, Code noir3 à l’appui. Aujourd’hui aussi, tout individu ayant quelque pouvoir (politique, social, économique) est souvent salué par le titre de maître, avec une déférence réelle ou feinte, par les sans-pouvoir des classes opprimées. Dieu lui-même, pour ces classes, est le Bon Dieu Grand Maître… Mèt (colon propriétaire d’esclaves), Bondye Granmèt, mèt (untel), c’est comme un fleuve ininterrompu, qui descend de la colonie d’esclavage jusqu’à l’actuelle société d’exclusion.
PAPA. Hier, le maître esclave est donné pour le père de ses esclaves, et le chef militaire pour le père de ses subalternes. Le Gouverneur puissant et craint est le père des colons sans défense, Général Toussaint tout-puissant est le père des soldats totalement assujettis, le Blanc dominant est le père de l’Affranchi dépourvu de droits politiques. Aujourd’hui encore, tout chef veut être le papa des administrés insécurisés et tout élu du clientélisme politique, qui est promu à la Direction de Services Publics, veut agir en chef et maître, donc en papa. Dieu aussi est papa, également des Esprits/Loas. Et dans les jeux d’enfants on retrouve le jeu de papa comme jeu de pouvoir. Comme pour le mot « maître », il n’y a pas de chaînon manquant pour « papa » dans la chaîne qui relie les origines coloniales du mot à son usage actuel : Papa Toussaint, Papa Dessalines, Papa-Doc, Papalwa, Papa Bondye, Papa Legba, met papa.
FAMILLE. Hier, l’esclave est attaché à la famille du maître, relevant en vertu du Code noir, de la loi de famille. Après la proclamation de la liberté en 1793, il reste rivé à la plantation, décrété membre de la nouvelle famille que forme l’atelier des cultivateurs-serfs sous le commandement et la surveillance du propriétaire-père. Depuis 1804, les chefs-papas n’ont jamais manqué de rappeler aux exclus sociaux que les Haïtiens forment une seule et même famille. Aujourd’hui, l’idéologie familialiste semble même s’être emballée, la multiplication des sectes alimentant une multiplication de « frères » et de « sœurs » et une inflation du mot famille. Même le champ de la politique partisane n’échappe pas à la flambée langagière : le pays a désormais son parti-famille, occupé à essaimer et à implanter partout un réseau de ti fanmi (Fanmi Lavalas, 1998)4.
Bref, dans le système colonial d’esclavage, le maître d’esclaves est le père de ses esclaves et le chef de la famille instituée par l’attachement des esclaves à leur maître en vertu du Code noir. Dans le système post-colonial de mi-servage de l’Haïti indépendante, le propriétaire-maître de plantation reste le père des cultivateurs-serfs et le chef de la famille instituée par l’attachement de ces cultivateurs à leur maître-propriétaire en vertu d’un Code rural5. Dans l’un et l’autre système de rapports d’asservissement, avant et après 1804, le maître-père est le chef d’une famille asservie et l’unité maître-papa-famille forme une trinité maudite, au regard de la condition d’opprimés !
Quelles conclusions provisoires tirer de ces observations préliminaires ? On 1 peut faire au moins quatre propositions. 1) « Maître », « père », « famille » ne sont pas des statuts, ni une institution ; ce sont des rapports sociaux doublés de rapports de pouvoir, juridiquement consacrés et idéologiquement sacrés, donc masqués. 2) Les trois figures sociales sont mutuellement inclusives, se comprenant l’une l’autre, formant une trinité indivisible. 3) Elles racontent chacune le même récit d’institution et de reconstitution de rapports de pouvoir dans la société d’esclavage, puis de servage. 4) le pouvoir s’exhibe dans la réalité et se masque dans l’imaginaire comme volonté de puissance et d’humiliation. En effet, le maître est à la fois propriétaire d’esclaves traités en biens meubles, père d’esclaves-choses et chef d’une famille instituée par un rapport d’asservissement. Le père, pour sa part, est le maître de sujets infantilisés, au sein d’une famille de serviteurs attachés ou enchaînés à leur chef tout-puissant. Quant à la famille, elle est un atelier de travailleurs asservis ou une armée de soldats assujettis, placés sous le commandement sans bornes et sans appel de maîtres propriétaires ou de chefs militaires.
Fondu en une trinité, maître-père-famille est tout ensemble réalité et fiction confondues : rapports sociaux d’asservissement réels recouverts par la fiction de relations familiales de bienveillance.
Comment interpréter cette longue tradition d’un pouvoir asservissant, qui se présente sous les traits de la bienveillance ? Une lecture du « grand homme » de Hegel à la lumière de la dialectique du Maître et de l’Esclave semble pouvoir aider à saisir ce qui se joue dans la passion du pouvoir suprême. Egalement l’analyse de Marx de la production sociale du « grand homme » et la réflexion de Freud sur le besoin psychologique de « grand homme ». A ces références théoriques proprement dites pourrait être aussi associée la représentation haïtienne du gran nèg. Le « grand homme » de Hegel, le « grand homme » de Marx, le « grand homme » de Freud, le gran nèg haïtien semblent tous faire signe vers un même théâtre, vers un même jeu : la mise en scène d’un rapport de domination/soumission.
Hegel met en lumière la relation dialectique qui lie le Maître et l’Esclave, du fait du travail du désir. Le maître désire être reconnu comme maître par l’esclave et l’esclave désire être reconnu par son maître, se reconnaissant donc lui-même esclave de son maître. Telle est la dialectique du Maître et de l’Esclave. Le désir est désir de reconnaissance (Kojève, 1947). Le Maître est volonté de puissance, laquelle se trouve concentrée dans le « grand homme ». Noter cependant que la volonté de puissance chez Hegel n’est pas l’expression d’une domination incontrôlée et illimitée du grand l’homme (Juszezak, 1980). Dans la société coloniale d’esclavage et la société post-coloniale de servage, dans le nouvel Etat nègre ostracisé, nul n’est d’emblée reconnu. Aussi tous désirent-ils être reconnus : chacun par son maître, quelques-uns par tous. Tous veulent sortir du néant social, une poignée voulant s’élever au-dessus du néant, devenir « grand homme », « homme fort », gran nèg et échapper ainsi à la possibilité permanente de mort sociale. Dans une société où la reconnaissance sociale est au départ refusée, le désir d’être est toujours opérant. Et dans l’impossibilité perpétuelle d’assurer l’être, on investit et se travestit dans le paraître7 ; l’être humain est, dans la mesure où il est socialement reconnu (Taylor, 1994 ; Todorov, 1995).
Ce qui intéresse Marx, c’est la question de la production sociale du « grand homme ». Quels sont les mécanismes qui en rendent compte ? Comment expliquer le choix massif de Louis Napoléon par les paysans français en 1851, alors que ce représentant politique ne représente guère leurs intérêts ? Marx propose en marge du matérialisme historique de comprendre leur comportement électoral inattendu à partir de leur besoin et de leur désir, à partir de leur imaginaire : chercher l’explication non dans la réalité mais dans le mythe, dans l’imaginaire de la classe et non dans les rapports socio-économiques (Ansart, 1968). L’explication se trouverait, d’un côté, dans l’isolement économique et culturel des familles paysannes entre elles et des autres classes sociales, et dans le besoin de sécurité du paysan isolé sur sa parcelle et se sentant menacé dans sa possession. Dans pareille situation, il désire être défendu par une force et une autorité, qui ne peuvent qu’être extérieures à lui-même et qu’il se représente comme un pouvoir transcendant, absolu, capable de déployer sur lui une protection et contre les autres une défense autoritaire. Le choix des paysans s’expliquerait aussi par « l’organisation imaginaire de leur passé et le contenu de leur mémoire collective. C’est le souvenir qu’ils conservent des gloires de l’Empire qui leur fait croire qu’un homme portant le nom prestigieux de Napoléon leur rendrait leur puissance disparue » (Ansart, 1968 :106). Devant les yeux du paysan isolé, insécurisé et en attente d’un Seigneur-Sauveur, se profile, derrière la figure de Louis Bonaparte, l’image du Grand homme Napoléon Bonaparte… Qu’il peut être encore plus urgent et insistant, ce besoin et ce désir de grand homme-sauveur chez une masse d’esclaves, de serfs, d’exclus sociaux, de moun en dehors de la vie nationale !
Alors que dans sa Phénoménologie de l’esprit, Hegel analyse le désir d’être reconnu grand homme, alors que Marx met au jour, au niveau des conditions sociales et de l’imaginaire de classe, le besoin et le désir du grand homme, Freud psychanalyse dans son Moïse et le monothéisme le besoin et la quête du grand homme. Le peuple juif, opprimé et accablé, est en quête d’un Grand homme capable de le soulever au-dessus de son abîme de malheurs. Du fonds de sa détresse, il n’arrête pas de crier son De profundis vers un Sauveur, un Seigneur, un Grand homme. Moïse est l’épure finale de cette longue quête douloureuse de grand homme jalonnée de croquis sans cesse retouchés. Freud a mis en lumière les traits de caractère du Grand homme achevé.
La plupart des humains éprouvent le besoin impérieux d’une autorité à admirer, devant qui plier, et par qui être dominés et parfois même humiliés…
Tous les traits de caractère dont nous voulons parer le grand homme sont des traits propres au personnage paternel… fermeté dans les idées, puissance de la volonté, résolution dans les actes (…) et plus encore la confiance en soi du personnage, sa divine conviction d’avoir toujours raison, conviction parfois poussée jusqu’au manque total de scrupules (…) Moïse dut attribuer certains des traits de son propre caractère au Seigneur : l’irascibilité et l’implacabilité (Freud, 1948 :147-148).
Dans la société coloniale d’esclavage où l’esclave n’était rien, sauf un « bien meuble », dans la société post-coloniale de servage où le cultivateur était un peu plus que rien, mais toujours « moun andeyo », dans la société actuelle d’exclusion où les pauvres-opprimés ne passent plus pour « moun », dans une société accoutumée au mal politique, indifférente à l’immense détresse de « la masse », le besoin de grand homme est presque naturel. La floraison de sectes religieuses et l’apparition d’un parti-famille en sont des manifestations concrètes (Corten, 2000 ; Midy, 1999).
Le gran nèg haïtien fait aussi partie du vocabulaire du pouvoir suprême imaginaire. Le Gran nèg passe habituellement pour opulent et omnipotent dans sa section, sa zone ou son bourg. Par son capital économique et social —il n’a pas nécessairement de capital culturel— il domine les membres de sa collectivité, auxquels il se croit supérieur. Il dit, dans le langage créole qui classe et hiérarchise, ne pas vouloir être de leur rang, ni passer pour leur camarade. Il se situe au-dessus d’eux, dans la sphère réservée du pouvoir et de d’État ; il s’identifie même à l’Etat, à la puissance étatique. Le témoignage suivant dit beaucoup sur le Gran nèg imaginaire.
Louis Jean Baugé habite un petit bourg rural. Il est grand propriétaire terrien, possède le plus gros commerce de la zone et une usine de décorticage du café. Il nourrit des relations étroites avec des Grands de la ville et a été pendant un quart de siècle le chef incontesté de sa section rurale. Il est semi-analphabète. Un jour, il décida de se rendre un hommage public : Mwen gran nèg, mwen gen lajan, mwen mechan, mwen fè 25 kan chèf deta (Je suis un gran nèg, je suis riche, je n’ai peur de personne, j’ai été chef, participant de la puissance étatique pendant 25 ans). On pourrait y lire de la mégalomanie. Mais, ce qui doit retenir ici l’attention, c’est le fait que l’imaginaire dévoile plus sur la réalité du pouvoir qu’une description objective : le gran nèg a partie liée avec le pouvoir d’Etat ; il est à ce titre impitoyable et craint, kanson fè et bayonèt fè.
On peut maintenant revenir à l’histoire et chercher à établir l’imaginaire du pouvoir, cet imaginaire fondateur de tradition. L’Haïtien d’aujourd’hui et son ancêtre d’hier ont vécu dans des systèmes de rapports plus qu’inégaux, dans des rapports déshumanisants : société coloniale d’esclavage, société post-coloniale de servage, société dépendante d’exclusion. La théorie suggère que ces formes de société peuvent générer et nourrir aussi bien le désir d’être grand homme que le besoin de grand homme. En référence à l’expérience vécue, l’imaginaire du gran nèg semble le soutenir. L’histoire longue d’Haïti le confirmerait-il ?