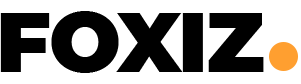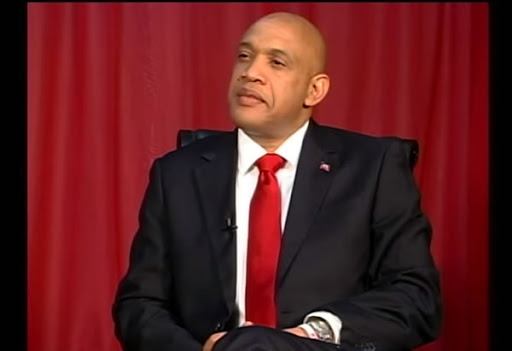l’économie haïtienne est affectée par le fossé entre les dirigeants et les dirigés, ainsi que l’influence corrosive de la corruption, du népotisme et du régionalisme. L’élite des affaires, la classe politique, la société civile et les chefs traditionnels sont étroitement liés, accaparant les ressources qu’ils redistribuent ensuite par le biais d’un système clientéliste.
La misère extrême, le changement climatique, la dépendance vis-à-vis de l’aide et le vaste secteur informel, sans parler de l’impact de certaines politiques économiques telles que les subsides versés par les États-Unis, mettent en avant la nécessité d’une réforme et d’un développement économiques. Le « paradoxe de Sikasso » souligne les ratés d’un tel modèle : le taux de pauvreté est élevé dans une région fertile dominée par la production de cultures commerciales. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il existe un modèle qu’Haiti se doit d’adopter.
Le modèle politique du consensus a privé les Haïtiens de la possibilité de débattre et de décider des valeurs
qu’ils souhaitaient voir placer au coeur de la vie et du développement économiques. Les acteurs extérieurs ont un rôle à jouer dans la facilitation de ce débat. Cela pourrait consister notamment à mettre à profit les expériences d’autres pays, et à souligner l’impact négatif et positif que des réformes économiques peuvent avoir sur les conflits sociaux, politiques et institutionnels.
Aider le gouvernement Haïtien à créer les conditions propices à la croissance économique et à la création d’emplois est une priorité de développement majeure. Un dialogue plus grand entre les associations professionnelles, les chambres de commerce et autorités à l’échelle locale, les acteurs du développement et les entreprises étrangères pourrait permettre à l’investissement fait par ces dernières de soutenir les mesures d’aide au développement destinées à répondre aux besoins à court et moyen terme de la population locale.
Parallèlement, cela pourrait permettre aux autorités locales de gagner en légitimité et d’élaborer des plans et des stratégies à long terme en faveur de la croissance économique de leurs régions. Nos entretiens avec les cabinets des maires, les gouverneurs régionaux, les chambres de commerce locales, la population locale et les organisations non gouvernementales internationales (ONGI) indiquent que malgré la réussite technique de nombreuses interventions internationales de développement, ces dernières ont rarement été accompagnées d’efforts pour promouvoir une plus grande transparence et améliorer la coopération entre les structures gouvernementales et les représentants locaux.
À cela s’ajoute l’ampleur de la corruption et du racket. Par conséquent, il faut qu’à l’avenir les projets de développement soient automatiquement dotés de mécanismes de contrôle local incluant le gouvernement local, les chefs traditionnels, les entreprises et professionnels locaux et les membres des communautés concernées, de même que de mécanismes de contrôle parlementaire à l’échelle nationale.
Recommandations
Les bailleurs et autres acteurs internationaux peuvent faire beaucoup pour soutenir l’amélioration
de la gouvernance économique.
• Soutenir la facilitation d’un large débat, ouvert à tous, sur le type d’économie souhaitée pour Haiti qui sous-tendra les principes et les valeurs du pays.
• Fonder les interventions de développement sur une évaluation claire des obstacles structurels sous-jacents au développement économique, en prêtant particulièrement attention aux groupes vulnérables et marginalisés.
• Travailler avec le gouvernement malien à s’assurer que les investisseurs étrangers, qui décident d’investir en Haiti, connaissent bien le contexte local, régional et national, et disposent de mécanismes pour nouer le dialogue avec les parties prenantes locales. Il est important qu’ils aient élaboré des stratégies d’atténuation, notamment en ce qui concerne les conflits potentiels relatifs à la terre et à l’emploi (ou le chômage).
• Inclure systématiquement dans les projets de développement des mécanismes de contrôle local auxquels participent le gouvernement local, les chefs traditionnels, les entreprises et professionnels locaux et des citoyens. Trouver des méthodes innovantes pour prendre en compte l’opinion des groupes marginalisés, tels que les femmes et les jeunes.
• S’assurer que le point de vue des femmes est représenté dans chaque phase de programmation du développement, de la conception à l’évaluation en passant par sa mise en oeuvre. Chaque programme doit délibérément veiller à profiter aux femmes.
Henry Beaucejour