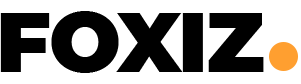Cet ouvrage est le troisième que André Corten écrit sur Haïti, mais il a plusieurs autres publications sur le tiers-monde, par exemple sur le Mexique, l’Algérie, le Brésil, la République dominicaine. Jusqu’ici, il s’intéressait aux problèmes de l’Etat et des structures de production de la pauvreté. Mais il semble particulièrement sensible aux conditions de vie misérable de la majorité de la population haïtienne. On dirait que Haïti mérite d’être le paradigme même de la désolation créée par les élites économiques mondiales néo-libérales et en même temps le lieu où l’on peut faire l’épreuve de ce qu’on appelle « le mal politique ». C’est justement autour de ce concept que André Corten construit tout l’ouvrage sur Haïti, en recourant spécialement aux travaux de Myriam Revault d’Allonnes et de Hannah Arendt.
Le mal politique se définit, écrit-il, par « l’acceptabilité de la déshumanisation, c’est à dire la possibilité que la déshumanisation corresponde à une syntaxe de raisonnement collectif » (p.17). Face à une telle situation, le chercheur comme le tout — venant peut finir par croire qu’il n’y a aucun moyen ni espoir de changement réel, mais il peut rester fasciné par le spectacle de la désolation et s’habituer au mal au point de le banaliser. La misère vécue à ciel ouvert en Haïti dans la capitale surtout et dans les villes de provinces semble exprimer que des couches importantes de la société sont mises à l’écart de l’humain : sans eau, ni électricité, sans système sanitaire, sans toit, vivant dans la promiscuité dans des rues pleines de boue et de détritus et ne disposant pas d’espace privé, comme si l’on était en présence d’un véritable camp de concentration. Ce modèle va guider André Corten dans son analyse de la société haïtienne d’aujourd’hui. Mais il prend soin de ne pas se laisser prendre au piège du mal politique, en se contentant par exemple de livrer des statistiques sur les conditions économiques et sur la dégradation de l’environnement. Il lui faut plutôt retrouver le vécu émotionnel des victimes de la déshumanisation, être attentif à leur subjectivité et à leur parole. C’est pour cela que devra être privilégié un type d’analyse basé sur le modèle linguistique.
Mettre au jour les trames narratives qui conduisent les victimes de la déshumanisation à rendre compte de leur condition, à donner un sens à leur vie, à rationaliser le « mal » qui les frappe ? Telle est l’ambition de Corten. Pour la faire aboutir, il commence par décliner les différentes conceptions du mal qui traversent la société haïtienne. Il découvre qu’elles sont toutes des interprétations persécutives tantôt on est renvoyé sur le registre de la sorcellerie à partir même de l’imaginaire vodou qui veut que des forces spirituelles peuvent décider du sort des individus indépendamment de leur volonté, tantôt le « tonton macoute » (police parallèle créée par le dictateur Duvalier dans les années 1960) représente le mal par excellence dont il faut délivrer le pays, car le « macoute » est identifié au pouvoir arbitraire par excellence, tantôt enfin les grands mangeurs sont les responsables du mal pour s’être accaparé de tous les biens de l’Etat et du travail des autres. Tout se passe finalement comme si tous les groupes sociaux procédaient à une satanisation de leur adversaire et ne pouvaient en conséquence ni connaître leur réalité véritable ni avoir une prise quelconque sur cette réalité. C’est le mal politique qui conduit l’individu à produire un classement des comportements dont le résultat le plus certain est la reproduction inéluctable du système de déshumanisation. Corten va alors se mettre en quête des pistes de sortie du cercle vicieux de la désolation et propose de reconsidérer le phénomène religieux non plus en termes d’idéologie : la religion ne doit plus selon lui être analysée comme illusion ni comme opium pour les masses. Ayant atteint « l’impensable », « l’incompréhensible », les masses parviennent à opposer un autre vécu au mal politique, c’est ce que l’auteur appelle avec Cari Schmitt « la pulsion schismatique ». Dans cette affaire, le pentecôtisme qui se répand dans toute la société et affecte autant les églises baptistes que l’Eglise catholique (notamment à travers le renouveau charismatique) a le gros lot car, sans entrer dans une « logique du faire » (au sens où il n’a pas la prétention d’apporter une transformation de la réalité sociale et économique), il a la vertu de se concentrer sur une liturgie de « la louange ». En effet la communauté nouvelle à laquelle le converti pentecôtiste appartient est fondée « sur la joie » et non plus « sur la peur » : « l’énoncé de la louange échappe à la logique du “faire”. Dans une société où l’immense majorité est sans moyens pour “faire”, cela donne aux convertis une assurance inespérée » (p. 92). Cette perspective contraste singulièrement d’un côté avec les attitudes des intellectuels, de la classe politique et des institutions internationales qui demeurent dans la fascination de la désolation dans l’impuissance face aux changements sociaux qui s’imposeraient, et d’un autre côté avec l’Eglise catholique, institution qui se dresse face à l’Etat et qui tient lieu de société civile en représentant non pas « un pouvoir pour le peuple », mais un pouvoir « devant le peuple » (p.70).
Que l’Eglise catholique ait pu entrer en rupture avec son passé pendant les années 1980 au point de contribuer à la chute de la dictature de Duvalier (en 1986), cela ne change rien à son mode d’inscription dans la société haïtienne. Sous ce rapport, Corten parvient à produire une critique radicale du discours d’Aristide, (religieux salésien devenu président de la république en 1991), dans lequel il décèle un véritable détournement de la théologie de libération. Aristide en effet n’a eu en vue qu’une « théologisation du politique » :
Dans ce contexte, il s’écarte de toute rationalité et se cache derrière le vocabulaire de l’amour ou de la paix mis à toutes les sauces, pendant qu’il rallume le ressentiment dans les masses et les reconduit sur la route de la violence par l’éloge du « supplice du collier » pour ses opposants : « que le pneu enflammé sent bon ! » Discours du ressentiment chez Aristide, discours de compassion chez les élites politiques, mais aussi discours de culpabilité chez les protestants évangéliques, dans tous les cas c’est partout la désolation et l’impuissance, parce que la plupart des acteurs sociaux se complaisent dans la diabolisation des adversaires. Impossible donc d’assister à l’institution du politique en Haïti. Le religieux et le politique sont tellement intriqués (au sens où Claude Lefort l’explique) qu’on a l’impression qu’en Haïti toutes les solutions sont vouées à l’avance à l’échec.
On peut maintenant se demander, quand on réfléchit au parcours narratif de l’auteur lui-même, s’il n’exprime pas à travers cet ouvrage à l’instar des masses haïtiennes son propre désespoir politique. Car seul le pentecôtisme dont il reconnaît l’influence sur « près de la moitié de la population haïtienne » (p. 91) semble trouver grâce à ses yeux, car avec ce mouvement religieux, « il y a bien une transformation de la “langue” de la société qui s’opère » (p. 91). Corten prend soin de préciser que le pentecôtisme, en s’éloignant de la logique du faire, ne saurait parvenir à l’institution du politique. Mais sur la base de sa « pulsion schismatique », le pentecôtisme met quand même sur la voie d’une solution politique, car il aura su, lui, éviter de sataniser l’adversaire, en prenant la tangente vers le discours de la louange : « Il n’y a plus l’obsession des forces du mal par rapport auxquelles il faut contre-attaquer… » (p. 92). Plus loin en conclusion Corten revient sur cette interprétation du pentecôtisme. Ecoutons-le : « le discours pentecôtiste était celui qui parvenait le mieux à résister à la diabolisation par la confiance en soi qu’il conférait… » (p. 199). C’est bien ici à ce niveau de l’analyse proposée dans cet ouvrage qu’un débat devrait s’instaurer.
Peut-on vraiment soutenir que le pentecôtisme comme « phénomène transnational instituerait un nouveau type de lien social qui bouleverserait le rapport entre religieux et politique ? » (p. 199). Peut-on également démontrer que le pentecôtisme ne procède pas à la diabolisation des adversaires ? Peut-on enfin avancer que le pentecôtisme pourrait même être « une forme de sortie du religieux » ? S’il est vrai, comme l’auteur le reconnaît, que les médiations sont dévalorisées, que la confusion entre privé et public est maintenue et que le régime de la vérité est celui du vraisemblable, comment peut-on être si indulgent pour le pentecôtisme ? Certes, il y a bien une spécificité de ce mouvement religieux par rapport aux autres, mais peut-elle tenir dans une opposition au monde néo-libéral comme il le prétend (p. 200). Il me semble qu’ils sont nombreux les nouveaux mouvements religieux qui dans la Caraïbe abritent une critique et du système traditionnel de valeurs et croyances non-occidental et du monde néo-libéral. Et puis, n’arrive-t-il pas qu’on soit anti-néo-libéral par conservatisme ? Proposer « la pulsion schismatique » (concept déporté de la théorie politique de Cal Schmitt, et qui laisse par ailleurs le lecteur sur sa faim) comme une propédeutique à une solution politique requiert de plus amples explications, car pourquoi ne pourrait-on pas dire autant de tout mouvement religieux ?
Si l’on essaie maintenant de revenir aux données empiriques, force est de relever une certaine contradiction à voir dans le parti politique MOCHRENHA un groupe qui diabolise l’adversaire et qui recourt à l’idéologie « vertueuse » de l’indignation tout en déniant le processus de déshumanisation (p. 173-174), alors qu’en fait ce parti provient du milieu pentecôtiste. De même est-il vrai que la diabolisation de l’adversaire n’est pas dominante dans l’Armée céleste, ce mouvement qui semble être une radicalisation du pentecôtisme dans le réemploi obsessionnel qu’il fait de l’imaginaire de la sorcellerie et de Satan ?
Enfin sur le registre de l’analyse des faits sociaux, l’on est également autorisé à interroger l’emploi du modèle du camp de concentration pour rendre compte « de la misère absolue » observée en Haïti. Car ce modèle, repris directement de Hannah Arendt ne risque-t-il de raturer quelque peu la spécificité des camps de concentration créés par le Nazisme et en même temps appliqué à l’Haïti d’aujourd’hui, de conduire à un pessimisme radical vis à vis de toute solution politique ? La misère absolue, dit Corten, « touche à la conception même de l’humain dans une société » (p. 34) et, partant, ouvre facilement le chemin à une sortie essentiellement religieuse. Comme si donc l’on était dans une circularité allant du politique au religieux et vice-versa. Pour sortir de l’emprise du religieux sur le politique ou si l’on veut de la confusion entre le religieux et le politique en Haïti, pourra-t-on faire faire l’économie de la laïcité ? Et donc d’une réflexion sur la nature de l’État haïtien qui sert de support à la reproduction de la misère des masses ? Le pessimisme de Corten vis à vis de l’État va jusqu’à la disqualification de la société civile. Or celle-ci n’émerge-t-elle pas au fur et à mesure que les luttes pour l’avènement d’un Etat de droit se développent ?
Quoiqu’il en soit, il n’y a aucun doute que ces questions s’élèvent sur le fond d’une mise en garde qu’on trouve dans l’ouvrage même de Corten, à savoir que toute tentative de réduction du religieux est vouée à l’échec. Autre aspect positif de la recherche de Corten : ce n’est pas d’abord sa délicatesse dans sa manière de faire appel aux travaux des auteurs haïtiens pour appuyer ses analyses, je crois lire surtout à travers cet ouvrage une invitation pressante à la sociologie et à la philosophie politique d’abandonner tout caractère objectiviste et hautain autant que la propension à la simple compassion pour ne pas escamoter le vécu des masses enfoncées aujourd’hui — en plein triomphe du néo-libéralisme — dans des conditions de vie au-dessous du seuil de la pauvreté et mises à l’écart des droits humains.